Syndicalisme
![Trump, Musk et Vance : une nouvelle phase du capitalisme ? La couverture de Politique hebdo n°60, 4 janvier 1973. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guerre-a-imperialisme-390x205.webp)
Trump, Musk et Vance : une nouvelle phase du capitalisme ?
Ce texte est un extrait d’un document de 32 pages, réalisé avec l’apport des échanges menés avec le Bureau national de Solidaires Finances publiques et le Conseil d’administration de l’UNIRS et les compléments apportés par des camarades du C.A. de l’UNIRS.
Extrême-droite
![Sur le fascisme : Russie, États-Unis, Ukraine… Affiche de Mai 68 (atelier populaire des Beaux-arts). [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/les-peuples-vaincront-390x205.webp)
Sur le fascisme : Russie, États-Unis, Ukraine…
La guerre menée en Ukraine et la brutalisation du pays par l’administration Trump depuis le début du second mandat méritent une analyse qui fasse la place au temps long. Les régimes de Trump et Poutine peuvent ainsi défier l’analyse : soit parce qu’on se refuserait à les considérer comme des objets nouveaux, en invoquant des principes qui tiendraient à une sorte de « psychologie des peuples », soit parce qu’au contraire, on aurait la tentation d’en faire des régimes étranges, des anomalies en somme, ce qui rend impossible leur caractérisation. Or notre camp social a grand besoin d’un débat sur la caractérisation de ces deux régimes, ne serait-ce que pour résister efficacement ici aux idéologies qui les portent et qu’ils véhiculent. C’est pourquoi on cherchera ici brièvement à rechercher des continuités et des discontinuités entre ces deux régimes d’une part, et dans le temps long des États-Unis comme de la Russie d’autre part.
Féminisme
![Hommage à la résistance des femmes soudanaises Doaa Tariq. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Doaa-Tariq-390x205.webp)
Hommage à la résistance des femmes soudanaises
Dans ce texte écrit à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes [et paru initialement sur le site www.sudfa-media.com], la militante soudanaise Alaa Busati célèbre les luttes des femmes dans le monde entier, et rend un hommage particulier aux femmes soudanaises. Elle met en lumière les multiples façons dont les femmes résistent à la violence et aux destructions de la guerre, ainsi qu’au régime militaire.
Quelques lignes décrivant la situation actuelle au Soudan complète ce texte.
Histoire
![Desserrer le « nœud coulant du chômage » En une du numéro de La Gueule ouverte n°213 du 7 juin 1978. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/la-gueule-ouverte-390x205.webp)
Desserrer le « nœud coulant du chômage »
Le chômage, le coopérativisme, la démocratie, le syndicalisme, un peu l’écologie et même le socialisme. C’est de tout ça dont parle l’entretien de Charles Piaget donné à La Gueule ouverte en 1978 reproduit ici. Théo Roumier, qui a consacré une biographie récente au syndicaliste de Lip, le remet en contexte et propose, à l’heure de licenciements massifs, de le relire au prisme de l’actualité. Ce texte est initialement paru sur le site www.syndicalistes.org
Logements
![Logements des travailleurs immigrés «isolés» Rassemblement devant le siège d’ADOMA CDC-Habitat, le 19 avril 2024. [COPAF]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/14-Illust1-Petauton-Logements-des-travailleurs-immigrés-isolés-390x205.webp)
Logements des travailleurs immigrés «isolés»
Depuis 1996 (Rapport Cuq) et 1997 (décision d’un Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants), les plusieurs centaines de foyers de travailleurs immigrés sont « traités », c’est-à-dire transformés en « résidences sociales » avec des règles largement anti-sociales. Dans ces foyers/résidences, la loi prévoit que soient élus des représentants des résidents, pour former un comité de résidents, appelé à se concerter avec le gestionnaire, et avec le propriétaire s’il est différent (mais dans ce cas assez fréquent, le propriétaire ne se fait jamais représenter) dans un conseil de concertation réuni une fois par an. Des réseaux des comités de résidents existants (ADOMA et COALLIA) se coordonnent ; ceux-ci ne sont pas reconnus par les gestionnaires mais, sous leur pression (en général des rassemblements devant leur siège) peuvent être reçus pour une concertation. Une association, le Collectif pour l’avenir des foyers, a été créée en 1996, en appui à ces comités et à ces coordinations.
Travail
![Desserrer le « nœud coulant du chômage » En une du numéro de La Gueule ouverte n°213 du 7 juin 1978. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/la-gueule-ouverte-390x205.webp)
Desserrer le « nœud coulant du chômage »
Le chômage, le coopérativisme, la démocratie, le syndicalisme, un peu l’écologie et même le socialisme. C’est de tout ça dont parle l’entretien de Charles Piaget donné à La Gueule ouverte en 1978 reproduit ici. Théo Roumier, qui a consacré une biographie récente au syndicaliste de Lip, le remet en contexte et propose, à l’heure de licenciements massifs, de le relire au prisme de l’actualité. Ce texte est initialement paru sur le site www.syndicalistes.org
Ecologie
![De terres en guerre [Guerre à la guerre]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guerre-390x205.webp)
De terres en guerre
Pourquoi les Soulèvements de la Terre appellent à rejoindre la coalition Guerre à la guerre ? Dans la propagande gouvernementale, il est chaque jour question « d’économie de guerre », de « sécurité », de « menace », et de « réarmement ». Dans ce contexte, les Soulèvements de la Terre se joignent à la coalition « Guerre à la Guerre » pour appeler à une mobilisation le 21 juin prochain, contre le salon d’aviation militaire du Bourget. Ce texte déplie les raisons profondes qui motivent notre participation à cette initiative.
International
![Une autre économie, pour une paix juste et durable Délégations internationales à la manifestation parisienne du 1er mai 205 [Martin Noda, Hans Lucas]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/manifestation-parisienne-du-1-mai-205-390x205.webp)
Une autre économie, pour une paix juste et durable
Littéralement l’économie de guerre correspond à la mobilisation des ressources d’un pays pour mener l’effort de guerre, en réorientant dans le cadre d’une planification autoritaire les matières premières, la production industrielle et la logistique vers les besoins des armées, mais aussi en rationnant la consommation tout en fixant les prix, les salaires et les taux d’intérêt. Une grande partie de la richesse du pays sert alors à financer l’effort de guerre. Avec des dépenses de défense représentant à peine 1,9 % de son Produit intérieur brut (PIB) en 2023, la France est loin de cette situation, même si les projets des gouvernements de l’Union européenne de financer et de mettre en place une défense européenne marquent un tournant dans ce domaine.
Libertés
Retour en Syrie
Syro-suisse, Joseph Daher est retourné en Syrie après la chute de Bachar El Assad et l’Union syndicale Solidaires l’a reçu pour qu’il nous parle de la situation générale sur place et pour savoir si et comment les travailleur·euses s’organisent. Le texte qui suit est une transcription de cet entretien.
Racisme
![25 repères chronologiques Manifestation de Gênes, le 21 juillet 2001. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/manifestation-de-Genes-le-21-juillet-2001-390x205.webp)
25 repères chronologiques
La présente chronologie ne prétend pas reprendre toutes les dates ou périodes qui ont marqué la vie de Solidaires depuis 25 ans. D’ailleurs, elle débute bien avant 1998, pour fournir les éléments de compréhension de notre histoire, qui est plurielle.
Sport
![Dialectik Football Match du MFC 1871, en hommage à Adama Traoré. [terres de Feu]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/match-du-MFC-1871-390x205.webp)
Dialectik Football
Média exclusivement bénévole, Dialectik Football apporte un point de vue critique et documenté sur le football et son actualité, en assumant une ligne éditoriale clairement anticapitaliste. Il fait la part belle aux expériences de résistance, aux luttes émancipatrices et alternatives. Son parti pris, c’est qu’on ne changera pas le ballon rond sans révolutionner la société, sans en finir avec le capitalisme.
Vidéo
Un documentaire de Lucile Nabonnand et Etienne Simon (mars 2011).
Lors de la crise économique et financière de 1999-2001, de nombreuses usines ont été récupérées à Buenos Aires par leurs ouvrier-e-s, tandis que les patron-ne-s les fermaient les unes après les autres. Ce mouvement est né d’une nécessité de survie dans un contexte social particulièrement difficile, mais qui perdure depuis vingt ans comme une réponse prolétaire actuelle à la fermeture d’un lieu de travail. En allant rencontrer ces travailleur-se-s, nous voulions porter un regard sur la récupération et l’autogestion comme facteurs d’émancipation pour les femmes dans une société globalement misogyne. L’Argentine est un pays de réputation machiste, réputation qui d’après les organismes argentins de défense des droits des femmes relève d’une âpre réalité dans le monde du travail. La question sous-tendue par notre documentaire est de savoir si une organisation du travail plus solidaire, collective, autogérée amène aussi à un autre regard sur le travail féminin. D’un point de vue plus symbolique il pose ces deux questions : les choix d’organisation du travail transforment-ils les relations sociales et ces changements ont-ils une incidence sur le statut et la vie des femmes ?
Voir la bande-annonce : youtube.co/watch?v=k0ZLppOe2M4
Voir les Utopiques – numéro 10 (Sur les chemins de l’émancipation, l’autogestion)
Lucile Nabonnand est vidéaste et photographe indépendante à Nancy (lulna.blogspot.com), Etienne Simon est enseignant en Histoire-Géographie et militant syndical au sein de Solidaires. Leur départ en 2009 à Buenos Aires résulte d’une volonté commune de vivre in situ des expériences alternatives d’auto-organisation (politiques, féministes, professionnelles…) dont l’Amérique latine était devenue cheffe de file (assemblées de quartiers, collectifs piqueteros, entreprises récupérées, collectifs de femmes…). Au-delà, il s’agit par le biais du documentaire de relayer ces expérimentations et d’en permettre l’analyse et/ou l’application à d’autres femmes et hommes.
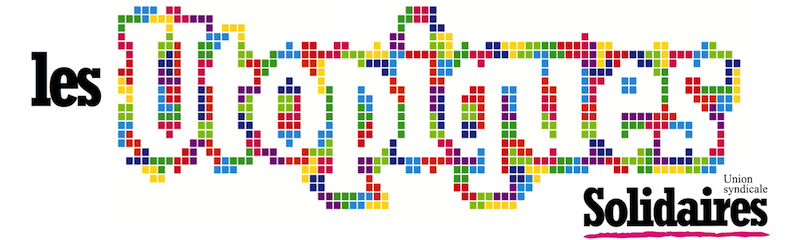
![Quand l’économie de guerre sert les partisans de l’austérité, version brutale Dessin de Francisco Lezcano Lezczno, dans Parole et Société, 1973. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Francisco-Lezcano-800x445.webp)
![Une autre économie, pour une paix juste et durable Délégations internationales à la manifestation parisienne du 1er mai 205 [Martin Noda, Hans Lucas]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/manifestation-parisienne-du-1-mai-205-800x445.webp)
![Face à la déstabilisation du monde : opposer le visage de la solidarité [S.Bontoux FSU]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/drapeau-fsu-palestine-800x445.webp)
![De terres en guerre [Guerre à la guerre]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guerre-800x445.webp)
![Les monstres sont lâchés [Cerises]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/vote-800x445.webp)
![Sur le fascisme : Russie, États-Unis, Ukraine… Affiche de Mai 68 (atelier populaire des Beaux-arts). [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/les-peuples-vaincront-800x445.webp)
![Trump, Musk et Vance : une nouvelle phase du capitalisme ? La couverture de Politique hebdo n°60, 4 janvier 1973. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guerre-a-imperialisme-800x445.webp)
![Quelques réflexions sur la situation actuelle Rassemblement à Paris, le 18 mars 2025. [Serge D’Ignazio]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/bds-800x445.webp)
![« Pour la paix », comme tout le monde ? RAS. Journal antimilitariste, 1984. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/journal-antimilitariste-800x445.webp)
![Ukraine : syndicalisme en temps de guerre Livraison syndicale de générateurs aux combattants - janvier 2025. [KVPU]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/KVPU-800x445.webp)
![Les syndicats et les travailleur·euses américain·es face à l’attaque sauvage de Trump Manifestation du 5 avril 2025 à New York [Coll. DLB]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/manif-5-avril-2025-DLB-800x445.webp)
![Dix syndicats nationaux appellent à la résistance anti-Trump Banderole du Service Employees International Union. [SEIU]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Banderole-du-Service-Employees-International-Union-800x385.webp)
![Hommage à la résistance des femmes soudanaises Doaa Tariq. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Doaa-Tariq-800x445.webp)
![Palestine : que faire ? « Stop génocide », 2024. [Nayla Hanna]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/stop-genocide-800x445.webp)
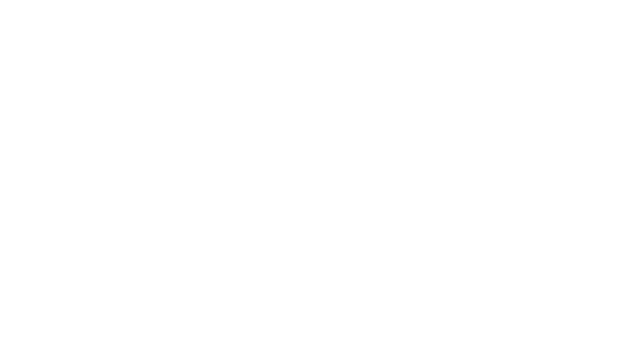
![Des extrêmes droites très internationales L. Trump, Bannon, J. Bolsonaro, Abascal, Bullrich, E. Bolsonaro, Milei, et d’autres du même acabit, au programme d’une réunion de la Conférence d'action politique conservatrice, en 2024, à Buenos Aires. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Buenos-Aires-800x445.webp)
![Femmes dans les conflits armés et lutte pour l’égalité en matière d’armement [Editions du Détour]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guns-and-roses-800x445.webp)
![Aux armes citoyens Valmy 2.0 Autocollant d’Information pour les droits des soldats (IDS), années 1970. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/droits-des-soldats-800x445.webp)
![L’opposition au Service national universel : un terrain de luttes syndicales Affiche de la fédération des syndicats SUD Éducation [SUD Éducation]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/affiche-Sud-Education-800x445.webp)
![Quand l’économie de guerre sert les partisans de l’austérité, version brutale Dessin de Francisco Lezcano Lezczno, dans Parole et Société, 1973. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Francisco-Lezcano-392x272.webp)
![Une autre économie, pour une paix juste et durable Délégations internationales à la manifestation parisienne du 1er mai 205 [Martin Noda, Hans Lucas]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/manifestation-parisienne-du-1-mai-205-392x272.webp)
![Face à la déstabilisation du monde : opposer le visage de la solidarité [S.Bontoux FSU]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/drapeau-fsu-palestine-392x272.webp)
![De terres en guerre [Guerre à la guerre]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guerre-392x272.webp)
![« Pour la paix », comme tout le monde ? RAS. Journal antimilitariste, 1984. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/journal-antimilitariste-130x90.webp)
![Quand il est déjà trop tard pour arrêter la guerre Campagne du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, pour la construction de puits d’eau potable en Ukraine, relayée par Inicjatywa Pracownicza. [IP]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Inicjatywa-Pracownicza-130x90.webp)
![Ukraine : syndicalisme en temps de guerre Livraison syndicale de générateurs aux combattants - janvier 2025. [KVPU]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/KVPU-130x90.webp)
![Les syndicats et les travailleur·euses américain·es face à l’attaque sauvage de Trump Manifestation du 5 avril 2025 à New York [Coll. DLB]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/manif-5-avril-2025-DLB-130x90.webp)
![Trump, Musk et Vance : une nouvelle phase du capitalisme ? La couverture de Politique hebdo n°60, 4 janvier 1973. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guerre-a-imperialisme-130x90.webp)
![Des extrêmes droites très internationales L. Trump, Bannon, J. Bolsonaro, Abascal, Bullrich, E. Bolsonaro, Milei, et d’autres du même acabit, au programme d’une réunion de la Conférence d'action politique conservatrice, en 2024, à Buenos Aires. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/Buenos-Aires-130x90.webp)
![L’extrême droite en marche vers le pouvoir, ce que peut le syndicalisme [Solidaires]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/3-Illust1-Angeli-Lextrême-droite-en-marche-vers-le-pouvoir-Ce-que-peut-le-syndicalisme-130x90.webp)
![Femmes dans les conflits armés et lutte pour l’égalité en matière d’armement [Editions du Détour]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/guns-and-roses-130x90.webp)
![Étudiantes, travailleuses, résidentes, militantes [Katya Gritseva]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/illustration-Katya-Gritseva-130x90.webp)
![25 repères chronologiques Manifestation de Gênes, le 21 juillet 2001. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/manifestation-de-Genes-le-21-juillet-2001-130x90.webp)
![Charles Piaget, à propos de la CFDT, il y a 20 ans Première page du manuscrit de Charles Piaget. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/manuscrit-Charles-Piaget-130x90.webp)

![De Paris au 93 Les Bourses du travail et le mouvement ouvrier La Bourse du travail de Paris, rue du Château d’eau, à l’aube du 20ème siècle. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/bourse-du-travail-de-Paris-130x90.webp)
![Canal Marches et les Marches européennes contre le chômage, la précarité et les exclusions La Marche normande, en 1997. Couv. du livre publié pour les 20 ans des Marches. [Canal marches – Syllepse]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/la-marche-normande-en-1997-130x90.webp)
![La nouvelle question foncière urbaine [AITEC]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/aitec-130x90.webp)

![Une lutte syndicale pour l’emploi et l’avenir de la vallée [SUD-Rail]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/2-Illust1-BreguiMahieux-Une-lutte-syndicale-pour-lemploi-et-lavenir-de-la-vallée-130x90.webp)
![Comment la guerre a changé le marché du travail en Ukraine [Katya Gristseva]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/11-Illust1-Socportal-Comment-la-guerre-a-changé-le-marché-du-travail-en-Ukraine-130x90.webp)
![Réfléchir, lutter, gagner Simon Duteil et Murielle Guilbert, lors de la manifestation parisienne du 7 février 2023. [Martin Noda/Hans Lucas]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/Simon-Duteil-et-Murielle-Guilbert-lors-de-la-manifestation-parisienne-du-7-fevrier-2023-130x90.webp)
![Un syndicat ferroviaire contre le Lyon/Turin Le réveil des montagnes, juin 2023. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/le-reveil-des-montagnes-juin-2023-130x90.webp)
![Solidaires et les mégabassines Soutien au Soulèvement de la Terre et autres mouvements sociaux menacés de dissolution. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/soutien-au-soulevement-de-la-terre-130x90.webp)
![Ce que le chlordécone dit des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe Manifeste rédigé à l’occasion de l’Université des mouvements sociaux et des solidarités, en août 2023. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/08/manifeste-redige-a-l-occasion-de-UMS-130x90.webp)
![Face à la déstabilisation du monde : opposer le visage de la solidarité [S.Bontoux FSU]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/drapeau-fsu-palestine-130x90.webp)
![Les monstres sont lâchés [Cerises]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/vote-130x90.webp)
![Sur le fascisme : Russie, États-Unis, Ukraine… Affiche de Mai 68 (atelier populaire des Beaux-arts). [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/les-peuples-vaincront-130x90.webp)
![Aux armes citoyens Valmy 2.0 Autocollant d’Information pour les droits des soldats (IDS), années 1970. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2026/01/droits-des-soldats-130x90.webp)
![Italie : une loi liberticide, esclavagiste et policière Naples : « Libre de lutter ! Arrêtons le projet de loi 1660 ! » [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/8-Illust2-Mahieux-Italie-une-loi-liberticide-esclavagiste-et-policière-130x90.webp)
![Les rapports toujours coupables du capitalisme avec le racisme [DR] L’empire français](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2023/04/l-empire-français-130x90.jpg)

![Le Miroir du football : un journal de référence François Thébaud, Coupe du monde de football. Un miroir du siècle (1904-1998), éditions Syllepse, 2022. [Syllepse]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/12/coupe-du-monde-de-football-un-miroir-du-siecle-130x90.webp)
![Boxe : Jack Johnson et les Espoirs blancs Jack Johnson - Tommy Burns, en 1908. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/01/Jack-Johnson-Tommy-Burns-en-1908-130x90.webp)
![Presque plus personne ne critique l’idéologie et la pratique sportive Portrait de J.M. Brohm, réalisé par Lucile Muller, illustrant l’article paru dans Le Chiffon. [Le Chiffon]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/01/portrait-de-J-M-Brohm-130x90.webp)