De l’internationalisation à la transnationalisation
Dans le cadre de la vision néolibérale du monde, la cause est entendue : nous serions entrés depuis quelques décennies dans l’ère de la mondialisation, celle de l’ouverture sans retenue des frontières nationales aux mouvements des marchandises et des capitaux, celle de l’intercommunication universelle entre les êtres humains dont l’extension exponentielle de l’Internet et la diffusion du tourisme de masse compteraient parmi les symboles en même temps que les manifestations les plus banales, celle du « dialogue entre les civilisations » qui peut cependant aussi virer à leur confrontation. Vouloir s’y opposer serait vain ; ce ne pourrait être l’affaire que d’esprits étroits et rétrogrades, héritiers des passéistes qui ont dénoncé, en leur temps, qui la diffusion du chemin de fer et du bateau à vapeur, qui celle de la radiodiffusion et de la télévision, pourtant autant d’étapes sur la voie du progrès. Car, s’ils concèdent à la limite qu’elle peut poser quelques problèmes d’adaptation qui seront transitoires, les tenants néolibéraux de la mondialisation nous assurent qu’elle ne peut finalement qu’être heureuse : elle nous promet un avenir radieux, sur la base d’une conjugaison optimale des activités humaines au sein d’un marché mondial enfin unifié, gage de pacification des relations entre les hommes. On se doute bien que la réalité est à cent lieues de ce tableau irénique et apologétique.
De l’internationalisation…
Pour des raisons qui tiennent en définitive à la fragmentation du capital social en une multiplicité de capitaux en concurrence, donc à la propriété privée des moyens de production, le marché mondial généré par l’universalisation des rapports capitalistes de production se fragmente nécessairement en un ensemble de compartiments entre lesquels la circulation du capital reste toujours formellement possible mais en étant subordonnée à l’autorisation et au contrôle de pouvoirs d’États qui en définissent et en défendent les frontières constitutives. Au sein de chacun de ces compartiments du marché mondial, certains capitaux (les capitaux indigènes) sont autorisés à opérer librement : à vendre et à acheter, à s’investir et se désinvestir, à se concurrencer réciproquement tout comme à se combiner (s’associer, fusionner, etc.) réciproquement ; alors que les autres capitaux (les capitaux allogènes) se voient imposer certaines conditions (plus ou moins défavorables) et certaines restrictions (plus ou moins importantes) à leur accès à ce marché, pouvant aller jusqu’à l’interdiction pure et simple d’y opérer. Si bien que chacun de ces compartiments du marché mondial constitue à la fois un marché intérieur (pour les premiers) et un marché extérieur (pour les seconds).
La première forme historique de cette fragmentation du marché mondial, qui s’esquisse dès la fin du Moyen Âge européen et qui se renforce singulièrement à partir de la « révolution industrielle », est celle qui coïncide avec la formation des États-nations. Chacun de ces États va constituer un tel compartiment du marché mondial. Plus exactement, chaque État-nation se forme et se définit comme un espace autonome de valorisation et d’accumulation du capital. Autonome au sens propre du terme : un espace qui dispose de sa propre loi. C’est dire qu’il n’y a constitution d’un État-nation que pour autant qu’on assiste à la nationalisation de la loi de la valeur, en ce en un double sens. D’une part, chaque État-nation va tenter de se constituer en un espace de formation et de réalisation de la valeur comme forme du travail social, autrement dit en un espace autonome de socialisation marchande du travail : c’est très exactement ce qu’on désigne habituellement sous les termes de marché national. D’autre part, chaque État va tenter de faire prévaloir les valeurs nationales, celles qui se forment dans et par ce marché, sur les valeurs internationales, celles qui résultent de la circulation et donc aussi de la concurrence internationale des capitaux, en usant soit de politiques libérales (libre-échangistes) au cas où les capitaux nationaux occupent une position favorable ou même dominante sur le marché mondial, soit au contraire de politiques protectionnistes au cas où les capitaux nationaux sont en situation défavorable sur le marché mondial. On devine évidemment que, dans ces conditions, la nationalisation de la loi de la valeur est elle-même l’enjeu des rapports de force entre États, qu’elle est donc inégalement réalisée selon les positions occupées par ces derniers sur le marché mondial, et qu’elle ne peut en définitive jamais qu’être imparfaite, même et y compris dans les plus puissants de ces États, étant donné la persistance inévitable d’une part d’ouverture du marché national sur le marché mondial.
Cependant, la nationalisation de la loi de la valeur n’aurait jamais pu avoir lieu, les différents marchés nationaux n’auraient jamais pu se former, même d’une manière imparfaite, si les États-nations n’avaient simultanément pris en charge, directement ou indirectement, la formation des conditions sociales générales de la production capitaliste – et c’est là un second élément de définition de l’État-nation. Celui-ci va ainsi assurer, en premier lieu, la formation des conditions générales de la circulation du capital au sein du marché national. D’une part, en contribuant à son unification matérielle (par la construction des infrastructures matérielles des voies de communication), monétaire (par l’imposition et la protection de la monnaie nationale), juridico-administrative (par la constitution d’un territoire et d’une population soumis à un même ensemble de lois et de règlements), culturelle (par l’imposition d’une langue nationale ou d’un ensemble limité de langues nationales), etc. D’autre part, en veillant à sa protection, par des moyens juridico-administratifs appropriés : l’interdiction d’importer ou d’exporter certains produits (produits de base ou produits stratégiques), le monopole des marchés publics et du commerce extérieur pour les capitaux nationaux, la promotion de l’agriculture et de l’industrie indigènes par des aides et des subventions diverses, l’érection de barrières douanières, la conclusion d’accords commerciaux avec d’autres États, etc. ; mais aussi, à l’occasion, par des moyens militaires : par des guerres défensives, visant à préserver le territoire et, par conséquent, les ressources du marché intérieur convoitées par un État étranger au service d’une fraction rivale du capital mondial, ou, au contraire, par des guerres offensives, visant à accéder de force à des marchés extérieurs ou même à se les approprier (s’en approprier les ressources et les débouchés), de manière à étendre d’autant le marché intérieur.
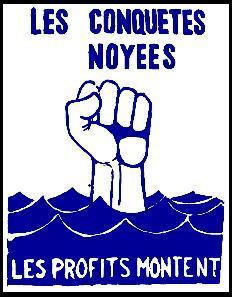 Et l’État-nation va assurer de la même manière, en second lieu, la formation des conditions générales du procès de production du capital, notamment celle des éléments socialisés du travail mort (par exemple les infrastructures productives ou la recherche scientifique et technique), tout comme celle des éléments socialisés du travail vivant, la reproduction socialisée de la force de travail (par exemple par des politiques sociales ou par le système d’enseignement). Le degré et les formes d’implication de l’État dans la constitution de ces conditions sociales générales du procès immédiat de reproduction du capital seront évidemment variables dans l’espace (d’un État à l’autre) tout comme dans le temps (d’une phase à l’autre du devenir historique, y compris au sein d’un même État). Mais partout l’État y aura joué un rôle essentiel, fût-ce seulement en tant que maître d’œuvre coordonnant la production de certaines de ces conditions par des agents non étatiques.
Et l’État-nation va assurer de la même manière, en second lieu, la formation des conditions générales du procès de production du capital, notamment celle des éléments socialisés du travail mort (par exemple les infrastructures productives ou la recherche scientifique et technique), tout comme celle des éléments socialisés du travail vivant, la reproduction socialisée de la force de travail (par exemple par des politiques sociales ou par le système d’enseignement). Le degré et les formes d’implication de l’État dans la constitution de ces conditions sociales générales du procès immédiat de reproduction du capital seront évidemment variables dans l’espace (d’un État à l’autre) tout comme dans le temps (d’une phase à l’autre du devenir historique, y compris au sein d’un même État). Mais partout l’État y aura joué un rôle essentiel, fût-ce seulement en tant que maître d’œuvre coordonnant la production de certaines de ces conditions par des agents non étatiques.
Ainsi, jusqu’à une date récente, le marché mondial apparaît à la fois fragmenté et hiérarchisé en une multitude de marchés nationaux, chacun d’entre eux servant de base de développement à une fraction territorialisée du capital mondial dans ses rapports de concurrence et de rivalité avec les autres fractions. Dans un tel espace essentiellement conflictuel et instable, les différentes classes sociales occupant un territoire déterminé peuvent espérer conserver ou améliorer leurs conditions d’existence en se constituant en un État ou en appuyant un État capable de leur permettre de défendre ou de conquérir des positions avantageuses dans l’arène internationale, en un mot, en se soudant avec d’autres classes en un bloc national, sous l’égide d’un État. C’est évidemment le cas de la classe dominante, qui a intérêt à s’assurer le soutien des classes dominées en les « fusionnant » dans un pareil bloc : cela renforce ses positions (démographiques, économiques, politiques, militaires) dans son affrontement contre les autres fractions du capital mondial. Mais cela peut aussi être le cas, bien qu’à des titres divers et dans des proportions différentes, pour les différentes classes dominées, y compris le prolétariat, qui, en acceptant de faire bloc avec « leur » classe dominante, de devenir ses alliées ou même simplement des appuis à son pouvoir d’État, peuvent espérer, elles aussi, tirer parti du renforcement des positions de « leur » État dans l’arène internationale. Ce qui n’exclut pas des luttes entre elles pour se partager les bénéfices ou les pertes de l’insertion de la formation nationale dans le marché mondial.
Ainsi, l’État-nation se laisse encore définir comme un bloc social, c’est-à-dire un système d’alliances et de compromis entre différentes classes, fractions, couches sociales, généralement sous hégémonie bourgeoise ; alliances nouées autour du projet de conquérir, de renforcer ou simplement de maintenir une position (des avantages relatifs) au sein de l’espace mondial que génère le devenir-monde du capital, sur la base d’un développement plus ou moins autonome d’une fraction du capital mondial ; alliances structurées par l’appareil d’État et prenant appui sur lui. C’est là un troisième et dernier élément de définition de l’État-nation qui vient prolonger et compléter les deux précédemment exposés.
La formation de tels blocs nationaux a été un facteur supplémentaire de fragmentation de l’espace géopolitique du capitalisme. Tout au long des trois derniers siècles, cet espace s’est singularisé par la formation, la persistance (plus ou moins forte) et même par l’émergence constante de nouveaux États-nations, servant tout à la fois de relais mais aussi de boucliers par rapport aux pressions de l’économie capitaliste mondiale. C’est par l’intermédiaire des États que les différentes communautés nationales, résultats des compromis et des alliances entre classes sociales, ont tenté de se mettre (plus ou moins) à l’abri du marché mondial ou, au contraire, de s’y insérer de manière plus ou moins favorable. Quoi qu’il en soit, la nécessité pour les États d’assurer les conditions générales de la reproduction des rapports de classe, sous domination de la classe capitaliste, dans le cadre de compromis institutionnalisés, n’a pas moins introduit de multiples facteurs de coupure/fracture/cassure dans l’homogénéité de l’économie capitaliste mondialisée que les exigences propres au procès de reproduction immédiat du capital.
Résumons. La « mondialisation » du capitalisme s’est d’abord réalisée sous la forme d’une internationalisation, non pas au sens du développement de relations purement externes entre des États-nations qui se seraient constitués indépendamment les uns des autres, en dehors de leurs rapports réciproques, pour n’entrer qu’ultérieurement et accidentellement en rapport, mais au sens d’un processus qui, dans le mouvement même où il unifie dans une certaine mesure l’ensemble de la planète dans et par un même marché mondial, la fragmente et la hiérarchise simultanément en ces unités sociales et politiques distinctes et tendant à l’autonomie que sont les États-nations, qui de surcroît se génèrent réciproquement à travers leurs rapports faits selon les cas de coopération, d’alliance, de concurrence, de rivalité et même, à l’occasion, de lutte à mort.
… à la transnationalisation
Au cours des années 1970, sur fond de crise du régime fordiste de reproduction du capital et pour répondre à cette crise, les états-majors des entreprises multinationales (des capitaux concentrés opérant sur le marché mondial) tout comme les gouvernements des États centraux et les institutions internationales chargées de la régulation de cette reproduction sur le plan mondial (Fonds monétaire international, Banque mondiale, etc.) vont mettre en œuvre un ensemble de nouvelles pratiques et politiques d’inspiration néolibérale qui va conduire à transformer la structure du monde capitaliste. La thèse ici soutenue est que cette transformation est en train de nous faire passer de la forme internationale de la structure du monde capitaliste à une forme transnationale. Ce que l’on dénomme improprement et confusément « mondialisation » ou « globalisation » est en fait une transnationalisation, au sens d’un mouvement qui traverse de part en part les États-nations, en les débordant aussi bien par le bas que par le haut, et qui tend par conséquent sinon à les détruire radicalement (bien que ce soit quelquefois aussi le cas) du moins à les invalider en tant que forme dominante et a fortiori exclusive de la médiation étatique. En bref, nous sommes en train d’assister au divorce du couple pluriséculaire État-nation.
 Le débordement des États-nations par le bas réfère au développement de la métropolisation qui remet en cause la cohérence socio-spatiale des États-nations et qui se rit bien souvent de leurs frontières. Différents travaux de géographie économique ont en effet mis en évidence que non seulement les investissements directs internationaux se localisent essentiellement dans les États de la triade Etats-Unis – Europe occidentale – Japon ainsi que dans les États semi périphériques proches qui leur sont associés (Mexique, Europe orientale et Bassin méditerranéen, Asie du Sud-Est, Chine et Inde) ; mais que, dans ces derniers eux-mêmes, ils tendent à se concentrer au sein ou au voisinage immédiat d’un petit nombre de grandes agglomérations et de leurs périphéries régionales immédiates. Jouent en ce sens tout à la fois : les économies d’échelle, qui réduisent les coûts de transaction entre les capitaux ainsi que les coûts des conditions générales extérieures de production et de circulation du capital ; la concentration en un même lieu des principaux facteurs nécessaires à la mise en œuvre de l’investissement (main-d’œuvre qualifiée, potentiel de recherche-développement, équipements collectifs et services publics de qualité) ; les effets de synergie entre les différentes entreprises et l’ensemble de ces facteurs sous forme de réseaux favorisant la circulation de l’information, la formation des personnes, l’innovation technique et scientifique, la constitution d’une culture d’entreprise et d’une éthique du travail abstrait, etc. Sans compter tout simplement l’ampleur du marché local ou régional. Si bien qu’en définitive, l’investissement attire l’investissement ; les entreprises multinationales attirent les entreprises multinationales. Et cela est encore plus vrai pour les centres mondiaux (les maisons mères) de ces dernières, qui se concentrent dans un petit nombre de métropoles mondiales.
Le débordement des États-nations par le bas réfère au développement de la métropolisation qui remet en cause la cohérence socio-spatiale des États-nations et qui se rit bien souvent de leurs frontières. Différents travaux de géographie économique ont en effet mis en évidence que non seulement les investissements directs internationaux se localisent essentiellement dans les États de la triade Etats-Unis – Europe occidentale – Japon ainsi que dans les États semi périphériques proches qui leur sont associés (Mexique, Europe orientale et Bassin méditerranéen, Asie du Sud-Est, Chine et Inde) ; mais que, dans ces derniers eux-mêmes, ils tendent à se concentrer au sein ou au voisinage immédiat d’un petit nombre de grandes agglomérations et de leurs périphéries régionales immédiates. Jouent en ce sens tout à la fois : les économies d’échelle, qui réduisent les coûts de transaction entre les capitaux ainsi que les coûts des conditions générales extérieures de production et de circulation du capital ; la concentration en un même lieu des principaux facteurs nécessaires à la mise en œuvre de l’investissement (main-d’œuvre qualifiée, potentiel de recherche-développement, équipements collectifs et services publics de qualité) ; les effets de synergie entre les différentes entreprises et l’ensemble de ces facteurs sous forme de réseaux favorisant la circulation de l’information, la formation des personnes, l’innovation technique et scientifique, la constitution d’une culture d’entreprise et d’une éthique du travail abstrait, etc. Sans compter tout simplement l’ampleur du marché local ou régional. Si bien qu’en définitive, l’investissement attire l’investissement ; les entreprises multinationales attirent les entreprises multinationales. Et cela est encore plus vrai pour les centres mondiaux (les maisons mères) de ces dernières, qui se concentrent dans un petit nombre de métropoles mondiales.
L’existence de tels centres urbains ou aires métropolitaines et, à défaut, leur création (difficile) constituent d’ailleurs aujourd’hui l’un des objectifs et l’un des instruments favoris des politiques d’attractivité des territoires pratiqués par les différents États-nations, mais aussi, de plus en plus, par les différents pouvoirs publics locaux (États fédérés, régions, districts urbains, grandes métropoles, etc.), qui sont ainsi mis systématiquement en concurrence sur le marché mondial des capitaux (des investissements directs internationaux). L’« attractivité d’un territoire », quel qu’il soit, dépend ainsi de plus en plus de l’existence en son sein de telles aires métropolitaines concentrant toute la panoplie des conditions (technico-scientifiques, économiques, politiques, culturelles) du développement capitaliste.
De ce fait, ce processus de métropolisation favorise le développement des régions où de tels districts existent ou parviennent à se former, tandis qu’il pénalise, au contraire, celles des régions qui en sont dépourvues. La mise en concurrence systématique des territoires reproduit nécessairement, au niveau des États centraux et semi périphériques qui en sont le champ, des phénomènes d’inégal développement, combinant surdéveloppement des uns et marginalisation tendancielle des autres, semblables à ceux que l’on observe au niveau mondial entre États centraux, États semi périphériques et États périphériques. Et on devine aisément que ce processus va à l’encontre de toute possibilité et en définitive de toute volonté d’assurer cohérence et équilibre dans la division spatiale du travail et, plus largement, dans le développement économique et social respectif des différents régions composant un même territoire national.
A quoi s’ajoute que de tels districts ou aires tendent de plus en plus souvent, dans les zones frontalières, à s’émanciper des frontières nationales en prenant un caractère directement transnational, en rapport d’ailleurs avec le développement transnational (sous forme d’alliances transnationales, d’accords transnationaux de sous-traitance ou de franchise, etc.) des entreprises qui viennent s’y établir. Ce que favorisent par ailleurs les intégrations continentales, autrement dit la constitution d’ensembles économiques continentaux.
Quant au débordement de l’État-nation par le haut, il réfère précisément à la constitution tendancielle de systèmes continentaux d’États. La formation d’un tel système répond cependant à un certain nombre de conditions parmi lesquelles doivent impérativement figurer :
-
une dynamique d’extension et d’intensification des relations économiques et culturelles entre un ensemble d’États-nations voisins, conduisant à une intrication (complexité) grandissante entre les différentes unités politiques qu’ils constituent ;
-
l’élaboration collective par ces États (leurs gouvernements respectifs) d’une série de normes communes (techniques, juridiques, administratives), la construction d’institutions communes, enfin le développement de politiques communes visant à réglementer et réguler les rapports entre eux, de manière à faire de l’ensemble tout à la fois une zone de paix (en rendant la guerre impossible entre eux), une aire de codéveloppement économique et social voire un foyer original de civilisation (sur la base de foyers antérieurs, historiquement constitués et renforcés) ;
-
enfin une politique extérieure commune sur les grands enjeux mondiaux (écologique, démographique, économique, politique, etc.), permettant aux instances représentatives du système d’État de parler d’une seule voix ; autrement dit, une dynamique tendant à l’élaboration et à la défense d’une politique extérieure commune, dans sa double face diplomatique et militaire, s’appuyant sur les institutions nécessaires à la mise en œuvre d’une telle politique.
Cela revient en définitive à dire que chaque système d’État peut et doit être considéré comme constituant, au moins potentiellement, le représentant et le défenseur de la fraction du capital mondial territorialisée en lui, comme cela a été le cas des différents États-nations lors de la période antérieure du devenir-monde du capitalisme. Autrement dit, ces systèmes d’États sont tendanciellement les analogues actuels et futurs des États-nations dont ils sont destinés à reprendre les fonctions relativement au procès global de reproduction du capital, dans un contexte qui ne permet plus à ces derniers de les remplir, et auxquels ils sont par conséquent tout aussi bien destinés à se substituer.
Au sein d’un tel système continental d’États, les différents États-nations ne sont pas placés sur un pied d’égalité. Au contraire, comme bien d’autres formes d’alliance, un tel système n’exclut nullement une hiérarchie entre ses différents membres : il peut très bien réunir une puissance centrale (ou un groupe de puissances centrales), des formations (États ou régions) semi périphériques au sein desquelles le mode capitaliste de production se diffuse rapidement, voire des formations (États ou régions) périphériques.

De tels systèmes vont en principe bien au-delà des simples accords, bilatéraux ou multilatéraux, de libre-échange entre États, tels que l’Accord de libre-échange nord américain (ALENA) entré en vigueur en 1994 entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ou la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) proposée par les États-Unis pour tout le continent américain ; au-delà même de la simple union douanière, telle que celle réalisée par le Mercosur. Ils ne se réduisent pas non plus à l’intégration régionale plus ou moins informelle telle que celle qui se dessine, par exemple, depuis trois décennies en Asie du sud-est dans le cadre de l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Un système d’États, tel que je l’entends ici, constitue non seulement un espace économiquement intégré, au sein duquel les marchandises et les capitaux peuvent circuler librement tout en se faisant concurrence, mais encore un espace institutionnellement unifié par une réglementation commune de cette circulation et de cette concurrence, dans le but de reconstruire, à un niveau supranational, une souveraineté étatique sur la sphère économique qui ne peut plus guère s’exercer au niveau national, vidée de contenu qu’elle a été à ce niveau par le processus de transnationalisation du capital. Si l’Union européenne remplit déjà la première de ces conditions, elle est très loin de satisfaire à la seconde ; et, d’ailleurs, les politiques néolibérales qui l’inspirent actuellement tournent radicalement le dos à un pareil objectif. C’est dire que, pour l’instant, le concept de système continental d’États précédemment exposé définit un possible, au mieux en cours de réalisation partielle. La thèse ou plutôt l’hypothèse ici avancée est que la transnationalisation du procès de reproduction du capital en rendra la formation à terme non seulement probable mais aussi, dans une certaine mesure, nécessaire dans les différentes occurrences évoquées précédemment et d’autres sans doute encore.
Dans le cadre de tels systèmes continentaux d’États, l’appareil d’État est amené à se démultiplier, les différents États nationaux qui en sont membres étant conduits à transférer, de gré ou de force, certaines de leurs fonctions et de leurs prérogatives antérieures soit à des instances supérieures (des instances supranationales, constitutives et représentatives du système continental d’États en tant que tel) soit à des instances inférieures (des instances infranationales, d’ordre régional ou local, pouvant elles-mêmes d’ailleurs revêtir une dimension transnationale, en liaison avec le développement des régions métropolitaines transnationales précédemment évoquées).
Une conclusion nette s’impose au terme de cet article. La première est que, loin de constituer cet espace parfaitement unifié et uniformisé ou tendant du moins à l’unification et à l’uniformisation économiques, politiques et culturelles que suggèrent les mots mondialisation et plus encore globalisation, la transnationalisation du procès global de reproduction du capital conduit à reproduire, sous une nouvelle forme, la structure caractéristique du monde capitaliste, faite d’homogénéisation tendancielle sans doute, mais aussi de fragmentation et de hiérarchisation, que présentait déjà l’ancien système des États-nations qu’elle tend à invalider. C’est cette continuité structurelle que l’usage des mots « mondialisation » ou « globalisation » masque sous l’apparence d’une discontinuité formelle. La raison ultime de cette permanence structurelle gît dans le capital lui-même comme rapport de production, impliquant avec la propriété privée des moyens de production l’expropriation des producteurs mais aussi la mise en concurrence systématique des capitaux singuliers. Autrement dit, il est impossible au capital d’unifier réellement le monde ; cette unification ne peut se faire que contre le capital et en dehors du capitalisme, soit au-delà de lui.
Ceci est une version abrégée de l’article « Mondialisation » parue dans La novlangue néolibérale, Éditions Page 2, Lausanne, 2007.
- Le premier âge du capitalisme – La Fronde - 25 mai 2020
- Les révolutions bourgeoises modernes : du projet au trajet - 27 novembre 2019
- Une première mondialisation - 4 avril 2019


