Le syndicalisme soviétique a-t-il existé ?
Lors du centenaire de la révolution russe, de nombreuses publications ont vu le jour, profitant de la distance avec cet événement décisif du XXe siècle, pour s’intéresser à différents aspects de l’histoire soviétique. Le sujet syndical est malheureusement trop souvent délaissé dans ces études. Pourtant, le syndicalisme, en Union soviétique et dans les pays placés directement sous son influence, a tenu rang de modèle pour plusieurs générations militantes partout dans le monde.
Ce texte a été écrit pour le numéro 143 des Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale, paru en 2017. Pierre Znamensky est membre du Bureau de l’IHS-CGT. Militant syndical internationaliste, il est plus particulièrement spécialiste du syndicalisme dans les pays de l’ex-URSS, ainsi que des arts et de l’iconographie soviétiques. Il est l’auteur de Sous les plis du drapeau rouge * et de Ave Lénine – Sovietart **. * Editions du Rouergue, 2010 ** Editions Galilée, à paraître en 2022

Le présent dossier ne prétend pas faire le tour du sujet, mais entend donner quelques clés de lecture et de compréhension du phénomène syndical dans le système soviétique. Il faut dire que le sujet est complexe : quelles étaient les caractéristiques du syndicalisme soviétique ? Peut-on d’ailleurs faire usage du singulier en le qualifiant, compte tenu des formes variées qu’il a prises au cours des différentes phases de son développement ? Nous proposons de nous attacher à trois étapes dans cette esquisse d’une étude du mouvement syndical dans le bloc soviétique :
- le mouvement syndical dans l’Empire russe entre 1900 et le début des années 1920, en nous intéressant notamment à sa place dans les révolutions de 1917 et dans les années d’expérimentation qui ont suivi ;
- les caractéristiques fondamentales de sa forme stabilisée entre le début des années 1920 et le milieu des années 1980 ;
- les conditions de sa transformation avant et après la chute du système soviétique, les bornes temporelles de cette troisième période allant des balbutiements de la fin des années 1970 au collapsus des années 1990.
Ce dossier ne se limitera pas à l’exemple russe, même si son étude est centrale et déterminante pour comprendre les formes et le type d’exercice du syndicalisme dans le contexte qu’il a largement contribué à façonner. Nous puiserons donc quelques exemples parmi les anciens pays du bloc soviétique, notamment dans la troisième partie, lorsque nous étudierons les trajectoires empruntées par les différentes organisations syndicales juste avant, au moment de la chute du système soviétique et dans les années qui ont suivi.
L’essor puis l’avènement du prolétariat organisé
Rien ne laisse imaginer, à l’aube du XXe siècle, que la classe ouvrière de l’Empire russe pourra, moins de vingt ans après le lancement du croiseur Aurore, s’engager avec succès dans une révolution prolétarienne débouchant sur la mise en place du premier État se revendiquant du socialisme. Certes, l’industrie se développe depuis les années 1880, mais le tsarisme maintient le pays dans une réelle arriération en comparaison des économies des empires français, britannique et allemand. En dehors de quelques grands centres urbains industrialisés – Moscou, Petrograd, Bakou, sur la Caspienne, les mines du Donbass en Ukraine, certaines régions polonaises, baltes ou finlandaises -alors sous domination russe-, l’Empire compte peu de concentrations prolétariennes. La Russie et ses « dépendances » sont encore largement agricoles, et les forces politiques révolutionnaires sont à la fois moins nombreuses que dans d’autres pays, mais aussi marquées par cette dominante paysanne. Les narodnikis (populistes), puis les socialistes-révolutionnaires (SR) surclassent les sociaux-démocrates marxistes du POSDR, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, dont l’aile la plus à gauche est conduite par Lénine. Les SR pratiquent une forme de propagande par le fait, multipliant les attentats contre les symboles ou les hommes incarnant l’autocratie tsariste, rappelant les actes des anarchistes en France à la même époque.

La scène syndicale s’en ressent : peu de secteurs industriels sont organisés avant le tournant du siècle. Seules quelques grandes corporations disposent de syndicats, comme les cheminots ou les postiers, avant que ne débute le XXe siècle. Il faut attendre le premier avertissement révolutionnaire de 1905 pour voir des syndicats professionnels se constituer en nombre conséquent, irriguant de nombreux secteurs dont la main-d’œuvre n’avait auparavant jamais été organisée: avec l’avènement des soviets à Petrograd et dans plusieurs autres grandes villes de l’Empire, des syndicalistes participent à la révolution et portent, dans les instances où ils sont élus, la défense de la condition ouvrière: dans le textile, l’imprimerie, l’ alimentation, la métallurgie, des syndicats se constituent. La fièvre s’étend aux marches de l’Empire, et l’on note aussi la constitution d’unions régionales de syndicats en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Russie blanche…
Mais l’expérience révolutionnaire tourne court, et la répression s’abat sur les militants, notamment sur les syndicalistes. Beaucoup sont emprisonnés, quelques-uns parviennent à échapper à la police tsariste et prennent les routes de l’exil. Parmi eux, Solomon Abramovitch Lozovsky, de son vrai nom Solomon Drizdo. Le parcours militant de Lozovsky, né en Ukraine en 1878 dans une famille juive pauvre, croise la CGT à de nombreuses reprises, et nous serons donc amenés à parler de lui à plusieurs moments de ce récit. Il adhère au POSDR en 1901 et rejoint la fraction bolchevique, derrière Lénine, deux ans après sa création en 1905. Il participe à la révolution de 1905 à Kazan, capitale du gouvernorat de Kazan, est arrêté en 1906 et exilé en Sibérie. En août 1908, il parvient à s’enfuir et rejoint les groupes de bolcheviks déjà nombreux à l’étranger. Francophone, il milite un temps à Genève avant de rejoindre Paris en janvier 1909. C’est là qu’il rencontre la CGT, en devient membre et adhère en même temps au Parti socialiste de France. Durant son long séjour en France (il ne rejoindra la Russie qu’au début du mois de mai 1917, entre les deux révolutions), il s’inscrira dans tous les débats qui animent la CGT dans ces années d’avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Il faut dire qu’il existe déjà, avant son arrivée, un terreau syndicaliste révolutionnaire russe en France. Dès le début des années 1890, des centaines d’ouvriers arrivent en France (mais aussi en Suisse, à La Chaux-de-Fonds dans l’industrie horlogère, et en Belgique, dans les usines d’armement de Liège) en provenance de l’Empire tsariste. À Paris et dans le département de la Seine, ils sont très nombreux à travailler dans l’industrie du textile, du cuir et des peaux. Souvent d’origine juive, mais très rarement pratiquants, ils militent dans l’ensemble du spectre socialiste : on trouve des anarchistes, des socialistes-révolutionnaires, des sociaux-démocrates (mencheviks comme bolcheviks après la scission de 1903), des bundistes. Chaque parti dispose de son groupe. Surtout, ces militants ont versé leurs forces dans le syndicalisme en France. On leur doit la création du Syndicat des ouvriers casquettiers du département de la Seine en 1895. Le poids des ouvriers juifs russes est tel dans cette organisation, que la bannière du syndicat est alors rédigée en français et en yiddish.
Si Lozovsky est bolchevik avant même son arrivée en France, il étudie avec passion les organisations françaises auxquelles il adhère. Il est séduit par l’héritage syndicaliste révolutionnaire de la CGT des années 1900, dont les traces sont encore présentes, même si elles s’estompent, dans ces instants d’avant-guerre. Solomon Lozovsky assistera alors à plusieurs réunions des instances dirigeantes de la CGT, pour le Syndicat des casquettiers ou la Fédération du cuir. Il l’avouera lui-même : son militantisme syndical déteint sur son militantisme politique, et il sera même exclu du parti bolchevik en 1914. Il soutient alors une position dite de conciliation : comme tous les socialistes internationalistes et futurs zimmerwaldiens [1], il dénonce les sociauxchauvinistes et la course à la guerre, mais ne veut pas dans le même temps abandonner l’objectif d’unir tous les socialistes. S’il ne veut pas rompre tous les ponts avec ceux qui se fourvoient dans l’Union sacrée, c’est aussi par loyauté envers la CGT, que sa direction d’alors entraîne vers un soutien au conflit [2].
Mais revenons à la Russie des années précédant la révolution. Nous l’avons vu, la répression est d’autant plus forte que le régime, chancelant en 1905, se sent fragile. Elle emporte les noyaux syndicaux qui avaient pu se constituer autour de la première expérience de constitution de soviets. On ne verra guère émerger de nouveau le mouvement syndical avant la révolution de 1917. Le syndicalisme est interdit, beaucoup de militants sont en prison ou en exil, et le marasme politique règne sur fond de déliquescence et de décadence de l’ autocratisme tsariste. Deux secteurs échappent à ce sombre tableau : celui des chemins de fer et celui des postes. L’étendue de l’Empire russe rend ces deux professions essentielles à la survie du régime, lequel tolère donc un activisme corporatiste acceptant d’abandonner toute perspective de révolution immédiate en échange d’améliorations de la condition des travailleurs de ces deux secteurs. Lorsque l’on trouve des militants socialistes dans ces structures, ils sont au mieux mencheviks, et cela s’en ressentira jusqu’après la révolution d’octobre 1917, les syndicats de cheminots et de postiers étant ceux qui sont le plus longtemps restés dominés par le parti menchevik.
La léthargie syndicale provoquée par la répression se renforce, à partir de 1914, par la saignée de la Première Guerre mondiale. Les hommes, très majoritairement des paysans, mais aussi des ouvriers des grands centres urbains, sont envoyés sur le front, et les usines sont dépeuplées de leur main-d’œuvre masculine. Pour compenser cette saignée prolétaire, les industriels font largement appel aux femmes. Cela explique sans doute que le mouvement syndical ne soit pas un moteur des révolutions de 1917. Si la Révolution de Février démarre par une grève des ouvrières des quartiers industriels de Petrograd, les forces militantes de la révolution ne prennent pas pour base les structures syndicales, quasiment inexistantes, mais les organisations politiques et les unités de l’armée stationnées en ville. Le prolétariat prend une part décisive dans la lutte, mais il est orphelin d’une organisation syndicale structurée et cohérente.
La chute rapide du tsarisme, l’effervescence produite par l’expérience des soviets et les difficultés économiques permettent cependant de combler rapidement ce relatif vide originel. « Par le bas », on observe la mise en place de comités d’usine et d’un contrôle ouvrier de la production. Les soviets s’étendent de facto aux usines. Celles-ci envoient leurs délégués dans les soviets politiques, mais elles constituent également leurs propres soviets, chargés de libérer la parole des travailleurs de chaque établissement, mais aussi de jouer un rôle dans la gestion de l’usine alors que les propriétaires ont déguerpi et que les chefs d’atelier et les contremaîtres sont chassés. On élit ceux qui acceptent de se voir confier des responsabilités de gestion, on contrôle la manière dont ils s’acquittent de leurs mandats.
Or cette autogestion ouvrière est spontanée, elle ne figure dans le programme d’aucun parti révolutionnaire. Le pouvoir politique a été arraché par la révolution des mains du tsarisme en février, de celles du gouvernement provisoire en octobre, le pouvoir économique est arraché des mains de la bourgeoisie par les comités d’usine au cours de 1917 et 1918. L’aspiration à l’autogouvernement des usines est profonde parmi les travailleurs: elle est une réplique de la demande d’une démocratie politique réelle et contamine la quasi-totalité des entreprises. L’effondrement de la production et les éventuels actes de sabotage des anciens contremaîtres ne facilitent pas la tâche des comités d’usine, qui restent néanmoins très populaires. Jusqu’en 1921, d’ailleurs, cette configuration perdurera, et le nouveau pouvoir ne parviendra que difficilement à mettre fin à cette ébullition ouvrière dans les usines. Dans cette situation très chaotique, Lénine doit revisiter la question syndicale. Il renforce encore sa conviction que le syndicat doit être un outil d’affirmation de l’autorité du parti sur la classe ouvrière. La neuvième des vingt et une conditions fixées à l’entrée dans l’Internationale communiste est le reflet de cette prise de conscience: «Tout parti désireux d’ appartenir à l’Internationale communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats, coopératives et autres organisations des masses ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés dont le travail opiniâtre et constant conquerra les syndicats au communisme. [… ]. Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l’ensemble du Parti. » Dans un tel contexte, les syndicats, dont Lénine écrit qu’ils sont« l’école du communisme», seront en fait l’instrument de la mise au pas des comités d’usine.

Le modèle soviétique stabilisé
Ainsi prend fin cette première étape du mouvement syndical soviétique. Sa deuxième grande période s’ouvre alors qu’il porte dans son ADN une caractéristique fondamentale liée aux circonstances de son redéploiement en 1920-1921 : le syndicalisme se voit confier une mission de maintien de l’ordre social dans les entreprises. Avec l’expérience des comités d’usine qui se referme, le syndicalisme peut se concentrer sur les fonctions que lui confère le pouvoir politique. Il profite aussi de la force d’attraction et de l’élan que provoque la révolution russe au sein du prolétariat mondial pour créer, sous l’impulsion du Komintern – l’Internationale communiste-, une Internationale syndicale rouge (ISR, appelée en russe Profintern). La création du Profintern va conduire à la scission de nombreuses organisations syndicales en Europe de l’Ouest. La CGTU décide en 1922 d’adhérer à l’ISR ; c’est d’ailleurs sur cette question de l’affiliation internationale que s’opère la scission de la CGT. Nous recroisons ici le chemin de Solomon Lozovsky. Celui qui fut pendant huit ans militant de la CGT, dirigeant d’un de ses syndicats et d’une de ses fédérations, sera, de sa création jusqu’à sa dissolution en 1937, pendant seize ans, le secrétaire général de l’Internationale syndicale rouge. Dans l’intervalle, entre ses responsabilités en France et à la tête de l’ISR, il aura contribué à refonder la Fédération russe des ouvriers du textile, dont il sera secrétaire général de 1918 à 1921, en assurant dans le même temps les fonctions de président de l’Union régionale des syndicats de Moscou.

Si la feuille de route du mouvement syndical soviétique est clairement tracée par le parti, sa réalisation n’est pas toujours évidente: la fièvre révolutionnaire entretenue par les comités d’usine mettra du temps à retomber. Les derniers comités subsisteront jusqu’en 1927-1928, avant d’être remplacés par les Profkom (les comités syndicaux), qui ne sont pas habilités à mettre directement en cause les directions d’usine, les choix politiques et économiques, ni autorisés à organiser les travailleurs dans un mouvement de grève. Le modèle socialiste confiait à l’organisation syndicale unique dans chacun des pays du bloc soviétique une triple fonction parfaitement délimitée :
- une fonction sociale, par le biais de la gestion directe du patrimoine social des entreprises. Ce dernier allait bien au-delà des emblématiques camps de pionniers, de loisirs, de sports ou de repos. Le système de protection sociale reposait en effet quasi intégralement sur les entreprises (ou les administrations dans leur qualité d’employeurs) à qui revenait la charge d’entretenir les institutions de santé (hôpitaux, cliniques, sanatoriums … ) et d’assistance sociale (crèches… ), et de redistribuer les pensions à leurs anciens salariés retraités. Les syndicats prenaient une part très active dans la gestion de l’ensemble de ces fonctions sociales, en les assumant parfois directement ;
- une fonction économique, essentiellement symbolisée par une double intervention syndicale, d’une part dans la gestion du personnel (embauches, promotions… ), d’autre part dans une mission de stimulus de la production (mobilisation des ressources humaines dans la réalisation du Plan, primes… ) ;
- une fonction politique, le syndicat étant intégré dans les rouages du pouvoir. La frontière entre le parti, l’État et l’organisation syndicale était inexistante, et les parcours individuels pouvaient passer sans aucune difficulté des uns aux autres. Pendant toute la période socialiste, les ministres « sociaux » (Travail, Affaires sociales, Santé… ) voire « économiques » (Plan, Industries de branche) ont ainsi majoritairement été choisis parmi les dirigeants du syndicat.
Les missions sociales rendues par le syndicat sont appréciées par les travailleurs, mais elles ne suffisent pas toujours à désamorcer les situations tendues et difficiles. Les grèves continuent ainsi à exister, même si elles sont interdites et ne sont jamais organisées par le syndicat, même si celui-ci tente parfois de jouer un rôle de médiation. Dans le Conseil central panrusse des syndicats, créé en 1918 (VTsSPS selon son acronyme en russe et rebaptisé Conseil central des syndicats soviétiques en 1924) pour confédérer les organisations syndicales existant au niveau des branches et des territoires, des débats existent cependant. Tomsky, le secrétaire général du VTsSPS, s’oppose ainsi à Lozovsky, secrétaire général du Profintem, dans un discours et une brochure de 1926, parce qu’il le juge trop conciliant à l’égard des sociaux-réformistes [3]. Lozovsky quittera d’ailleurs en 1937 toutes ses responsabilités dans le mouvement syndical, alors que Staline prend la décision de dissoudre l’Internationale syndicale rouge. Profondément internationaliste et francophile, Lozovsky avait beaucoup contribué au rayonnement de l’ISR.
Lozovsky ne reviendra jamais vers le syndicalisme. Entre 1937 et la fin de la guerre, il est employé au ministère des Affaires étrangères. Sa connaissance de la France et des langues latines est employée notamment lors de la préparation de la conférence de Yalta. Après la guerre, il milite au comité antifasciste juif, mais celui-ci devient la cible de Malenkov [4] en 1949. Comme d’autres responsables de ce comité, Lozovsky est arrêté le 26 janvier, exclu du Parti dans la foulée et attend plusieurs années son jugement Celui-ci intervient au début juillet 1952: il est condamné à mort et fusillé le 12 août 1952. Ses derniers mots seront :« Un jour, il deviendra clair que je ne suis pas coupable; je demande alors que l’on me réintègre à titre posthume dans les rangs du Parti.» Ni la CGT, ni la CGT-FO n’émettent la moindre déclaration devant l’exécution d’un ancien membre du CCN. Lozovsky est réhabilité en 1955, de même que tous les condamnés à mort du dernier procès stalinien.
Les conséquences de la chute du système soviétique sur le syndicalisme
On peut considérer que la troisième grande période du syndicalisme soviétique commence dès les années 1970. Si elle semble prendre fin avec sa disparition formelle en 1992, on peut néanmoins considérer qu’elle engendre des suites, tant l’héritage soviétique marque les organisations syndicales qui en sont issues. Les années 1970 sont celles, en URSS, mais aussi et surtout dans plusieurs démocraties populaires, notamment en Pologne (avec Solidarnosc) et en Tchécoslovaquie (autour de la Charte 77), de l’émergence d’un syndicalisme de contestation se développant en dehors des structures syndicales officielles. En Russie, cette place est principalement occupée par le SMOT [5].
Les organisations syndicales officielles réagissent souvent aux côtés du pouvoir, mais tentent aussi parfois de se poser en interlocuteurs des travailleurs qui tentent de s’organiser en dehors d’elles. Les contacts que le syndicalisme institutionnalisé du bloc soviétique a pu nouer avec des organisations syndicales à l’Ouest ou dans les pays du Sud ne l’aident malheureusement pas à appréhender ces nouveaux phénomènes, et le dialogue est parfois difficile sur ces sujets, même lorsque les relations d’amitié et de confiance sont fortes. La transition vers l’économie de marché des anciens pays socialistes a bien évidemment profondément bouleversé les conditions d’exercice du syndicalisme et accéléré l’émergence d’un syndicalisme alternatif. Dans le même temps, l’héritage soviétique comporte des rémanences, y compris auprès des organisations syndicales qui s’en défendent et se sont même construites en opposition déterminée par rapport à l’ancien système.

À partir de 1989, dans un contexte de transition vers l’économie de marché, cet héritage historique a pesé lourd dans le repositionnement des centrales syndicales de l’Est. Deux types d’organisations syndicales se sont en général affrontées : les organisations filles des anciens syndicats uniques, et les syndicats indépendants, qui s’étaient souvent donné pour mission première la mise à bas des régimes politiques de ces pays. Sur le plan des comportements, les deux ensembles ont revendiqué leur part d’héritage en cherchant à préserver ou regagner leurs positions dans les trois champs décrits ci-dessous :
- sur le plan social, l’empire des ex-syndicats uniques a certes rapidement fondu. Ils ont dû se séparer d’un certain nombre d’infrastructures, soit par nécessité, soit par pure recherche du profit, soit parce qu’ils en ont été spoliés par les jeux et les appétits prédateurs du « marché ». Cependant, ils disposent encore, dans bien des cas, de plusieurs centaines de camps de loisirs et ont souvent procédé à la création de compagnies de voyage et de tourisme utilisant pour bases les infrastructures survivantes (Bulgarie… ). En ce qui concerne leur intervention dans le système de protection sociale, les syndicats ont en général perdu, avec la privatisation des entreprises, la gestion directe de la plupart des hôpitaux, des crèches… En revanche, certains ont participé à la privatisation du système des retraites en constituant leurs propres fonds de pension, qu’ils emballent parfois du qualificatif de « mutuelles ». Enfin, par la négociation avec l’État, ils ont, dans certains cas, conquis des positions de passage obligé (accès aux indemnités de chômage… ) ;
- sur le plan économique, il ne reste quasiment rien, en Europe de l’Est, de la capacité d’intervention des syndicats dans la marche économique des entreprises. Excepté dans les pays de l’ex-URSS, ils n’assurent plus leurs fonctions antérieures de direction officieuse des ressources humaines dans l’entreprise ;
- sur le plan politique, il n’existe évidemment plus de syndicat unique d’État en Europe de l’Est. La position d’interlocuteur privilégié du pouvoir des ex-syndicats uniques a rapidement été contestée par de nouvelles organisations, notamment ces syndicats prétendument indépendants lorsqu’il s’agissait de contester le régime en place, mais entretenant eux-mêmes des liens d’extrême proximité avec des forces du champ politique. Les nouveaux comme les anciens syndicats ont donc tous cherché à jouer un rôle dans le jeu politique nouvellement institué de ces pays.
Un demi-siècle d’économie centralisée de type soviétique et un quart de siècle de marche forcée vers le capitalisme ont fortement conditionné l’évolution du mouvement syndical est-européen, en imprimant un certain nombre de pratiques et de comportements forts éloignés des interventions habituelles d’une organisation syndicale. Beaucoup de syndicats de l’Est ne conçoivent leur action que dans une recherche permanente des positions de pouvoir, qu’il soit économique (au sein des entreprises) et surtout politique (au sein de la société tout entière). Cette tentation politique, ce tropisme politique frôlant parfois la caricature sont d’autant plus forts que le pays se situe plus à l’Est. L’ancienne Union soviétique occupe la première place dans la course à l’intégration institutionnelle du syndicalisme. Mais cette situation n’est pas propre aux pays de l’ex-URSS. Elle peut être observée, à des degrés divers, dans la plupart des pays de l’ancien bloc de l’Est : transformation de Solidarnosc en parti politique au tournant des années 1990 en Pologne, soutien politique musclé des syndicats de mineurs au pouvoir en place en Roumanie au début des années 1990, élection de dirigeants syndicaux au sein du Parlement bulgare, nombreuses passerelles entre syndicalisme et monde politique en Hongrie. Néanmoins, depuis quelques années, ces pratiques s’estompent en Europe de l’Est au profit d’un repositionnement sur des activités plus « naturellement » syndicales. La plupart des organisations syndicales de l’Est, y compris les anciens syndicats uniques, ont déjà fait évoluer leur référentiel en replaçant la représentation des salariés, la revendication et la négociation au centre de leurs valeurs fondamentales.
Mais elles souffrent toutes d’un niveau de syndicalisation en chute libre par rapport à celui qui prévalait durant la période soviétique. Par ailleurs, les pays issus de l’ancien bloc soviétique connaissent tous un faible niveau de négociation collective. Les pays de l’Est, notamment, pratiquent tous une forme très décentralisée de négociation. La plupart des questions soumises à la négociation collective sont donc traitées au niveau de l’entreprise, y compris celles du salaire, du temps de travail, de l’emploi et des conditions de travail. La faiblesse du niveau sectoriel ou intersectoriel est due aux pauvres capacités institutionnelles mises en place sur les décombres de l’ancien système. Le cadre légal est souvent incomplet, l’État peinant à l’achever alors que, dans le même temps, certains pays sont encore attachés à la mise en place d’un dialogue social tripartite. Paradoxalement, il n’est ainsi pas rare de voir l’État (ou les pouvoirs locaux) s’inviter à la table de négociation au niveau de l’entreprise, voire au niveau de la branche. La vitesse des changements économiques, avec une phase de privatisation qui s’est étalée sur toute la décennie 1990, explique également cette primauté de l’entreprise dans les niveaux pratiqués de négociation.
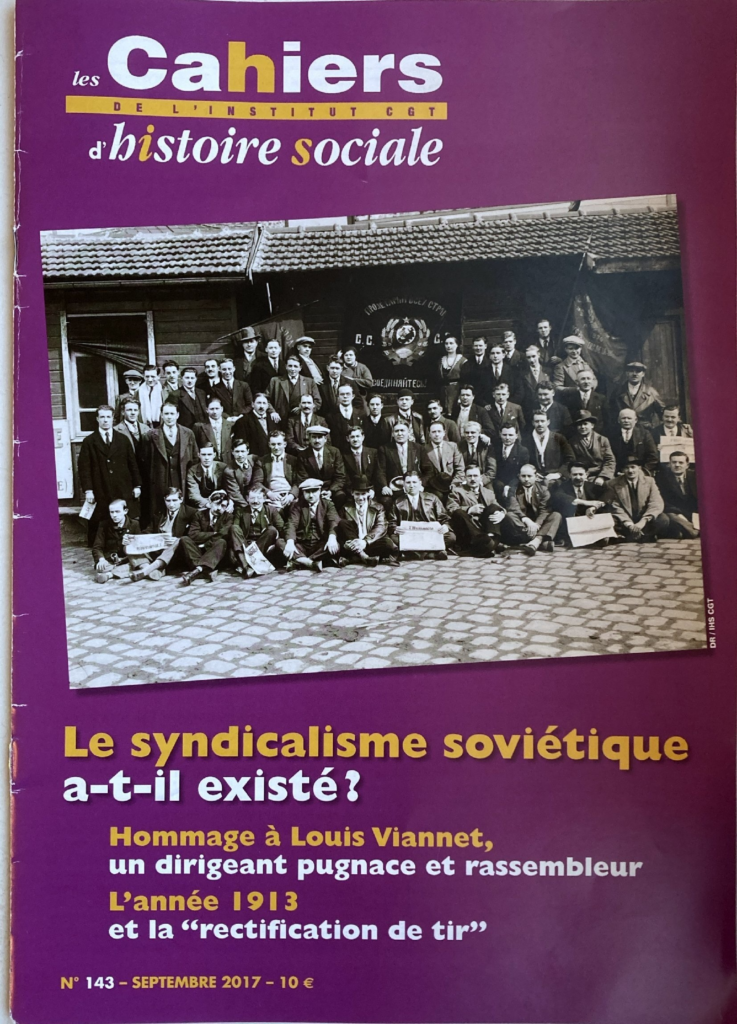
En ce qui concerne les taux de couverture de la négociation collective, on observe une même situation de faiblesse à l’Est. Moins d’un salarié sur trois est couvert par un accord collectif dans la population active des pays de l’Union européenne anciennement socialistes, contre près de trois sur quatre parmi les salariés des pays d’Europe de l’Ouest. En matière de représentation des salariés, on relève aussi un contraste majeur entre les ex-modèles ouest et est-européens. Parmi les pays issus de l’ex-URSS, notamment, quasiment aucun ne dispose d’institution représentative du personnel, telle que nous l’entendons en France. Ces pays ne prévoient que le canal syndical pour représenter les salariés dans l’entreprise, certains syndicats ayant même réagi avec méfiance aux tentatives d’introduction de comités d’entreprise ou équivalents. Il en résulte que les syndicats sont la forme prédominante, voire unique, de représentation des salariés sur le lieu de travail. Certains pays connaissent un pluralisme syndical (Pologne, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Lituanie); d’autres sont dominés par une grande confédération (Estonie, République tchèque et Slovaquie, Slovénie, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, Moldavie) avec, dans certaines variantes, des organisations sectorielles ou des organisations concurrentes plus petites (Russie, Ukraine, Bélarus, Kazakhstan).
Avec la « transition », soulignons également que les organisations syndicales de l’Est ont connu une baisse très importante de leur nombre d’adhérents, a fortiori si on le compare aux chiffres revendiqués par les anciennes centrales uniques. Il convient de préciser que cela n’est pas uniquement dû à la perte du monopole syndical. L’adhésion, même si elle était recommandée, n’était cependant pas obligatoire dans le contexte soviétique. Mais le syndicalisme a beaucoup souffert des dégâts économiques et sociaux provoqués par la conversion forcée au capitalisme: désindustrialisation, récession économique, pertes massives d’emplois, désintérêt pour le syndicalisme ont pénalisé tant les anciennes que les nouvelles structures syndicales, à un moment où elles n’avaient jamais été aussi nécessaires pour la défense des travailleurs et de leurs familles.

En un siècle d’existence, le syndicalisme dans les pays de l’Est a traversé trois grandes périodes: sous le tsarisme, dans le contexte soviétique et face au chaos du capitalisme sauvage. Ces grandes phases ont été déterminées par deux transformations majeures: celle engendrée par les révolutions de 1917 et celle provoquée par la contre-révolution libérale de 1989 à 1991. Pour répondre à la question titre, un seul mot suffit sans doute : oui, le syndicalisme soviétique a existé, avec une forme et une finalité tout à fait particulières, extraordinairement contraintes par la nature du régime et par les rapports que l’un et l’autre entretenaient. En contrepartie d’une absence de libertés politiques mais aussi syndicales (refus du pluralisme syndical, inexistence d’un droit effectif de grève), il a joué un rôle économique et social apprécié des populations, le transformant en modèle pour certains, en épouvantail pour d’autres. Le recul nous permet aujourd’hui de regarder son histoire avec la volonté de tirer expérience des pages qu’il a écrites.
Pierre Znamensky
[1] La conférence de Zimmerwald (Suisse) a réuni, en 1915, des internationalistes opposés aux politiques d’Union sacrée mises en œuvre par la majorité des partis socialistes et confédérations syndicales des pays en guerre [Note Les utopiques].
[2] Salomon Abramovitch Lozovsky, Rabotchaya Frantsiya (La France laborieuse), GIZ, I 923, I 40 pages.
[3] Mickaïl Tomsky, Le parti et les syndicats, GIZ, p. 45.
[4] Georgui Malenkov (1901-1988), très proche de Staline, était à cette date secrétaire du comité central du Parti communiste et vice-président du gouvernement [Note Les utopiques].
[5] Union interprofessionnelle libre des travailleurs, créé, dans l’illégalité, en 1978 (donc avant Solidarnosc en Pologne), fortement réprimé par le pouvoir : arrestations, déportation dans des camps, internements en hôpital psychiatrique, expulsions du pays… , es initiateurs sont rapidement arrêtes, déportés dans des camps, internés en hôpital psychiatriques, expulsés [Note Les utopiques].
