Ecologie : sous la transition, la déprivatisation
Chômage de masse, chômage des jeunes, chômage des seniors, précarité du travail féminin : la question du travail est si prégnante, si centrale et si sensible en France qu’elle recouvre parfois toute la question sociale.
Les défenseurs de la transition écologique/énergétique promettent la création de centaines de milliers d’emplois « verts », par l’essor de nouvelles activités (énergies renouvelables, efficacité énergétique, dépollution, démantèlement nucléaire, …), la relocalisation de la production (agriculture, agro alimentaire, …), les activités de résilience (care, réparation/entretien…). Mais leur poids économique est encore très faible. En France, on constate tous les jours les blocages contre la fiscalité écologique (contribution climat énergie, écotaxe), le soutien aux énergies fossiles, les mille et un obstacles au développement des éoliennes, le mépris pour la maîtrise de l’énergie et les actions d’efficacité énergétique, la politique d’aménagement du territoire qui bétonne tous azimuts.
Ce n’est pas qu’une affaire de création de valeur monétaire et de retour sur investissement. C’est aussi, peut-être surtout, un affrontement entre deux visions du monde: De quoi avons-nous vraiment besoin? Comment se libérer du libéralisme existentiel et de l’individualisme consumériste? Le micro-geste fait-il la révolution?
1° De quoi avons-nous vraiment besoin ?
En 1884, le socialiste utopiste William Morris prononce une conférence restée célèbre –et publiée en français par Serge Latouche il y a quelques années : « Comment nous pourrions vivre ».
Plus d’un siècle plus tard, nous pourrions reformuler la question : de quoi vraiment ne pourriez-vous pas vous passer pour vivre ?
En 1875, Karl Marx écrivait dans la Critique du programme de Gotha l’un de ses plus célèbres passage: « quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital ; quand, avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l’horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : “ De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !” »
À chacun selon ses besoins : c’est exactement ce qu’on ne peut plus demander aujourd’hui. A cause du dérèglement climatique, de la pollution généralisée des airs et des mers, des extinctions massives d’espèces qui manifestent les limites de notre monde. À chacun selon ses besoins, cet idéal était progressiste et libérateur sur une planète peu industrialisée et peu urbanisée, apparemment illimitée. Il devient conservateur et régressif alors que notre globe se réchauffe dangereusement et que si nous vivions tous comme des Américains, il nous faudrait cinq planètes. Les impacts que nos modèles de vie infligent à notre écosystème menacent plus particulièrement certaines personnes (habitants des zones polluées, côtières, des régions arides), créant une nouvelle forêt d’inégalités. Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise climatique. Certains en souffriront davantage. La satisfaction des besoins supposés des uns dégrade les conditions d’existence des autres. Elle endommage aussi le cadre de vie des générations futures.
C’est intenable. On ne peut plus séparer les faux besoins des vrais, mais on ne peut pas satisfaire tous les besoins. Cette impasse théorique nous verrouille dans un dilemme infini. Irrésolu, ce problème nous empêche d’agir.
Il faudrait donc penser autrement. Par exemple, au lieu de s’interroger sur nos besoins, se demander si cette question n’est pas complètement absurde. Quelle prétention d’abord, à croire que nous savons ce qu’il nous faut. Que nous sommes lucides et bien informés sur ce sujet impossible. Que nous sommes des acteurs rationnels, capables de prendre les bonnes décisions. Que nous avons toujours raison, que nous ne nous trompons jamais. N’est-ce pas exactement le mensonge du néolibéralisme, qui ne voit les humains que comme des mécaniques douées de faculté d’analyse, sans considération pour leur situation inégalitaire face à ce choix ? Quel aveuglement ensuite à imaginer que ce choix n’appartient qu’à chacun d’entre nous. Comme si nos actes n’avaient pas de conséquences sur le reste du monde, comme s’ils n’étaient que pure abstraction. N’est-ce pas la définition même du déni de réalité ? L’affirmation d’une folie ? Et qu’est-ce qui m’empêche de vouloir contribuer positivement à mon monde : de quoi le reste du monde a-t-il besoin, venant de moi ? Pourquoi cette question-là ne pourrait-elle pas être la bonne ?
Pour beaucoup d’entre nous, la liberté, c’est faire ce qu’il nous plaît. Et pourtant, à la lecture des lignes qui précèdent, on devrait défendre l’inverse. C’est la croyance erronée que nous sommes des individus libres et autonomes qui nous assomme en nous coupant de notre milieu : les autres humains, la nature, les générations futures. Sans conscience de la relation d’interdépendance qui nous lie à notre environnement, nous nous croyons seuls au monde. Mais cette distance nous est préjudiciable car elle nous prive d’un pouvoir : « celui de comprendre son milieu et d’y agir », résume le philosophe Stéphane Haber.
On peut ainsi reformuler le problème initial : laissons tomber la théorie des besoins, et changeons de paradigme. C’est une affaire d’« empowerment », de reprise de pouvoir sur sa propre vie. Pourquoi ? D’abord, comprendre notre milieu et tenter d’agir changerait notre échelle de valeurs. Valoriser l’attention au monde, la préservation de ses richesses naturelles, la sobriété énergétique, la solidarité internationale, la générosité intergénérationnelle nous libèrerait de l’omniprésente injonction à la performance comme principal critère de réussite sociale. Mais surtout, nous ne serions plus isolés face à ce système de valeurs. La violence du néolibéralisme naît de l’individualisation des contraintes. L’adoption de ces critères alternatifs d’appréciation, à l’inverse, collectiviserait la charge. La société tout entière deviendrait responsable de leur accomplissement, puisque seule l’action collective pourrait prétendre y parvenir. Nous en partagerions nécessairement l’effort les uns avec les autres – reste à voir dans quelles conditions d’égalité. Je, tu, il, elle, nous ne sommes pas des îles, un continent isolé du reste de l’univers. Cette représentation s’épuise. Rien ne garantit que cela suffise à réduire nos impacts environnementaux. En revanche, cela promet de nous soulager de l’enfer de la pression sociale au succès individuel.
2. Se déprivatiser
 Entendue ainsi, l’écologie n’a plus rien à voir avec les stéréotypes sur le retour à la bougie, les écolos chevelus et les sorcières décroissantes. Elle invite à une philosophie de vie dissidente de la doxa néolibérale que l’on pourrait résumer en une formule lapidaire : il faut nous déprivatiser. En finir avec le dogme de l’espace privé inaliénable et imperméable à son extérieur. Faire de la place au public dans notre intimité. Penser des formes de socialisation de soi. Se transporter d’un monde individuel à un monde commun. Ma chaudière est un scandale politique. Ça se passe chez moi, dans mon salon, dans mes factures de gaz, dans les tuyaux les plus planqués de mon sous-sol mais c’est un souci collectif. Mes actes, vos actes, notre problème.
Entendue ainsi, l’écologie n’a plus rien à voir avec les stéréotypes sur le retour à la bougie, les écolos chevelus et les sorcières décroissantes. Elle invite à une philosophie de vie dissidente de la doxa néolibérale que l’on pourrait résumer en une formule lapidaire : il faut nous déprivatiser. En finir avec le dogme de l’espace privé inaliénable et imperméable à son extérieur. Faire de la place au public dans notre intimité. Penser des formes de socialisation de soi. Se transporter d’un monde individuel à un monde commun. Ma chaudière est un scandale politique. Ça se passe chez moi, dans mon salon, dans mes factures de gaz, dans les tuyaux les plus planqués de mon sous-sol mais c’est un souci collectif. Mes actes, vos actes, notre problème.
Se déprivatiser, mais comment faire ? Le mot n’existe même pas dans le dictionnaire. De plus en plus de chercheurs s’intéressent à la recomposition du partage entre la sphère du privé, ce qui est propre à une personne, et celle du public, commune aux membres d’une même société politique. En juillet 2013, l’Association française de sciences politiques y consacrait une partie de son congrès annuel. Ses organisateurs croient distinguer « un double mouvement de publicisation du privé et de privatisation du public qui nous invite à repenser la bipartition classique ». Il se manifeste dans les questions sexuelles et familiales (procréation, parentalité, identité sexuelle, genre), de santé, sur internet par l’exposition plus ou moins volontaire de données personnelles… Fondatrice de la pensée libérale et de la philosophie des Lumières, la distinction entre public et privé se brouille tout autour de nous, pour le meilleur et pour le pire, et pas qu’en matière d’écologie.
Les luttes féministes des années 1960 et 1970 ont ouvert le foyer familial au champ politique. La contraception, le droit à l’avortement, la violence conjugale, le partage des tâches à domicile sont grâce à elle devenus des objets légitimes de politiques publiques. De la même manière que la maîtrise de l’énergie, le tri et la réduction des déchets par les ménages sont désormais requis par la puissance publique.
Il existe un autre épisode historique, plus lointain, marqué par la volonté de tirer le miel citoyen de la vie intime des gens en créant littéralement des sentiments politiques : la Révolution française. La mémoire populaire retient en général la religion civile défendue par Robespierre autour de « l’être suprême ». Le décret du 18 Floréal an II instaure un système de religion nationale destiné à préserver les citoyens de la manipulation de leurs affects par les ennemis de la révolution, et les asseoir dans la vertu.
Ce n’était pas qu’une poussée déiste, mais un véritable projet de gouvernement des passions, explique l’historienne Sophie Wahnich. Les révolutionnaires cherchaient un moyen de relier intimement leurs contemporains à la révolution. Cette ambition semble habitée par le spectre inquiétant du contrôle des âmes. Mais elle porte aussi une vision viscéralement démocratique : l’idée que, face à la tyrannie, chacun peut se soulever et résister par la seule force de son sentiment de liberté.
Cette période est précieuse entre toutes à étudier car elle « est réputée être celle de l’avènement de l’individu » remarque la chercheuse, selon qui, pendant ces années tourbillonnantes, plusieurs conceptions de l’individu cohabitaient : « l’individu comme être politique individué, comme membre d’un collectif politique et comme personne privée indépendante ». Dans ce contexte, les sentiments révolutionnaires ne servent pas seulement de ressorts éventuels de contrôle social. Ils offrent de vraies perspectives de subjectivation : en se sentant libre et membre actif du peuple souverain, l’individu devient un citoyen politique capable de s’autodéterminer. Il entre ainsi de plein pied dans la communauté révolutionnaire. C’est une expérience sensible, incarnée. Sophie Wahnich cite ainsi une lettre envoyée aux parlementaires français en 1792 par Thomas Mercer, le président d’une assemblée d’habitants de Recovery, province d’Ulster en Irlande, accompagnée d’un « don patriotique » de 153 guinées : « Notre but est de fortifier et d’augmenter dans nos coeurs l’attachement inaltérable aux vrais principes de cette constitution libre. »
Saint-Just écrit dans ses Fragments d’institutions républicaines : « La patrie n’est point le sol, c’est la communauté des affections ». Il veut créer des institutions civiles autour de l’école et des fêtes : « Il faut que vous fassiez une cité, c’est-à-dire un peuple de citoyens qui soient amis, hospitaliers et frères ». Pour la chercheuse, c’est un discours de la « regénération » : « les citoyens doivent retrouver les qualités sensibles et pratiques qui peuvent fonder la civilité du genre humain. Il s’agit de faire entrer la Révolution dans les moeurs ». Amis, hospitaliers et frères : ces qualités sont d’ordre privé, mais sont aussi entendues dans leur dimension publique.
Pour les révolutionnaires, devenir « frères » produit des effets de responsabilité politique et sociale, ajoute l’historienne, et crée un lien entre les citoyens, « un lien qui ne devrait pas facilement se défaire puisqu’on l’espère à la fois intériorisé comme nécessité sociale et politique et en lui-même comme garantie sociale et politique ».
Condorcet parlait de « raison sensible ». La Révolution française fut la matrice de nouveaux types de rapports entre les personnes, égalitaires et réciproques. Quel en serait l’équivalent de nos jours pour refaçonner les relations à notre environnement ? Une gigantesque marée noire ? Après la méga fuite de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon de Shell au large de la Floride en 2010, Barack Obama parla d’un « 11 septembre de l’écologie ». Cette déclaration ne fut suivie d’aucun effet notable sur la politique climatique américaine. Faudrait-il une révolution environnementale en Chine, contre l’autoritarisme, la corruption et la pollution ? L’établissement d’une République des « humains et non humains » dans les pays amazoniens ? Outre le constat que ces perspectives paraissent bien lointaines aujourd’hui, rien ne garantit qu’elles ébranleraient les sociétés des pays industrialisés.
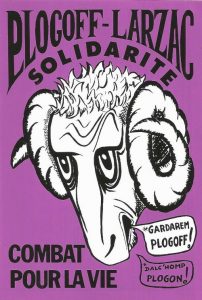 Parce que le système carbone et la culture du CO2 qui caractérisent nos pays riches depuis la révolution industrielle sont tellement imbriqués en nous-mêmes, l’analogie révolutionnaire du despote à renverser ne fonctionne pas. Nous sommes collectivement par nos pensées, par nos affects, dans notre subjectivité la plus profonde, le coeur même de ce système de pollution. On ne peut s’abattre soi-même autrement qu’en se suicidant. Mais on n’est pas obligé de réduire le legs révolutionnaire à sa brutalité belliqueuse. La camaraderie, la subjectivation dans l’émotion dont parle Sophie Wahnich ne sont pas seulement produites par l’insurrection contre le tyran. Elles se nourrissent de ce savant tissage entre vie personnelle et émancipation collective. Pour installer la nouvelle organisation de l’Etat, pour en garantir la pérennité, les révolutionnaires ont édicté de nouvelles règles de vie : la fête républicaine, la généralisation du tutoiement, l’adresse aux pairs comme « citoyens ». L’histoire de la Révolution française fut à l’évidence une affaire de pouvoir d’Etat. Cela n’empêche pas que cette volonté d’ancrer dans les corps et les sens la nouvelle société permise par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen trace un chemin pour ceux, plus de deux siècles plus tard, qui rêvent de modes d’existence moins prédateurs et plus solidaires, y compris avec les êtres non humains. Et si nos petites vies personnelles, nos vies minuscules, pouvaient être le laboratoire d’une nouvelle organisation de la société ? Fabriquer du sensible politique et faire advenir, peu à peu, un autre monde où l’être humain ne se situerait plus au centre de toutes choses. On pourrait alors imaginer une politique des modes de vie.
Parce que le système carbone et la culture du CO2 qui caractérisent nos pays riches depuis la révolution industrielle sont tellement imbriqués en nous-mêmes, l’analogie révolutionnaire du despote à renverser ne fonctionne pas. Nous sommes collectivement par nos pensées, par nos affects, dans notre subjectivité la plus profonde, le coeur même de ce système de pollution. On ne peut s’abattre soi-même autrement qu’en se suicidant. Mais on n’est pas obligé de réduire le legs révolutionnaire à sa brutalité belliqueuse. La camaraderie, la subjectivation dans l’émotion dont parle Sophie Wahnich ne sont pas seulement produites par l’insurrection contre le tyran. Elles se nourrissent de ce savant tissage entre vie personnelle et émancipation collective. Pour installer la nouvelle organisation de l’Etat, pour en garantir la pérennité, les révolutionnaires ont édicté de nouvelles règles de vie : la fête républicaine, la généralisation du tutoiement, l’adresse aux pairs comme « citoyens ». L’histoire de la Révolution française fut à l’évidence une affaire de pouvoir d’Etat. Cela n’empêche pas que cette volonté d’ancrer dans les corps et les sens la nouvelle société permise par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen trace un chemin pour ceux, plus de deux siècles plus tard, qui rêvent de modes d’existence moins prédateurs et plus solidaires, y compris avec les êtres non humains. Et si nos petites vies personnelles, nos vies minuscules, pouvaient être le laboratoire d’une nouvelle organisation de la société ? Fabriquer du sensible politique et faire advenir, peu à peu, un autre monde où l’être humain ne se situerait plus au centre de toutes choses. On pourrait alors imaginer une politique des modes de vie.
Je me souviens d’une discussion en octobre 2011 avec un opposant au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Antoine, un grand jeune homme barbu arrivé de Saint-Denis, vivait depuis plusieurs mois au sein de l’un des groupes affinitaires occupant la « Zone d’aménagement différé », la « Zad », les hectares de parcelles réservées pour la construction de la future aérogare. Il s’était installé au campement du « Far ouezt », planté à l’orée d’une forêt. Une plateforme en bois construite autour d’un arbre nous observait de toute sa hauteur. En bas, du linge séchait et des vélos s’étalaient par terre. « Ils nous endorment, crétinisent, aménagent. Ya basta ! » proclamait le panneau d’accueil.
Ici, il faut tout repenser, m’expliquait Antoine. Ce sont deux révolutions à mener en même temps : la lutte contre l’aéroport et le système économique et politique qu’il représente, d’un côté, et la bataille d’une vie collective réfléchie, dans l’autogestion, et la recherche de l’autosuffisance, de l’autre. Repenser le partage des tâches pour éviter les inégalités de genre. Se débarrasser des addictions anciennes, sans oublier le café et l’alcool. Eviter les transactions monétaires en pratiquant le prix libre (celui qui achète donne ce qu’il peut ou veut). S’organiser sans avoir de chef ni de représentant. Et sans trop se spécialiser afin de ne pas devenir irremplaçable. Chercher de l’eau. Trouver de la paille pour isoler les cabanes. Eviter le plus possible l’agglomération nantaise, proche, rebaptisée « Babylone » par certains, qui la voient comme une capitale maléfique. Pour ses nouveaux habitants, la Zad, c’était aussi la « Zone d’expérimentation d’autres modes de vie », ou la « Zone d’autonomie définitive ». Mais Antoine insistait : il ne voulait pas y rester enfermé. S’il avait refusé de « s’installer en yourte dans les Cévennes », c’était justement pour garder des contacts, avoir du passage, et bouger.
Il n’y a ni bonne, ni mauvaise terre, il suffit de savoir s’adapter à son environnement, témoignait pour sa part « JB », chanteur et comédien originaire de Dijon converti aux travaux des champs pour un autre collectif, Le Sabot, organisé autour d’un vaste potager. Pour le cultiver sur ces terres argileuses gorgées d’eau, les néoagriculteurs ont dû apprendre à cultiver en butte pour protéger les racines des carottes et des pommes de terre d’un trop plein d’humidité. Résultat, des dizaines de mètres de rangées de légumes vendus à prix libre pour nourrir la lutte. Il fut détruit par l’assaut des gendarmes lors de l’opération avortée d’évacuation de la zone lors de l’automne 2012.
Ce qui compte, c’est la réappropriation militante de ces terres, affirmait un autre occupant, Rody, 45 ans, venu de Nantes, qui avait ouvert une chèvrerie avec sa compagne et les enfants de cette famille recomposée, dont un petit d’un an. À ses yeux, la récupération de biens publics, c’est le temps fort de cette lutte. Mais attention aux malentendus. Elever des chèvres ne faisait pas de lui « un néo-babacool en pull de laine ». Il insistait sur sa proximité avec les mouvements zapatistes, et les luttes dans les pays arabes. S’inscrivait dans ce monde, ni exclu, ni marginal. Voulait agir « global ». Pas seulement pour lui-même mais pour une alternative au système économique dominant.
Autre lieu, autre milieu, et même force d’interpénétrations entre bouleversement personnel et changement social. En janvier 2012, dans la banlieue de Nancy, je rencontre les résidents d’un lotissement de maisons individuelles qui veulent rénover eux-mêmes leurs logements pour les rendre plus économes en énergie. Ce projet sort du lot, car au royaume de la propriété privée, ces voisins autogèrent leur chantier et l’organisent selon des principes solidaires. Nous nous retrouvons le soir, dans le salon de Jacques, l’un d’entre eux, au coin du poêle à granulés qui chauffe désormais son salon rénové. Les récits de chantier abondent. Ils ressemblent à mille autres banales histoires de travaux. Mais ce qui change ici, dans ce quartier tranquille de Villers-lès-Nancy, c’est qu’avec la rénovation, s’est déclenché chez eux un processus de réflexions politiques. « On vit différemment dans la sobriété énergétique, explique Francis Lacour, à l’origine du projet. C’est venir à pied à une réunion quand il pleut. Se demander si on va garder son lave-vaisselle. Ce sont des petites choses, le souci de réorienter les pratiques ordinaires. »
Pour lui, la rénovation du lotissement de Clairlieu, c’est aussi une manière de créer du commun dans ce bastion de la propriété individuelle. « On essaie de monter notre propre régie d’électricité. On change de rapport à notre maison. La maison de Jacques lui appartient. Mais c’est aussi celle de tout le monde quelque part, puisqu’on vient tous y travailler. » Claude, retraité d’EDF, sourit : « L’autre jour, on a dit à Jacques qu’il n’y avait plus de café chez lui. Il s’est excusé ! »
Ancien cadre technique en ascenseur pour OTIS, actuellement en pré-retraite, Patrick confie : « Je ne suis pas écolo à 100 %, acheter une voiture électrique ne m’intéresse pas et le nucléaire ne me dérange pas. Mais je veux m’affranchir de l’électricité et du gaz. Etre autonome. EDF et GDF font des bénéfices sur le dos des gens au-delà de ce qui est permis ! Le prix du gaz est indexé sur celui du pétrole alors que ça n’a rien à voir. » Il compte alors entreprendre la complète rénovation de sa maison : façade, toiture, eau chaude solaire et capteurs photovoltaïques sur le toit. Budget prévu : environ 60 000 euros. Aujourd’hui, il dépense environ 2 500 euros par an en gaz et en électricité. Après travaux d’isolation, il compte ne plus payer que 400 euros par an, soit moins du tiers de ses factures précédentes.
Ancienne de la SNCF, Marie-France, 67 ans, raconte : « J’ai défait la laine de verre sous la toiture de Jacques. Avec une autre dame, on l’a roulée et emportée à la déchetterie. C’est notre participation. Pour moi, la rénovation thermique, c’est un échange et une entraide. On fait ça pour se rendre service. Je viens de la campagne, où on s’entraide beaucoup. Ça me manque en ville. » Marcel, son époux, ajoute : « Ecolo, moi ? Pas du tout ! Mais à partir du moment où une solution technique permet de consommer moins d’énergie et d’utiliser des matériaux moins polluants, ça me paraît intéressant. »
Je relis ces témoignages et je suis frappée par leur ressemblance avec ceux des « tuneurs », alors mêmes que leurs modes de vie s’opposent : on retrouve la même énergie personnelle, le même courage d’invention au quotidien et le même désir de façonner son mode de vie à l’image de ses propres valeurs. Consumérisme, néolibéralisme, aveuglement environnemental : quelle que soit la puissance de ces phénomènes anthropologiques, leurs effets ne sont ni définitifs, ni absolus. Matrice déterminante du déni d’écologie, la sphère individuelle reste un espace d’invention de soi. Une scène de résistance et de créativité. Nos modes de vie ne sont donc pas ataviques. Ils ne sont pas fixés par l’ordre du monde. Ils sont malléables. Il en existe plusieurs usages possibles. Se penser, se construire comme usagers, revient à s’envisager soi-même par rapport aux autres. C’est jouer collectif, prendre en compte les autres. C’est une esquisse de politique.
Oui, ça vous complique la vie de multiplier les critères de décision de vos choix de vie. Mais ça vous donne de l’air. Vous reprenez de la force de décision sur votre quotidien. Comme lorsque vous quittez EDF pour un fournisseur d’énergie verte et vous approvisionnez en électricité de source renouvelable. C’est une rupture de ban, une sortie du jeu. A condition de ne pas se laisser bercer par l’illusion du développement durable, de ne pas croire qu’il suffira d’agir un peu différemment, un peu plus vertement. Mais que ce doit être le début d’autre chose. Une forme douce de boycott. Une petite brique pour contribuer à un changement de système. Comme enfiler un préservatif pour ne pas contaminer son partenaire ou attraper une maladie sexuellement transmissible : votre précaution personnelle n’arrêtera pas l’épidémie. Mais elle limitera sa prolifération. C’est insuffisant, mais c’est le minimum requis.
3. Le micro geste fait-il révolution ?
La révolution du micro geste ? L’écologiste radical Derrick Jensen en hurlerait probablement de rire. Depuis près de vingt ans, il proteste contre l’inaction de ses contemporains tandis que forêts et espèces animales disparaissent. Contre l’écocide, il appelle à renverser tout le système, et rien que le système. Par tous les moyens nécessaires et sans autres formes de diversion. « Une personne saine d’esprit penserait-elle que récupérer les déchets des poubelles aurait arrêté Hitler, ou que composter aurait mis fin à l’esclavage, ou obtenu la journée de travail de huit heures, ou que faire son bois et porter son eau aurait libéré les prisonniers des prisons tsaristes, ou que danser nu autour d’un feu aurait défendu la loi sur les droits civiques de 1964 ? demande-t-il. « Alors pourquoi, alors que le sort du monde est en jeu, autant de gens s’en remettent à des « solutions » entièrement personnelles ?»
La charge est dure, et ces comparaisons historiques cruelles. A première vue. Car Jensen oublie un détail : le Reich nazi et la tyrannie tsariste s’imposaient aux sociétés par la force, la violence d’Etat et la terreur, alors que le déni de l’écologie se fabrique en nous. Aucun automobiliste ne remplit son réservoir un pistolet de Total ou de Shell sur la tempe. Aucun touriste ne prend l’avion sous la menace de la déportation de sa famille en camp de travail. Un activiste climatique berlinois, Tadzio Muller, le ramasse en une formule digne d’un mafioso : « On ne nous fait pas chanter, on nous achète ».
Nous ne combattons pas un ennemi extérieur, un système abstrait tombé de l’espace. Nous nous affrontons aux effets plus ou moins directs de notre civilisation. Pour mettre à bas le patriarcat, les féministes n’ont pas seulement exigé le droit de vote puis la contraception et l’avortement. Elles ont imposé de nouvelles normes de vie domestique et continuent de se battre pour les faire respecter. Leur sphère individuelle est remplie de préoccupations collectives. Elles n’ont pas non plus entrepris d’éliminer tous les mâles de la surface de la planète. Ces femmes et ces hommes renversent un système de pouvoir en le tordant de l’intérieur, en s’y imposant, en se gagnant le respect et le crédit qui leur a si longtemps été refusé. Ils défont l’oppression en la minant depuis son coeur, pas en cherchant à éradiquer les oppresseurs.
Certaines réunions tupperware, en apparence bien innocentes, furent d’utiles lieux d’échange et de prise de conscience. Et en écologie ? Le promeneur parisien découvrant par hasard une manif de vélos bloquant la circulation au début des années 1970 aurait-il imaginé que quarante ans plus tard, la capitale se doterait d’une politique volontariste de réduction de la place de la voiture en ville en créant un système de partage de bicyclettes, en traçant des pistes cyclables sur ses principaux axes et en supprimant les voies sur berges ? Les constructeurs de maisons solaires passaient pour des Martiens dans les années 1960. Ils ont inspiré les politiques d’efficacité énergétique qui révolutionnent aujourd’hui l’habitat en généralisant les bâtiments basse consommation et même les maisons à énergie positive. Les automobilistes qui roulent à l’huile de frites font rigoler dans les auberges où ils passent récupérer les résidus de cuisine. Mais ils expérimentent une des plus sérieuses alternatives à l’essence et gasoil, alors que les agrocarburants, facteurs trop aggravant des crises alimentaires et sociales des pays pauvres, perdent en crédit. Les commerces spécialisés en produits à base de plantes semblaient réservés aux hypocondriaques dans les années 1980. Trente ans plus tard, les enseignes bio constituent un florissant business et modifient les pratiques de consommation d’une partie des classes moyennes des pays riches.
 Oui, le néolibéralisme a intérêt à concentrer la critique sur les gens, leurs modes de vie, et pas sur le système. C’est toujours ça de gagné pour les industriels, les banquiers et les multinationales. Mais à court terme. Car les normes sociales évoluent : plus les citoyens adapteront leurs gestes routiniers à leur souci de leur environnement, plus ils seront susceptibles d’exiger des comptes de leurs dirigeants. Ce ne sera pas automatique, et des familles continueront de se nourrir bio pour préserver leur santé sans se soucier de celles des agriculteurs et de l’écosystème qui a produit ces aliments. Ils ont tort ? C’est à cela que doit servir la bataille politique des usages des modes de vie : informer, expliquer, alerter, organiser, révolter. Semer des graines de dissidence. Provoquer des discussions et des rassemblements contre la tendance à l’isolement des personnes et à la destruction des collectifs. Agir sur soi pour ne pas rester seul.
Oui, le néolibéralisme a intérêt à concentrer la critique sur les gens, leurs modes de vie, et pas sur le système. C’est toujours ça de gagné pour les industriels, les banquiers et les multinationales. Mais à court terme. Car les normes sociales évoluent : plus les citoyens adapteront leurs gestes routiniers à leur souci de leur environnement, plus ils seront susceptibles d’exiger des comptes de leurs dirigeants. Ce ne sera pas automatique, et des familles continueront de se nourrir bio pour préserver leur santé sans se soucier de celles des agriculteurs et de l’écosystème qui a produit ces aliments. Ils ont tort ? C’est à cela que doit servir la bataille politique des usages des modes de vie : informer, expliquer, alerter, organiser, révolter. Semer des graines de dissidence. Provoquer des discussions et des rassemblements contre la tendance à l’isolement des personnes et à la destruction des collectifs. Agir sur soi pour ne pas rester seul.
- L’esclavage républicain - 25 février 2019
- Nos Nuits Debout en Avignon - 22 octobre 2018
- Les complémentaires santé, chevaux de Troie des attaques contre l’assurance maladie …? - 18 juin 2017



