Les révolutions bourgeoises modernes : du projet au trajet

La conquête par la bourgeoisie de sa position de classe dominante a été un processus pluriséculaire : pour nous limiter au seul continent européen, il s’étend du Moyen Âge central à l’époque contemporaine. Processus complexe et tortueux, il a mêlé en permanence de lentes évolutions et des phases plus ou moins longues de stagnation et même quelquefois de régression à de brutales accélérations. Celles-ci ont correspondu à des épisodes révolutionnaires, généralement brefs (de quelques années à quelques décennies) et violents (prenant la forme de guerres civiles, compliquées quelquefois d’interventions étrangères), fréquemment interrompus par des menées contre-révolutionnaires ou suivis de périodes de restauration plus ou moins longues.

De tels épisodes ont ponctué l’ensemble du processus, de ses origines (cf. les « révolutions communales » des cités marchandes d’Italie du Nord au 12e siècle) jusqu’au début du 20e siècle (cf. les révolutions russes de 1905 et février 1917) – pour me limiter au continent européen. Certains des États absolutistes qui se sont érigés dans l’Europe moderne en ont connu. Ainsi en a-t-il été de l’Espagne habsbourgeoise : siège en l’une de ses dépendances de la première révolution bourgeoise réussie des temps modernes, qui aura coïncidé avec la première phase (1566-1609) de la longue lutte qui aura permis à la partie septentrionale des Anciens Pays-Bas de conquérir son indépendance sous forme des Provinces-Unies, elle aura encore connu différentes autres poussées révolutionnaires à composante bourgeoise dans les années 1640-1650 (révolution catalane de 1640-1652, soulèvements de Naples et de Sicile de 1647-1648), toutes avortées par contre. Ainsi en a-t-il été également de l’Angleterre des Stuart, dont le règne a été compromis entre 1642 et 1660 par une révolution bourgeoisie inachevée, dont l’œuvre se poursuivra lors de la « Glorious Revolution » orangiste de 1688-1689. Mais la France aura également vu par deux fois les poussées bourgeoises contenues (pendant les guerres de Religion de la seconde moitié du 16e siècle, pendant la Fronde entre 1648-1653) avant que ne s’y produisent les bouleversements de la fin du 18e siècle qui passeront longtemps pour l’archétype de la révolution bourgeoise et inspireront tant d’autres processus révolutionnaires jusqu’à nos jours.
Il est possible de proposer une sorte d’idéal-type qui pourra servir de guide dans l’analyse des différentes révolutions bourgeoises des temps modernes – les seules auxquelles je m’intéresse ici. En restant cependant toujours attentif aux singularités de leurs circonstances et de leur cours, en définitive commandé par l’évolution des rapports de forces entre les différentes classes sociales.
Le projet idéal des révolutions bourgeoises
Aucune révolution bourgeoise n’a jamais correspondu à la mise en œuvre méthodique d’un projet de transformation sociale préalablement mûrement élaboré, ne fût-ce que dans ses grandes lignes. Si des acteurs, individuels ou collectifs (des groupes, des mouvements, des « partis »), y sont intervenus en y mettant en œuvre, de manière déterminée, des programmes quelquefois précis, le cours global de la révolution les a toujours largement dépassés, en les contraignant le plus souvent à improviser dans le feu des événements, et ses résultats n’ont que très partiellement correspondu à leurs attentes et souhaits. Cependant, pour rendre intelligible un pareil processus par définition chaotique, il faut commencer par imaginer qu’il en aille autrement : définir en quelque sorte le projet (pour ne pas dire le programme) d’une révolution bourgeoise pure et parfaite, soit la totalité des objectifs à réaliser pour assurer définitivement à la bourgeoisie dans son ensemble la position de classe dominante. Encore faut-il préciser qu’il s’agit de raisonner ici dans le seul cadre des sociétés ouest-européennes protocapitalistes, pour la plupart prises dans les rets d’États absolutistes.
Sur le plan socioéconomique, les révolutions bourgeoises visent à lever les obstacles institutionnels (juridiques, administratifs, constitutionnels) au parachèvement des rapports capitalistes de production. Il s’agit donc, en premier lieu, de promouvoir une réforme agraire qui s’en prenne aux reliquats des formes précapitalistes de propriété foncière, en remettant en cause tant les privilèges seigneuriaux issus du féodalisme (en matière juridique et fiscale) que les formes de tenure liant le paysan à la terre (garantissant ses droits de possession sur la terre qu’il exploite) ainsi que les droits (de glanage, de chaumage, de vaine pâture, d’affouage, etc.), souvent plus anciens encore, des communautés paysannes sur l’ensemble des terres et notamment les communaux. Cette réforme cherche à dissoudre juridiquement les communautés rurales et à précariser fondamentalement le rapport des paysans à la terre. Elle vise encore à transformer la rente foncière féodale (ou ce qu’il en reste) en rente capitaliste, autrement dit sa transformation de rente en nature et en travail en rente en argent, en créant de surcroît un marché de la terre et de sa location de manière à réduire autant que possible le taux de la rente. De la sorte, il s’agit enfin de faire baisser le prix des produits agricoles, notamment alimentaires, et par conséquent la valeur de la force de travail.
En deuxième lieu, plus largement, il s’agit de créer les conditions de l’expropriation généralisée des producteurs (paysans et artisans) et du développement d’un marché du travail, sous couvert de la « liberté du travail » qui sera essentiellement la liberté d’exploiter le travail d’autrui. Ce qui passe une nouvelle fois par la destruction de ce qui reste de l’organisation féodale, tant à la campagne (les reliquats des communautés rurales et de leurs droits) qu’à la ville (le régime des corporations), et de ce qu’elle offrait de protection aux producteurs immédiats, en les assurant de leur lien (volontaire ou contraint) avec les moyens de production et de subsistance.
En troisième lieu, il s’agit de parachever la création du marché capitaliste au niveau national, en procédant à l’unification matérielle, administrative et fiscale du territoire, de manière à permettre à toutes les marchandises de circuler librement et à tous les capitaux de pouvoir s’investir et se désinvestir librement en tout lieu et dans toutes les branches de production. Ce qui implique de mettre fin aux multiples particularismes et privilèges locaux, qu’ils aient été hérités du féodalisme et conservés à ce titre dans le cadre des États absolutistes ou qu’ils aient été une pure création de ces derniers. Et, par conséquent, cela implique, le cas échéant, de s’en prendre aux privilèges et monopoles que certains éléments de la bourgeoisie marchande (commerciale et financière) ont pu en obtenir ou y acquérir, aussi bien qu’à ce qui peut rester des différents privilèges et monopoles seigneuriaux.
En quatrième et dernier lieu, il s’agit de procéder à une réforme des finances publiques, en mettant notamment fin aux privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé (ce qui revient tout simplement à abolir ces deux ordres) mais aussi en plaçant ces finances sous le contrôle d’assemblées représentatives, seules habilitées à voter l’impôt et à déterminer la nécessité ou l’opportunité d’engager des dépenses publiques. Et, là encore, le cas échéant, il peut être question de s’en prendre à certaines positions privilégiées d’éléments de la bourgeoisie marchande, par exemple ceux qui se sont assuré des fermes fiscales.
Sur le plan sociopolitique, une révolution bourgeoise consiste à passer d’un « ancien régime » dans lequel une partie de la bourgeoisie constitue un élément du bloc au pouvoir, mais dans une position subalterne (l’hégémonie étant détenue par l’aristocratie nobiliaire plus ou moins fusionnée avec la grande bourgeoisie marchande), à un « nouveau régime » caractérisé par le fait que le bloc au pouvoir intègre désormais l’ensemble de la bourgeoisie, en y confiant à une fraction d’entre elle la position hégémonique, tout en continuant à y intégrer la ci-devant noblesse « embourgeoisée », en ne lui réservant cependant plus qu’une position secondaire.
Ainsi une révolution bourgeoise transforme-t-elle plus ou moins profondément le contenu de classe de l’État (la composition du bloc au pouvoir : les éléments constitutifs de ce bloc et les rapports de forces entre eux). Et, de ce fait, bien souvent, elle en modifie aussi la forme constitutionnelle (passage d’une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle ou même à un régime républicain : donc passage de la souveraineté monarchique à la souveraineté populaire par institution d’assemblées représentatives élues au suffrage censitaire d’abord, universel par la suite) ainsi que l’organisation institutionnelle (sa composition en appareils et les rapports entre eux). Ce qui implique notamment de parachever l’État de droit, en supprimant les privilèges juridiques et judiciaires de la noblesse et du clergé, en protégeant strictement les biens et les personnes de tout abus de pouvoir de la part des gouvernants, en garantissant une parfaite liberté de conscience et d’expression à chacun et, plus généralement, en établissant l’égalité de tous les citoyens face à la loi et au droit, réputée condition à la fois nécessaire et insuffisante pour chacun de faire valoir ses talents et son mérite.
Sur le plan idéologique. Enfin, les révolutions bourgeoises sont toujours aussi des phases d’intenses bouillonnements culturels, donnant lieu à toutes sortes d’innovations et expérimentations sur le plan des idées, des formes d’expressions artistiques, des modes de vie aussi. En un mot, ce sont aussi des révolutions culturelles : on voit y émerger des nouvelles manières de penser, de sentir, d’agir et de vivre, de se rapporter au monde, aux autres et à soi-même.
On connaît la thèse gramscienne selon laquelle une révolution politique (bourgeoise ou prolétarienne) doit être préparée de longue date par une lente mais sûre conquête de l’hégémonie culturelle au sein de la société. Et nous verrons comment, en effet, en leur temps et dans leur langage propre à chaque fois, la Renaissance, la Réforme et les Lumières ont contribué à cette conquête de l’hégémonie culturelle de la bourgeoisie, souvent bien au-delà de ses propres frontières de classes, en rendant ainsi possibles ses poussées révolutionnaires, sans nécessairement suffire à en garantir le succès cependant.
Mais, au cours de ces épisodes révolutionnaires, idées et idéaux connaissent le plus souvent une radicalisation qui leur fait prendre des formes originales et inattendues en même temps qu’elles s’enrichissent de contenus nouveaux, révélant des potentialités insoupçonnées. Ainsi, pendant la Révolution anglaise, dans certains milieux de la Réforme radicale (les anabaptistes, les quakers), au nom de la liberté de conscience, des voix s’élèvent pour remettre en cause non seulement la fidélité des Écritures aux paroles du Christ mais même l’existence de l’au-delà, ouvrant ainsi la voie à l’athéisme. Ou encore, pendant la Révolution française, la liberté politique nouvellement conquise conduit aux premières revendications féministes (celles d’une Olympe de Gouges par exemple) tout comme à l’abolition de l’esclavage (à Saint-Domingue notamment). Certaines de ces innovations resteront éphémères et ne survivront pas à l’épisode révolutionnaire, surtout si celui-ci se conclut par la victoire de la réaction ou une restauration de l’ « ancien régime » ; d’autres au contraire laisseront des traces plus durables. Toutes prépareront cependant les épisodes révolutionnaires suivants.
Le trajet chaotique des révolutions bourgeoises
Le cours d’une révolution bourgeoise des temps modernes, comme de toute révolution d’ailleurs, est tout sauf celui d’un long fleuve tranquille. Il est au contraire nécessairement chaotique, marqué par des rebondissements inattendus, des renversements d’alliances, des revirements de position, etc. Cependant, là encore à des fins d’intelligibilité, on peut tenter de schématiser ce cours sous forme d’un parcours typique, comprenant différentes étapes qui sont autant d’épreuves cruciales, pouvant interrompre le processus ou même le renverser. En fonction de leurs spécificités propres, des révolutions bourgeoises ont pu multiplier les méandres entre ces différentes étapes tout comme, au contraire, elles ont pu en chevaucher plusieurs à la fois voire en brûler certaines ou même les sauter. Ce schéma se centre exclusivement sur la question sociale (les luttes de classes), en ignorant délibérément et la question nationale (car, dès cette époque, les révolutions bourgeoises ont pu se conjuguer avec des mouvements visant à réaliser l’indépendance protonationale d’une formation sociale) et la question religieuse (les problèmes relatifs à la coexistence des différentes confessions).
Première étape. Le démarrage de toute révolution bourgeoise est le résultat immédiat d’une crise conjoncturelle de l’État absolutiste, venant brutalement aggraver une crise structurelle antérieure (liée aux contradictions permanentes de ce type d’État) et précipiter des évolutions potentiellement catastrophiques jusqu’alors contenues. Cette crise conjoncturelle, par définition imprévisible et survenant le plus souvent à la surprise générale, peut être de nature fort diverse : une situation de vacance du pouvoir (la santé physique ou mentale du roi le rend incapable de gouverner, sa mort laisse un dauphin ou une dauphine trop jeune pour régner et ouvre une période de régence par définition favorable aux intrigues et aux chocs des ambitions) ou de crise dynastique (différents prétendants se disputent), des émeutes antifiscales, une brutale défaillance financière (la dette publique atteint un niveau tel que le pouvoir ne peut plus recourir à ses moyens et expédients financiers ordinaires et doit se déclarer en faillite), la révolte face à l’adoption de mesures de persécution religieuse, une défaite militaire grave dans un conflit extérieur, etc.
Pour qu’un tel événement déclenche un processus révolutionnaire, il faut cependant qu’il provoque une conjonction de mécontentements au sein de l’ensemble des classes et ordres à l’égard de l’absolutisme, par ailleurs très divers dans leur contenu et dans leur forme. Du coup, le crédit du pouvoir absolutiste se trouve d’autant plus sûrement affaibli, en conduisant à sa paralysie temporaire, l’empêchant ou le dissuadant de réagir à sa contestation par voie répressive, sauf peut-être face aux exactions accompagnant les « émotions populaires ». Mais la diversité même de ces mécontentements peut rendre leur convergence sur un certain nombre de revendications et d’objectifs difficile voire impossible. Si cette situation de dispersion persiste, le processus révolutionnaire à peine entamé se consume en un tumulte désordonné d’émeutes isolées, facilement réduites ou réprimées, de revendications particulières sans concrétisation et d’ambitions personnelles rapidement dévoyées. Et le processus révolutionnaire, qui n’a pas même encore affirmé clairement son caractère bourgeois, avorte à peine esquissé, en permettant au régime absolutiste non seulement de se rétablir mais encore de se renforcer. La Fronde offre l’exemple typique d’une telle révolution bourgeoise avortée.
Deuxième étape. Pour que la première étape du processus révolutionnaire, qui n’est jamais qu’un prélude, s’achève d’une manière positive et permette à ce processus de se poursuivre, il faut que les différents mécontentements provoqués par la crise de l’absolutisme convergent en une même revendication de contrôle du pouvoir d’État par une assemblée (des états généraux, un parlement, une diète) représentative des différents ordres et classes. Sous la pression du mécontentement, le pouvoir monarchique doit accepter de convoquer une telle assemblée, si celle-ci préexiste au sein de l’Ancien Régime (et c’est généralement le cas), laquelle se trouve du coup revivifiée et renforcée, ou il doit en accepter l’institution.
Ainsi s’entament la mise sous tutelle du monarque et la transition de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle (impliquant l’élaboration d’une constitution par l’assemblée représentative), généralement doublée de la remise en cause des privilèges jusqu’alors accordés au clergé et à la noblesse par l’intermédiaire d’une réforme de la fiscalité, de la justice et de l’administration. Deux des traits essentiels, les plus symboliques, de l’ « ancien régime » : les ordres et la monarchie absolue se trouvent ainsi abolis. Et dans l’ambiance unanimiste qui règne alors, confortée par l’espoir d’une amélioration générale de la situation né de ce profond renouvellement des institutions, il n’est pas rare d’assister au ralliement au processus révolutionnaire d’une partie de la noblesse qui comprend qu’elle a intérêt à renoncer au reliquat de ses privilèges antérieurs pour garantir et renforcer ses positions au sein des rapports capitalistes de production mais aussi pour lui permettre d’accéder à un meilleur contrôle encore de l’appareil d’État que celui que la monarchie absolutiste pouvait lui garantir. En d’autres termes, s’amorce ainsi la constitution d’un nouveau bloc social candidat à l’exercice du pouvoir, rival par conséquent du bloc social sur lequel s’appuyait jusqu’alors le pouvoir absolutiste et dont certains éléments se sont détachés – bref une situation de double pouvoir.
Dans ces conditions, pour rétablir l’ « ancien régime », le monarque et la partie de la noblesse (mais aussi éventuellement de la bourgeoisie) hostile à ces transformations pourtant limitées ne peuvent plus compter que sur l’armée. D’où différentes issues possibles à cette deuxième étape. Soit l’armée est paralysée par ses divisions au sommet (au sein de son commandement, essentiellement entre des mains nobiliaires, qui se partage entre les deux camps) et par ses défections à la base (quand il s’agit d’une armée composée d’enrôlés issus des classes populaires ou de mercenaires qui se débandent) ; et elle est incapable d’intervenir pour réprimer le mouvement révolutionnaire. Et le processus peut suivre son cours. Soit, au contraire, l’armée ou une partie de l’armée, éventuellement renforcée d’éléments étrangers, reste suffisamment solide pour tenter de réprimer le mouvement révolutionnaire ; et, dès lors, ou bien elle y parvient parce que le mouvement révolutionnaire ne dispose pas de la capacité à s’opposer à lui : la révolution, réprimée, prend fin (exemple typique : le soulèvement catalan de 1640-1652) ; ou bien la répression échoue, au moins en partie, parce que l’armée se divise (une partie reste fidèle au nouvel ordre constitutionnel et passe dans le camp révolutionnaire) ou encore parce que le mouvement révolutionnaire s’est entre-temps doté de ses propres forces armées (milices populaires ou même armée populaire encadrée par des officiers de l’ancienne armée royale – ce que la faiblesse relative des armées professionnelles rend assez facilement possible à l’époque), capables de tenir l’armée royale en échec : virant à la guerre civile, éventuellement compliquée d’interventions étrangères, la révolution se poursuit en se radicalisant, aboutissant notamment à la déchéance du roi (voire à son exécution) et à l’abolition de la royauté au profit d’un État républicain. C’est ce qui se passe aux Pays-Bas à partir de 1568 et en Angleterre à partir de 1642-1643.
Troisième étape. Elle est marquée par l’intervention autonome des différentes classes subalternes, principalement la paysannerie, favorisée par la paralysie durable voire l’effondrement du pouvoir monarchique et de ses forces répressives et la constitution de forces armées révolutionnaires ou par le déclenchement de la guerre civile. S’étant jusqu’alors fondues dans le mouvement général de remise en cause de l’ « ancien régime » (des privilèges de la noblesse et du clergé, de la constitution absolutiste de la monarchie, etc.) et de création des institutions nouvelles (comme l’assemblée représentative), non sans qu’apparaissent déjà certaines dissensions à leur sujet (par exemple sur la question de l’extension du suffrage censitaire au suffrage universel), ces classes font désormais entendre leurs revendications propres et se mobilisent pour satisfaire leurs propres intérêts et réaliser leurs propres objectifs. Ce qui les conduit rapidement à s’en prendre aux biens et aux personnes des possédants et à exiger une vaste redistribution des richesses (par exemple par le biais fiscal : la substitution d’un impôt direct proportionnel ou même progressif aux impôts indirects dégressifs, ou par le contrôle des prix) et des moyens de production de la richesse (notamment de la terre) pour instaurer ou conforter une société de petits producteurs marchands régie par un État républicain reposant sur le suffrage universel ; de pareilles revendications sont par exemple portées par les levellers (les niveleurs) pendant la révolution anglaise et par les sans-culottes pendant la révolution française. Mais des éléments plus radicaux encore se font entendre parmi eux, qui s’en prennent au principe même de la propriété privée et parlent d’en revenir à la propriété communautaire (familiale ou communale) ou même d’instituer une propriété d’État (en particulier en ce qui concerne la terre) ; quoique très minoritaires, ils n’en stimulent pas moins le reste du mouvement ; ainsi en ira-t-il des anabaptistes pendant la révolution néerlandaise, des diggers (les bêcheurs ou creuseurs) pendant la révolution anglaise et des « Enragés » et des babouvistes pendant la révolution française.

Cette intervention des classes populaires fait subir un saut qualitatif au processus révolutionnaire en en approfondissant singulièrement les enjeux. Elle lance un véritable défi à la bourgeoisie pour autant qu’elle entende maintenir les acquis antérieurs du mouvement révolutionnaire et garder la direction de ce dernier, condition de l’établissement de son hégémonie durable dans le nouveau régime en gestation, en l’obligeant à lutter désormais sur deux fronts à la fois. D’où, là encore, deux issues possibles, entre lesquelles la bourgeoisie louvoie le plus souvent avant que l’évolution du rapport de forces ne l’engage définitivement dans l’une d’elles. Soit, parce qu’elle est effrayée par l’ampleur et la radicalité des revendications et des actions populaires (les menaces réelles ou imaginaires qu’elles font peser sur ses propriétés et les nouvelles institutions), soit parce qu’elle est incapable de s’en rendre maître, la bourgeoisie est contrainte d’interrompre (momentanément ou durablement) la révolution et de passer compromis avec les éléments les plus modérés des ci-devant nobles et membres du clergé pour réprimer ensemble le mouvement populaire. La répression du mouvement populaire peut ne lui imposer que des temps d’arrêt plus ou moins longs, avant qu’il ne reparte de plus belle. Mais si elle parvient à l’écraser définitivement ou à l’affaiblir progressivement jusqu’à ce qu’il finisse par s’épuiser, la révolution aboutit à une restauration qui n’est cependant pas un pur et simple retour au statu quo ante : à la place de la monarchie absolue est durablement établie une monarchie constitutionnelle, dans laquelle le pouvoir du roi est limité par l’existence d’une (ou deux) assemblée représentative, le nouveau régime servant d’armature à la reconstitution de l’ancien bloc des possédants, soudé autour de l’alliance entre l’aristocratie nobiliaire et la grande bourgeoisie, celle-ci y ayant cependant nettement renforcé ses positions dans l’appareil d’État et désormais solidement garanti sa position dominante au sein des rapports de production.
Soit, au contraire, la bourgeoisie (par organisations et représentants politiques interposés) parvient à « chevaucher le tigre » des classes populaires en ébullition. Loin de s’y opposer frontalement, il s’agit au contraire d’en prendre la tête et, en usant alternativement ou même simultanément de concessions et de répressions à leur égard, d’une part de profiter de leur énergie pour continuer à combattre et à défaire le camp contre-révolutionnaire qui reste actif et menaçant tout en imposant les réformes nécessaires à la consolidation des acquis antérieurs du processus, d’autre part d’empêcher les classes populaires de sortir du cadre de la légalité nouvelle (celle de la propriété privée, des institutions « représentatives », etc.) et, plus encore, de constituer un obstacle durable à l’établissement d’une société dominée par les intérêts capitalistes. En somme, il s’agit de canaliser le mouvement populaire, de manière à limiter (interdire, réprimer) autant que possible ses débordements, actuels ou potentiels, condition indispensable pour que le gros de la bourgeoisie, de la petite-bourgeoisie et de l’aristocratie paysanne ne bascule pas dans le camp contre-révolutionnaire, tout en mettant son énergie révolutionnaire au service de l’établissement de la nouvelle hégémonie bourgeoise et en contenant inversement les menées ou les poussées contre-révolutionnaires de la part des tenants de l’Ancien Régime et de leurs éventuels alliés étrangers venus à leur secours. Et il faut que, simultanément, l’aile radicale de la bourgeoisie parvienne à jouer là encore tout aussi bien de la carotte et du bâton à l’égard des éléments les plus modérés des ci-devant noblesse et clergé, en leur garantissant la préservation de leurs propriétés et de leurs sources de revenus, sinon de leurs titres et privilèges, pour au moins parvenir à les neutraliser, c’est-à-dire à éviter qu’ils ne viennent eux aussi renforcer le camp contre-révolutionnaire.

Durant cette troisième phase, la révolution bourgeoise ne peut poursuivre son cours, en dépit des cahots dus à des situations de pouvoirs multiples se concurrençant et au milieu d’une incertitude constante quant à son avenir, qu’à la condition sine qua non que le camp révolutionnaire parvienne à se doter d’une direction à la fois clairvoyante, ferme et souple : sachant sinon ce qu’elle veut (elle s’invente au contraire un horizon au fur et à mesure qu’elle ouvre le chemin qui y mène) du moins ce qu’elle ne veut pas (ni restauration de l’ « ancien régime » ni débordement populaire), déterminée à aller jusqu’au bout des potentialités des différentes situations de son propre point de vue, capable simultanément de manœuvre et de duplicité face à ses alliés et appuis (sachant lâcher du lest quand c’est nécessaire pour mieux reprendre le terrain concédé dès que l’occasion s’en présente), sachant donc se saisir des opportunités offertes sans pour autant tomber dans l’opportunisme. Cette direction ne s’impose généralement qu’au terme d’une lutte quelquefois âpre entre différents « partis » (groupes, factions, mouvements), voire passe de « parti » en « parti » au cours de la révolution, au gré de ses péripéties, chacun d’entre eux pouvant de surcroît être traversé par des luttes de tendances, l’enjeu en étant tout simplement le contrôle du mouvement populaire. Dans la révolution néerlandaise, c’est le « parti » regroupé autour du prince d’Orange qui a assumé cette direction, en liaison avec le patriciat marchand hollandais ; dans la révolution anglaise, elle a échu à Cromwell et à l’état-major de la New Model Army qu’il avait constituée ; enfin, pendant la révolution française, cette direction a fini par revenir aux jacobins emmenés par Robespierre.
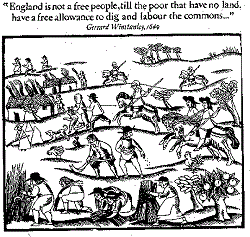
Quatrième étape. Ce n’est qu’en suivant cette difficile et périlleuse voie moyenne, en pratiquant sans cesse un jeu de bascule entre « droite » (les ci-devant privilégiés de l’« ancien régime » qui n’ont pas basculé dans le camp contre-révolutionnaire) et « gauche » (les mouvements populaires et, surtout, leurs éléments les plus radicaux), en mêlant concession et répression dans ses rapports avec les uns et les autres, au risque de renforcer involontairement un camp au détriment d’un autre et provoquer du même coup son propre échec (ce qui s’est d’ailleurs quelquefois produit), que la bourgeoisie parvient finalement à être victorieuse sur les deux fronts et à créer les conditions de son installation durable au pouvoir. Et il lui faudra souvent s’y reprendre à plusieurs fois avant d’y parvenir. Ce n’est que de la sorte qu’elle peut jeter les bases de la constitution d’un nouveau bloc au pouvoir, au sein duquel elle occupe évidemment une position hégémonique, en s’étant ralliée (dans des positions subalternes) aussi bien une partie de la ci-devant noblesse que les couches supérieures de la petite-bourgeoisie et de la paysannerie.
Les paradoxes des révolutions bourgeoises
De l’analyse précédente résultent trois conclusions majeures. En premier lieu, aux différentes étapes d’une révolution bourgeoise, il se trouve des membres (voire des couches et des fractions entières) de la bourgeoisie (comme d’ailleurs de la noblesse ou des autres classes sociales) dans les deux camps. Autrement dit, une révolution bourgeoise n’oppose jamais la bourgeoisie d’un bloc à la noblesse d’un bloc alors qu’elle oppose presque toujours une partie de la bourgeoisie à une autre partie de la bourgeoisie. En somme, toutes les révolutions bourgeoises se sont toujours aussi faites contre une partie de la bourgeoisie !
« On prête à R. H. Tawney ce bon mot “Révolution bourgeoise ? Bien entendu, mais le problème, c’est que la bourgeoisie était dans les deux camps”. Cela est vrai de la Glorieuse Révolution de 1688-1689 comme de la révolution de 1640, de la Fronde comme de la Révolution de 1789. »1.
Cela signifie tout simplement que les révolutions bourgeoises ont été avant tout une affaire interne aux classes possédantes, dont l’enjeu était tout simplement la (re)composition du bloc au pouvoir et l’hégémonie en son sein. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles se soient réduites à l’intervention de ces seules classes. Au contraire, les classes subalternes (populaires) y prennent toujours aussi leur part et elles y jouent même, par moments, un rôle décisif. Bien plus – et c’est ma deuxième conclusion – durant les temps modernes, une révolution bourgeoise ne peut être victorieuse sans que la bourgeoisie bénéficie du soutien d’une partie significative des classes populaires (essentiellement la petite-bourgeoisie et la paysannerie), avec le risque pour elle de devoir affronter aussi la dimension anti-bourgeoise des revendications et des luttes populaires et la nécessité de s’en rendre maître d’une manière ou d’une autre, par la répression ou la concession, souvent les deux à la fois. Si bien que les révolutions bourgeoises se sont toujours aussi accomplies, en un sens, contre l’ensemble de la bourgeoisie.
En troisième lieu, pour la plupart des membres tant de la paysannerie que de la petite-bourgeoisie, leur alliance, conjoncturelle ou plus durable, avec la bourgeoisie dans le cours des révolutions bourgeoises aura constitué un jeu de dupes. En permettant à la bourgeoisie d’abattre l’« ancien régime » au sein duquel elle devait partager le pouvoir avec l’aristocratie nobiliaire pour un « nouveau régime » au sein duquel elle va pouvoir régner seule, elles auront aussi, en un sens, signé leur arrêt de mort. Car le développement ultérieur du capital, auquel ce renversement révolutionnaire va ouvrir la voie en en créant les conditions institutionnelles, les condamnera à disparaître à terme en tant que classes : la plupart de leurs membres vont se trouver expropriés et rejoindront les rangs du salariat ; une petite minorité réussira éventuellement sa conversion en capitalistes et intégrera les rangs de la bourgeoisie industrielle ou commerciale ; seule une autre minorité parviendra à se maintenir, souvent difficilement, dans son statut de classe moyenne traditionnelle. Mais ce processus prendra lui-même plus ou moins de temps, selon l’ampleur des concessions que la bourgeoisie aura été amenée à faire à ses alliées dans leur lutte commune contre le camp contre-révolutionnaire puis, ultérieurement, contre la montée du mouvement ouvrier.
Au vu des lignes précédentes, une question ne peut manquer dès lors de se poser : en quoi les révolutions bourgeoises ainsi entendues ont-elles été bourgeoises ? Non pas certes en ce sens qu’elles auraient été programmées, déclenchées et conduites de part en part par la bourgeoisie d’un bloc ni par un « parti » (ou des « partis ») la représentant comme telle. Bourgeoises, elles l’ont été d’une part par le fait qu’elles ont partout et toujours résulté des contradictions, conflits, tensions et déséquilibres introduits dans les structures des sociétés protocapitalistes, à tous leurs niveaux, par la montée en puissance de la bourgeoisie, essentiellement sous la forme du lent parachèvement des rapports capitalistes de production : c’est en ce sens que l’action historique de la bourgeoisie, développant ces rapports, en a été le moteur fondamental. Bourgeoises, ces révolutions l’ont été d’autre part en ce sens que, là où elles ont réussi, où elles sont parvenues plus ou moins à leurs fins, elles ont définitivement consolidé le pouvoir de la bourgeoisie, en écartant les obstacles persistants sur la voie du développement des rapports capitalistes de production et en transformant une classe déjà hégémonique sur le plan culturel et en pleine ascension sur le plan économique en une classe politiquement dominante : capable de gouverner l’État, c’est-à-dire de lui imposer les formes, structures et fonctions appropriées à ce développement, même si elle n’est pas nécessairement la classe régnante ni la classe tenante de l’appareil d’État. Et, même là où leur cours s’est trouvé interrompu par l’incapacité des « partis » révolutionnaires de louvoyer entre le Charybde de la réaction et le Scylla de l’agitation populaire, les restaurations apparentes auxquelles elles ont alors donné lieu ont néanmoins créé une situation de non-retour et sur la voie des progrès réalisés par le développement des rapports capitalistes de production et sur la voie de l’accès ultérieur de la bourgeoisie à la position de classe politiquement dominante. En définitive, les révolutions bourgeoises des temps modernes ont été bourgeoises en ce que l’action historique de la bourgeoisie (développer les rapports capitalistes de production) en a constitué le terminus ad quem (leurs résultats sinon leur finalité) aussi bien que le terminus a quo (leurs présupposés ou conditions de possibilité), quels qu’aient pu être par ailleurs la place et le rôle de la bourgeoisie dans la médiation entre ces deux termes qui a constitué le processus révolutionnaire lui-même.
1 Immanuel Wallerstein, Le mercantilisme et la consolidation de l’économie-monde européen 1600-1750, Flammarion, 1985, page 149.
- Le premier âge du capitalisme – La Fronde - 25 mai 2020
- Les révolutions bourgeoises modernes : du projet au trajet - 27 novembre 2019
- Une première mondialisation - 4 avril 2019
