Les détenu∙es étiqueté∙es « radicalisé∙es »
Le nombre de détenu∙es incarcéré∙es pour des faits en lien avec le terrorisme ne cesse d’augmenter en France et les risques de « radicalisation » au sein même des établissements pénitentiaires n’ont cessé de défrayer la chronique les dernières années et ont mis l’Administration pénitentiaire sous pression. Face à des injonctions changeantes et contradictoires, l’Etat peine à donner un sens à la prise en charge de la radicalisation en prison, qui fait l’objet d’une répression indirecte. Appréhendée sous sa forme violente, la radicalisation conduit à mobiliser de nombreuses techniques qui sortent du respect, pourtant de principe, des droits fondamentaux. Ainsi, la sécurité l’emporte sur l’accompagnement, et l’objectif de neutralisation sur celui de réhabilitation.
Éducatrice spécialisée ayant travaillé plusieurs années auprès de personnes « radicalisées », Marion Bagnaud est membre de Sud Santé-Sociaux et secrétaire départementale de Solidaires Haute-Savoie.
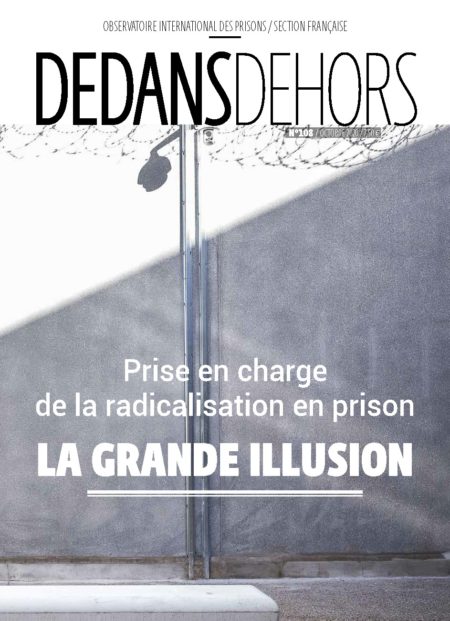
Une étiquette islamiste discriminante
Dans les prisons françaises, le phénomène de « radicalisation islamiste » est perçu comme le terreau supposé du terrorisme et n’est pris en compte que sous ce prisme. Certain∙es détenu∙es sont partisan∙es d’un islam radical mais sont non-violents, d’autres sont violent∙es mais ignorent tout de cette religion. Toutes et tous ont en commun qu’ils et elles se retrouvent étiqueté∙es dans la catégorie pénitentiaire quasi-autonome des personnes « TIS » pour « terroriste islamiste ». Les personnes « TIS » se comptent aujourd’hui par centaines dans nos prisons. Elles étaient 503 (dont 72 femmes) au 1er septembre 2020, contre 172 en février 2015. S’y ajoutent les personnes détenues pour des faits de droit commun mais repérées pour leur risque de radicalisation, toujours islamiste (DCSR). Nous y reviendrons plus tard.
Derrière ces chiffres se cachent des réalités extrêmement diverses. Près de la moitié des « TIS » sont des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits d’ « association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste (AMT) », infraction qui peut s’appliquer à une multitude de comportements. On retrouvera alors, à côté des auteurs présumés ou reconnus d’attentats, des personnes qui, de près ou de loin, ont été impliquées dans un projet terroriste dont ils ou elles ignoraient tout. C’est ainsi que peuvent être classé∙es sous la même infraction, un groupement formé en vue de la préparation d’un attentat, le fait de préparer en solitaire une infraction grave dès l’instant où cela est animé de mobile terroriste, tout comme le fait de fournir en méconnaissance une arme à un terroriste, d’avoir envoyé un mandat sur le sol syrien ou d’avoir tenté de s’y rendre peu avant ou après la proclamation du Califat en juin 2014 (cette infraction a comme particularité de pouvoir faire incarcérer des personnes avant même la préparation d’actes violents).
Une gestion cacophonique
L’Etat français adopte une méthode précise de répression des faits de terrorisme, en axant son attention sur la neutralisation des personnes radicalisées par l’enfermement. Cet objectif d’incarcération implique cependant la nécessité immédiate d’éviter tout effet de contagion dans les prisons et donc une prise en charge par l’Administration pénitentiaire. Le premier plan de lutte contre la radicalisation fut lancé, dans la précipitation, au lendemain des attentats de janvier 2015. Manuel Valls annonce alors la création de plusieurs unités dédiées, sur le modèle de l’expérience menée à la maison d’arrêt de Fresnes où, sur seule décision du directeur d’établissement et sans concertation, les personnes détenues pour des faits de terrorisme sont regroupées dans une aile spécifique. L’objectif est de les isoler dans des quartiers étanches du reste de la détention, afin de prévenir tout risque de prosélytisme. Ces annonces précipitées sont des réponses simplistes et contreproductives en termes de sécurité publique, car elles omettent de prendre en compte l’incarcération comme facteur aggravant des exclusions sociales et des phénomènes de violence en général. L’Administration pénitentiaire tente alors de donner un sens à ces annonces, mais l’agression violente, en septembre 2016, de deux surveillants par un détenu radicalisé vient bouleverser sa politique. L’auteur de l’attaque était pris en charge dans une de ces unités dédiées et n’y faisait pas grand bruit alors qu’il avait prémédité son acte. La presse annonce alors la fin des unités dédiées mais elles continuent encore aujourd’hui d’exister sous d’autres noms et d’autres formes, même si les maîtres mots sont désormais : repérage, évaluation et prise en charge.

[Syllepse]
Repérage d’abord car l’Administration pénitentiaire s’est fixée comme objectif de détecter les détenu∙es incarcéré∙es pour des faits de droit commun « susceptibles de radicalisation », les fameux « DCSR ». Cette catégorisation repose sur un processus de repérage dépourvu de toute garantie procédurale, sur des critères opaques et discriminants puisque « c’est la combinaison de plusieurs critères et l’échange entre plusieurs professionnels qui permet le diagnostic » précise une note de la direction de l’Administration pénitentiaire. Ce repérage est donc laissé à l’appréciation de chaque établissement, voire de chaque agent sans que les détenu∙es ne soit informé∙es de cette soudaine étiquette. Les détenu∙es identifié∙es par ce pré-diagnostic comme présentant des risques au titre de la radicalisation violente seront alors ensuite, au même titre que les TIS, soumis à une évaluation pluridisciplinaire, soit par une équipe locale, soit dans un quartier dédié à l’évaluation de la radicalisation, appelé QER. C’est autour de cette logique prédictive que les détenu∙es, prévenues ou condamné∙es, pour des faits ou non de terrorisme sont soumis à une évaluation de la dangerosité. Cette évaluation, non soumise à une doctrine de la part de la direction nationale de l’Administration pénitentiaire est laissée à l’appréciation des établissements, voire des agents l’effectuant alors qu’elle a pour but l’orientation, donc la prise en charge, de la suite du parcours en détention des personnes « radicalisées ».
Sur le papier, les moins dangereux et dangereuses iront en détention classique où ils et elles pourront participer à des programmes de prévention et les détenu∙es radicalisé∙es jugé∙es accessibles iront en Quartier spécifique de prise en charge (QPR), en vue de leur désengagement. Les détenu∙es jugé∙es les plus violent∙es et prosélytes iront à l’isolement. L’usage de ce placement est aujourd’hui largement détourné, notamment pour les personnes placées en détention provisoire pour des faits de terrorisme, qui s’y retrouvent de manière quasi-systématique, et ce, durant plusieurs années dans l’attente d’un procès. La philosophie même de cette politique globale pose de nombreux questionnements éthiques. S’il y a repérage, il y a suspicion. S’il y a évaluation de la dangerosité, il y a tentation d’une justice prédictive. S’il y a catégorisation, il y a risque pour les droits fondamentaux. S’il y a traitement différencié, il y a risque de discrimination. L’identification d’une catégorie de personnes détenues conduit de fait à appliquer des mesures trop systématiques à une population dont on ne peut ignorer l’hétérogénéité.
Quel que soit leur régime de détention, les personnes suivies au titre de la lutte contre la radicalisation violente ont toutes en commun d’être soumises à un traitement ultrasécuritaire, qui déroge au régime de droit commun. Pour toutes et tous, la surveillance et le contrôle sont accrus, l’accès aux activités, à l’enseignement, aux unités de vie familiale et au travail limité, voire impossible. Les logiques de renseignement et suspicion l’emportent sur les logiques et exigences judiciaires ; les demandes d’aménagement de peine sont quasi-systématiquement rejetées, et les sorties sèches deviennent donc la norme. Les agents ne peuvent alors favoriser la réinsertion via un retour progressif à la liberté alors que la Cour européenne des droits de l’homme reconnait ceci comme un droit fondamental.
Des agents en quête de sens
Dès les annonces de 2015 par Manuel Valls, deux nouveaux acteurs (par ailleurs souvent des actrices) ont fait leur apparition dans le triptyque « repérage, évaluation, pris en charge » : un∙e psychologue et un∙e éducateur∙trice spécialisé∙e qui composent le « binôme de soutien ». Uniquement contractuel∙les de l’Administration pénitentiaire, ils et elles ont pour mission de « renforcer la pluridisciplinarité et améliorer la prise en charge des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation » et sont érigé∙es en véritable couteau suisse de la lutte contre la radicalisation. Dans les faits, ce binôme n’a pas les moyens d’exercer sa fonction car les missions sont nébuleuses et la marge de manœuvre illusoire. Aucun cadre précis de leur mission n’existe aujourd’hui, hormis une note émanant de la direction nationale stipulant seulement que ce binôme doit rencontrer toutes les personnes placées sous-main de justice repérées comme radicalisées. Cette tâche est irréalisable sur certains établissements et pose clairement la question du consentement de la personne détenue, d’autant que l’objet de ces rencontres n’est jamais clairement formulé. Présent en unités dédiées, en détention ordinaire mais aussi milieu ouvert, il intervient à toutes les étapes du suivi. En réalité, les binômes de soutien ressentent d’importantes difficultés à avancer, à pouvoir tenir une ligne cohérente, ne serait-ce que sur un moyen terme. Les résistances sont nombreuses face aux métiers psycho-sociaux, provenant à la fois des professionnel∙les sur les terrains comme des échelons supérieurs. Le turn-over depuis 2015 est considérable, faute de se sentir à l’aise. Beaucoup critiquent la mission de « prédiction » qui leur est assignée, regrettent qu’on leur demande de communiquer des éléments qui relèvent du secret professionnel et de la vie privée des personnes et s’inquiètent encore à l’heure actuelle de devoir partager des observations, notamment avec le renseignement pénitentiaire, sans savoir à quelles fins elles seront utilisées. Evidemment, les professionnel∙les de la lutte contre la radicalisation sont de bonne volonté mais si chacun∙e tente de donner du sens à ses missions, il en résulte malgré tout l’impression d’une grande cacophonie. Il existe dans l’Administration pénitentiaire un manque de connaissance et de confiance en ce qui constitue les métiers de psychologue et éducateur et éducatrice spécialisé∙e. De facto, leur autonomie est moindre ; ils et elles sont attendus sur des fonctions telles que veiller au respect de la laïcité, participer malgré eux/elles au renseignement, évaluer le degré de dangerosité, plutôt que d’utiliser leurs compétences globales de prise en charge. L’essentiel ne semble pas d’accompagner mais de rendre compte.

Un autre acteur joue un rôle central dans le dispositif de prévention de la radicalisation : le renseignement pénitentiaire. Longtemps cantonné à la simple collecte d’informations au sein de la détention, le renseignement pénitentiaire a vu ses missions, ses compétences mais surtout ses moyens se renforcer depuis 2017. Désormais compétent en matière de prévention du terrorisme et de la délinquance, il a pu rejoindre officiellement la grande communauté du renseignement. Comme quoi le sécuritaire aura encore longtemps l’ascendant sur le travail psycho-social.
Conclusion
Le problème aujourd’hui est que l’administration n’arrive pas à se positionner entre le tout sécuritaire et la réinsertion. Si on veut travailler un minimum la réinsertion, il faut rééquilibrer le sécuritaire. L’effort français de lutte contre la radicalisation se concentre sur son traitement, plutôt que sur son évitement. Or, pour combattre efficacement ce phénomène, il convient d’appuyer les politiques publiques sur sa prévention primaire. Celle-ci consiste à lutter contre la radicalisation cognitive qui envahit les esprits et qui se déploie, essentiellement, au sein des réseaux sociaux et de groupes d’individus, souvent jeunes. Une telle prévention est construite sur les trois piliers que sont l’éducation, l’inclusion sociale et le vivre ensemble. Depuis six ans, la succession de dispositifs crée une instabilité dommageable aussi bien pour les détenu.es que le personnel encadrant. Ces changements ne sont pas le résultat d’une réflexion prenant en compte une évaluation approfondie des dispositifs, mais celui d’orientations dépendant des réactions politiques à l’actualité et à l’opinion publique, en perpétuel mouvement. Les mesures de sécurité, déjà exorbitantes du droit commun, conduisent à isoler davantage encore les personnes détenues « radicalisées ». Les exigences croissantes de sécurité portent atteinte aux droits fondamentaux sans être pour autant le gage d’une sécurité véritable et encore moins d’une prise en charge au cas par cas.
Marion Bagnaud
