« Je ne reviendrai pas vers vous » : discours managérial et paroles militantes
« Je suis pressé de donner un nom à nos asiles. » Patrick Laupin, Le bloc de peine
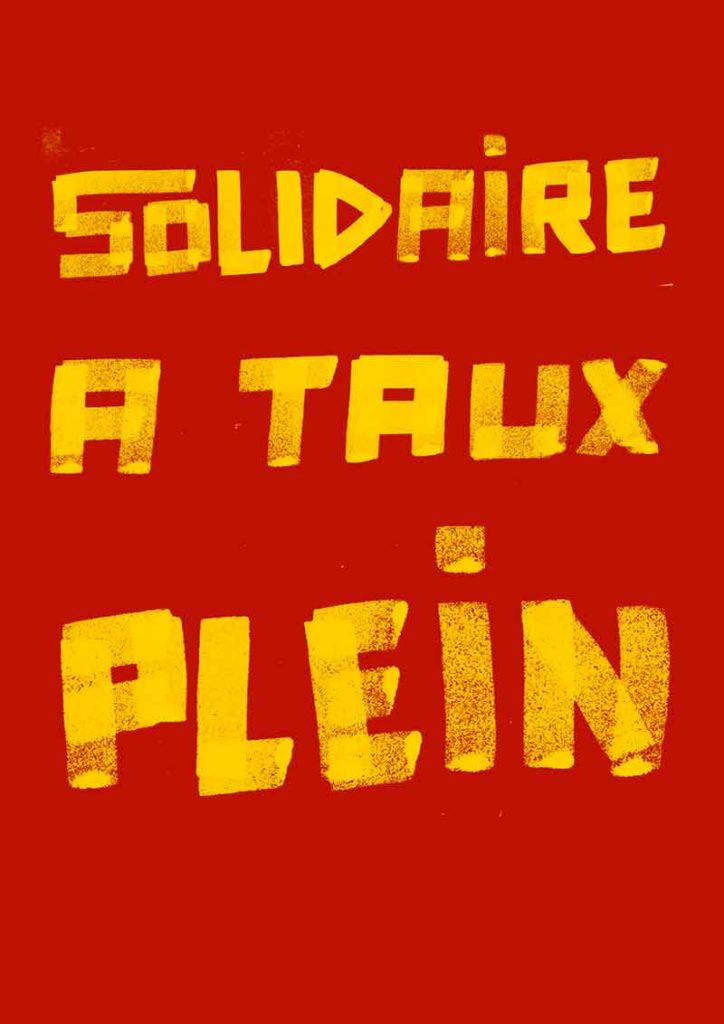
Dans un centre d’accueil pour adultes psychotiques, un homme un jour vient se présenter ; il donne son nom, l’éducateur lui donne le sien. Mais cette réciprocité, socialement marquée, a tôt fait d’imploser : très vite, l’homme se met à renommer les autres -tout le monde- avec des prénoms par lui choisis. Refusant de se conformer à une règle pourtant consensuelle à l’échelle de nos sociétés, il place ceux qu’il refuse de nommer par leur prénom dans une position délicate. Céder à la facilité, accepter ce nouveau baptême, se laisser embarquer dans un délire qui, ayant enfoncé un premier coin, fait par suite flotter toutes les perceptions, ou résister, pied à pied, au prix d’un effort d’autant plus coûteux que les appels au parjure se multiplieront dans la durée, mais qui fait se maintenir là, dans le giron d’une réalité d’énonciation partagée ? Le discours néolibéral, et son pendant au sein des organisations, le discours managérial, ne fait pas vivre autre chose aux sujets embarqués malgré eux dans une requalification du monde, qui les plonge dans l’insécurité linguistique.
Cette histoire de la violence faite aux noms -patronymes, toponymes- les historiens et historiennes de la colonisation la connaissent bien, jusque dans ses ravages. Un article de jeune Afrique [1] nous le rappelle, c’est en 1882 que l’obligation d’inscription aux registres de l’état civil soumet les « indigènes » à une transcription sauvage de leurs patronymes, transformant ainsi le système généalogique existant en une vaste farce linguistique, où les noms de famille au mieux s’éteignent, au pire s’exposent au ridicule des nouvelles formulations. Dans ses visées impérialistes, sinon totalitaires, le discours managérial procède de la même logique : au langage fruit d’une histoire commune, bricolé dans la sueur, arraché au terrain, il substitue un verbiage hors-sol, issu d’hybridations douteuses, lexique OGM conçu pour résister à toutes les formes de parasites connus : arguments rationnels, élaborations collectives et autres oppositions syndicales. Une greffe de langue qui ne vise ni plus ni moins qu’à coloniser les imaginaires. Mais la langue n’est pas figée, et les désignations se défont. Le courage de quelques chercheurs, la détermination des familles auront permis en Algérie d’effacer cet outrage fait aux noms et de rétablir l’antique généalogie. C’est à un travail similaire de dénonciation/réappropriation que le présent article invite le lecteur.
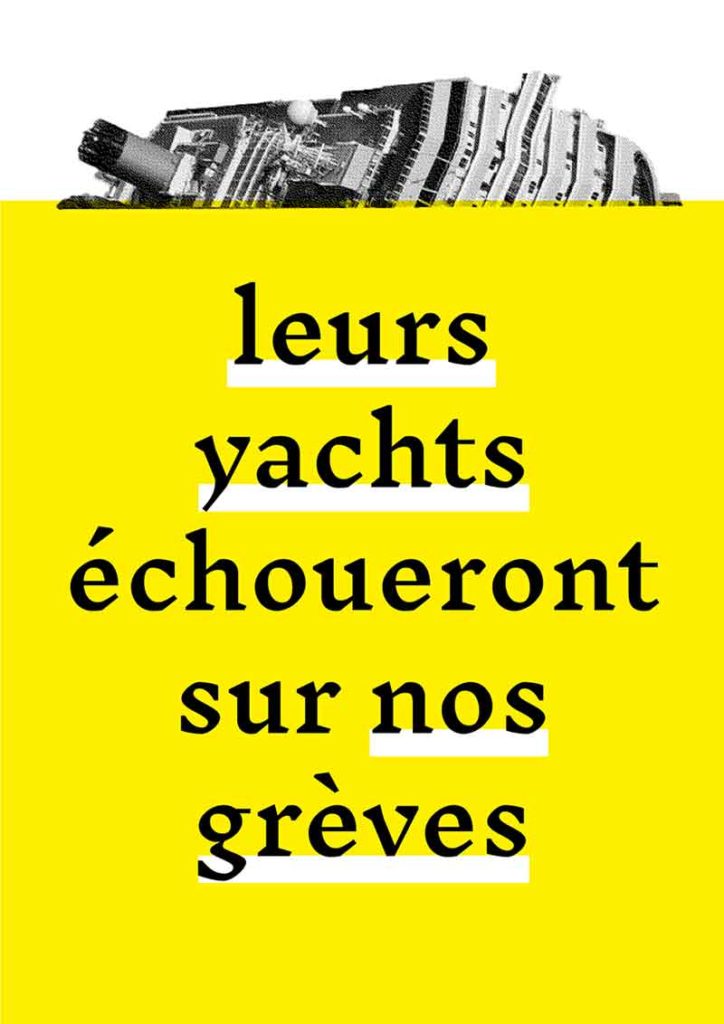
DÉCOLONISER L’IMAGINAIRE
Quinze ans après le constat dressé par Eric Hazan dans sa LQR, où en sommes-nous exactement de ce tiraillement de langue, qui a vu le discours managérial envahir de ses accents atones tout l’espace public ? Incontestée dans sa suprématie, la langue publique continue d’être le vecteur d’un récit majeur, unique, qui a depuis longtemps colonisé les cerveaux : ce récit, c’est celui de la loi du marché. Dans ses procédés -euphémismes, hyperboles, détournements sémantiques- comme dans sa syntaxe, la « novlangue » est restée relativement stable, accumulation de tournures à l’obsolescence programmée, fil ténu, tenace, fragile comme la mode. De paradigme en braquet, puis de braquet en logiciel, son « changement » a résisté insidieusement, torrent de langue qui n’en finit pas de ruisseler sur ses administrés.
Si le discours managérial a pu un temps n’être que la déclinaison sectorielle, dans un champ certes assez vaste, celui de l’emploi, d’une entreprise autrement plus ambitieuse, la propagation à l’échelle mondiale de la pensée néolibérale, et du discours néolibéral qui la sous-tend, la progéniture a rejoint son géniteur et les deux résident désormais au plus haut niveau de l’État. C’est ce que relevait Pierre Musso dans un article intitulé « L’ère de l’État entreprise », paru dans les colonnes du Monde diplomatique en mai 2019 : Berlusconi, Trump et Macron y sont décrits comme « trois personnages politiques disruptifs », chefs de l’« État-entreprise » qui « importent le management dans le champ politique et mettent en musique le récit glorieux de leur expérience de l’entreprise ». Ainsi, entre autres exemples, dans la start-up nation, le Président manager de la République dispose d’une application de reporting permettant de suivre en temps réel [2] les indicateurs de performance de ses ministres. Plus que jamais il y a donc une centralité politique de l’emploi, en ce que ce dernier a servi de bac à sable idéologique à ceux qui ont présidé, président ou (si nous échouons) présideront les États. Discours managérial, discours néolibéral et discours politique tendent ainsi à se confondre.
Pour illustrer à quel point ils ne font plus qu’un, mais également dans quelle mesure leur mobilisation n’est pas qu’une violence symbolique, abstraite, mais qu’elle a bien des répercussions dans le réel, il ne nous vient pas de plus bel exemple que celui du candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron. Celui-ci affirmait, dans un discours prononcé à Paris le 10 décembre 2016, que « le travail, ça n’est pas une souffrance ». Il redira d’ailleurs sensiblement la même chose le 3 octobre 2019, à Rodez : « Moi j’adore pas le mot pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible ». Des mots, ce ne sont que des mots. Sauf qu’entretemps, l’ordonnance du 22 septembre 2017 est publiée, qui met fin au compte pénibilité, rebaptisé compte « prévention » -des mots, encore des mots- et qui, au passage, supprime quatre critères sur dix, dont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécanique et les agents chimiques dangereux. Aucun doute que ceux et celles qui y étaient exposés avant le changement de qualificatif ont beaucoup moins mal depuis… D’aucuns parlent de modernisation pour imposer des modèles réactionnaires, de mutualisation pour justifier des licenciements, de bienveillance pour masquer les manques de moyens [3]… Le discours agit comme un anesthésiant mais pendant que le patient est dans les vapes, les chirurgiens opèrent.
Si l’on tentait une généalogie au doigt mouillé, on pourrait postuler que le discours néolibéral a enfanté le discours managérial, qui a gangréné le discours politique, qui avait lui-même déjà intégré le discours néolibéral. Mais le portait de cette famille, à très haut potentiel de consanguinité, resterait inachevé si l’on omettait de convier son rejeton le plus dégénéré, le discours publicitaire. Avec lui la dynastie est au complet, objectif commun : la colonisation des imaginaires au service de la société de croissance. Le discours managérial s’adresse à l’individu producteur, trouve un relais précieux au cœur même du pouvoir, qui s’adresse à peu près dans les mêmes termes à l’individu électeur. Ne manque plus alors qu’à s’adresser à l’individu consommateur. Depuis bien longtemps, la publicité ne vante plus les qualités présumées d’un produit mais scénarise un idéal. De la même manière, par la grâce du discours managérial, avec le soutien du happiness manager, le salarié opprimé acquiert le statut enviable de collaboracteur proactif, et grâce au lean management, apprend à faire mieux avec moins. Discours managérial comme publicité excellent dans l’art de convoquer des « concepts » mielleux, « prônant un modèle idéal s’appuyant sur des valeurs promues par la société (confiance, efficience, excellence, transparence…) et construisant par les métaphores utilisées (famille, équipe, groupe d’amis…) une vision intégratrice des employés (Norlyk, 2009) … le discours managérial est rarement contesté » [4]. À nous de transformer ce « rarement » en « systématiquement ». D’autant que les liens du sang qui unissent les discours politiques, managériaux et publicitaires impliquent que combattant l’un on s’occupe aussi des autres. Et qu’en s’attelant à mener la contre-offensive linguistique dans nos administrations, nos entreprises, nos instances, nos syndicats, on ne mène pas un combat d’arrière-garde, loin de là, c’est bien à une pensée-monde qu’on s’oppose.
Posons un premier acte de résistance à l’infusion du discours managérial en dépliant son étymologie. Dérivé de l’italien maneggiare, « conduire un cheval à la main », le manègement est d’abord affaire de dressage, violence que l’on exerce sur l’animal dans le but d’infléchir sa nature et le domestiquer. C’est d’ailleurs dans le calme des maisons bourgeoises que le terme achèvera de rebondir, ménagement renvoyant alors à la bonne tenue de l’appareil domestique. De manègement en ménagement, du devenir-outil de l’animal au devenir-esclave de la ménagère, c’est une histoire enfouie, toute d’emprise et d’influence, que la langue-étalon du management fait soudain ressurgir. C’est ainsi tout naturellement qu’elle a trouvé à s’installer au cœur d’un autre espace de domination, celui des organisations. Le management, -tête de pont, leitmotiv, gimmick- se décline ad nauseam, il s’est diffusé comme une peste langagière auquel plus aucun secteur ne résiste. C’est LA tarte à la crème : tout se résume désormais à des problèmes de management. Quel naufrage d’entendre, de plus en souvent, des militants syndicaux pointer des soucis de management, pour le plus grand bonheur du patron, qui concède et annonce dans la foulée qu’un séminaire en management est d’ores et déjà programmé. Le management, ou la main magique de gestion des affaires humaines. Le passage par l’étymologie nous convainc de ne pas nous laisser prendre au mors par cette langue du manège, c’est pourquoi nous proposons de la renommer. Nous l’appellerons désormais cratolecte, du grec kratein, « commander », néologisme suffisamment répugnant pour refléter adéquatement son référent. Une langue, et neuve de surcroît ? Cela mérite d’y regarder de plus près.

LOCUTEURS DE TOUS LES PAYS….
Disons un peu rapidement que depuis Ferdinand de Saussure, deux conceptions de la langue s’opposent en linguistique : d’une part une langue entendue comme système de signes, stable, homogène, hiératique et d’autre part, une langue inscrite dans l’histoire, parcourue par ses luttes, vacillante, irrégulière. Une telle langue a au moins le mérite de rendre compte de ses propres transformations : langue hybride et vivante, corruptible à l’envi, elle nous rappelle que le fait linguistique n’est jamais neutre, qu’il est le lieu d’un agôn [5] inéluctable, comme l’a mis en lumière Jean-Jacques Lecercle dans son dernier ouvrage consacré aux phénomènes d’interpellation [6].
Deux régimes de langue donc, dont l’un suppose la soumission à un système de signes, à une grammaire, et l’autre l’acceptation ou le refus de « désignations », autrement dit de transformations lexicales dominantes. En tant que locuteurs natifs, nous sommes tous tributaires de la première, et en tant que sujets de droit, tous potentiellement affranchis de la seconde, dont nous pouvons rejeter comme embrasser les contraintes. Cette liberté est toutefois relative : sociolecte des puissants, cette nasse de désignations s’inscrit dans un « sémantisme social » [7] (j’emprunte le concept au linguiste Emile Benveniste) qu’il est parfois bien difficile d’éluder, tant son inscription dans la vie publique est grande. Il s’agit bel et bien d’un authentique parler de classes qui ne dit pas son nom, en occultant les soubassements théoriques qui le fondent : « Chaque classe sociale s’approprie des termes généraux, leur attribue des références spécifiques et les adapte ainsi à sa propre sphère d’intérêt et souvent les constitue en base de dérivation nouvelle. A leur tour ces termes, chargés de valeurs nouvelles, entrent dans la langue commune dans laquelle ils introduisent les différenciations lexicales. » [8] Une telle « prise de possession de la langue commune » [9] ne va pas heurt, on l’imagine ; des forces s’organisent, individus et collectifs contre-interpellent, substituant leurs mots en propre aux désignations sanctifiées, jouant valeurs contre valeurs, témoignant de cette fameuse résistance au changement que leurs adversaires leur imputent déjà…
Arrêtons-nous un temps sur la séquence paradigme/braquet/logiciel, emblématique du nouvel ordre langagier. Coordonnée au changement, la variation lexicale emprunte à trois champs discursifs chéris par les élites : sciences humaines, sport, informatique. Pour une même dénotation (le changement de modèle), trois connotations viennent successivement stratifier le signifié fondamental. D’abord, le mystérieux paradigme, alchimie axiale du changement, révolution de la connaissance, totem brandi d’une lointaine épistémologie. On tient notre axe, il convient désormais d’en gravir la pente, ce à quoi le braquet du cycliste va s’employer. Reste à déterminer le rapport pignon/plateau le plus à même de nous faciliter l’ascension vers la croissance. Gageons qu’un logiciel, conçu à cet effet, permettra de libérer dans ses algorithmes la formule optimale du parfait développement. Coordination lexicale, dérivation des valeurs, érosion : la séquence euphémistique affiche toutes les caractéristiques dégagées par Benveniste dans son article sur les « Euphémismes anciens et modernes » [10]. Son analyse, généreuse, nous rappelle que les euphémismes des ploutocrates ne durent qu’un temps, et que la puissance de l’anaphore va toujours s’épuisant.
LE RÈGNE DE LA QUANTITÉ
Mais que consacre, au bout du compte, la langue des élites, et quel règne au juste ferait-elle donc advenir ? Un exemple issu d’un champ traditionnellement marqué « à gauche », le travail social, va nous permettre d’engager notre réflexion. Dans ce secteur, le passage de l’intensif à l’extensif, de la qualité à la quantité, trouve son illustration la plus marquante dans le projet de loi SERAFIN-PH, qui vise à « réformer le modèle tarifaire de prise en charge des « parcours » des personnes handicapées ». Au nom de la sacro-sainte inclusion, l’autorité publique a entrepris d’établir la nomenclature des « besoins » et des « prestations », dans le but avoué d’aboutir à la constitution d’un vocabulaire partagé [sic], vecteur de désinstitutionalisation massive pour nos chers exclus. Inutile de préciser que les actes inhérents à la relation de soin (écoute, parole, accompagnement.) ne font l’objet d’aucune attention particulière dans un tel système de codification. Somme de ses parties – les fameuses prestations extrapolées des mystérieux besoins-, la personne handicapée ou dépendante se retrouve projetée dans l’essoreuse d’un algorithme tarifaire parfaitement autonome. Les murs des institutions ont cédé, les exclus peuvent enfin regagner la cité, une quantité de prestations sous le bras.
Externalisation, atomisation, quantification : le cratolecte continue de porter haut les valeurs de la société néolibérale, sous le manteau de terreur des désignations les plus angéliques. Quel serviteur de l’Etat, au cynisme si abouti, osa donc un jour signer sous la forme de l’acronyme SERAFIN le triomphe des anges de l’inclusion sur le vieux monde des travailleurs de l’exclusion ?

RITES ET MÉRITES
Si l’euphémisme, plus que toute autre figure, joue un rôle central dans la rhétorique du cratolecte, c’est qu’il ne se borne pas à escamoter les relations de pouvoir. Parole incantatoire et bienfaisante, c’est elle qui préside au bon déroulement du discours cultuel dans lequel elle puise son origine, « (…) circonstances dans le culte où l’invitation à ‘parler suspicieusement’ (…), lancée par le héraut oblige d’abord l’assistance à faire cesser tout autre propos. (…) Tout dépend de la nature de la notion que l’on veut rendre présente à l’esprit tout en évitant de la désigner. Si la notion est de celles que la norme morale et sociale réprouve, l’euphémisme ne dure pas ; contaminé à son tour, il devra être renouvelé. » [11] Pas de révolution dans la parole de pouvoir depuis les Grecs : dévalorisation du noble -qu’on songe ici au sort qui a été réservé à la malheureuse bientraitance– ou valorisation de l’ignoble –des accords collectifs agressifs aux frappes préventives-, le discours cultuel continue de marquer son territoire à grand renfort d’euphémismes, repoussant la parole des non-initiés au-delà des frontières de l’audible. Par chance, le cercle des élus peut parfois s’entrouvrir, et les profanes entrevoir l’accès au lieu du culte. Savamment orchestré, le rituel d’intronisation permettra peut-être au prétendant, cadre intermédiaire non assermenté, de rejoindre la caste des grands prêtres en adoptant leur vocabulaire comme leurs pratiques. D’origine religieuse, le séminaire est maintenant décliné à toutes les sauces séculières : colloque universitaire, formation en management, cohésion d’équipe… Il obéit à des formes très codifiées, que Michel Foucault a évoquées dans son analyse des systèmes de restriction : « (…) le rituel définit la qualification que doivent posséder les individus qui parlent (…) ; il définit les gestes, les comportements, les circonstances, et tout l’ensemble des signes qui doivent accompagner leurs discours ; il fixe enfin l’efficace supposée ou imposée des paroles, leurs effets sur ceux auxquels elles s’adressent, les limites de leurs valeurs contraignantes. » [12]
LE LANGAGE EMPÊCHE
Le cratolecte a donc ses lieux du culte – écoles, revues, séminaires – et ses grands ordonnateurs zélés, consultants plus ou moins azimutés ou cyniques, managers re-born (les anciens chefs et patrons) plus ou moins récemment convertis. Ce groupe halluciné, qui a tous les atours d’un mouvement sectaire, s’échine à produire, diffuser, ressasser les éléments de langage du cratolecte. Nous devons combattre cette prolifération nauséabonde. Combat d’une nécessité absolue, à l’échelle de la société, dans la mesure où ces discours sont des armes de conversion idéologique, mais aussi, de manière plus immédiate, à l’échelle de nos champs d’actions syndicaux, parce que le cratolecte est un facteur de souffrance à part entière, une des modalités de la violence organisationnelle. Une violence feutrée, polie, sournoise et destructrice.
L’écart entre ce que vit, ce que ressent le salarié et ce qu’en dit le discours managérial est à ce point abyssal que perte de confiance en soi et perte de sens trouvent vite à prospérer, d’autant plus que ce discours est tenu par une élite. Le procès en illégitimité est ainsi instruit par les personnes elles-mêmes. Et l’incroyable tour de force, c’est que cet outil de pouvoir a parfaitement gommé de son lexique tout ce qui permettrait de nommer les rapports de domination. En adoptant le discours managérial, de manière volontaire, opportuniste, par contagion, par imitation ou inadvertance, on se trouve privé du vocabulaire critique pour le contester, englué dans des éléments de langage qui ne permettent pas d’appréhender la complexité du réel, de désigner ce qui fait conflit. Une sorte de retour à la petite enfance, lorsque les mots disponibles sont insuffisants pour rendre compte des émotions. On pourrait ainsi, par analogie avec la notion de travail empêché, parler de « langage empêché ». Avec toutes les conséquences prévisibles en termes de somatisation, d’impacts sur la santé.
Le cratolecte est tout sauf un simple bruit de fond, il est un vecteur de souffrance. À ce titre il devrait apparaître parmi les facteurs de risques psychosociaux. Pour qui voudrait réellement analyser l’activité de travail, il conviendrait de disséquer l’ensemble des discours produits par les organisations et de mesurer le degré de pénétration du cratolecte.

MENER LA GUÉRILLA LINGUISTIQUE : COMBATTRE LE CRATOLECTE
Le cratolecte étend chaque jour un peu plus son domaine de nuisance. Si certains secteurs ont résisté plus longtemps, on peut désormais affirmer que plus aucun ne lui échappe. Notre conviction profonde est que nous autres, militants syndicaux, avons un rôle majeur à jouer dans la contre-offensive linguistique. Après avoir longuement exposé en quoi cette non-langue pose problème, nous proposons maintenant quelques stratégies de résistance.
Pratiquer le sabotage. Des salariés, ayant fini par s’identifier mutuellement comme résistants au cratolecte au milieu d’une foule amorphe, font un bruit ou un geste chaque fois qu’un élément de langage pré-identifié est prononcé. Les éléments de langage attendus peuvent également avoir été préalablement listés, inscrits sur des bouts de papier puis mélangés. Chaque participant en pioche trois : le premier qui les entend prononcer dit « loto » et gagne le droit de quitter la salle. C’est le loto du management. Nous n’inventons rien, ces stratégies nous ont été rapportées par des pratiquants désespérés d’essuyer dans la solitude le torrent d’immondices qui s’abattait sur eux à chaque réunion.
Proscrire l’utilisation du cratolecte. Refuser d’employer son lexique, l’effacer de nos prises de parole, de nos écrits. Ou l’employer sous condition : management, etc.
Contre-interpeller. À chaque fois que le cratolecte tente d’imposer sa vision hélicoptère, contraindre le cratolocuteur à expliciter : qu’est-ce que vous voulez dire par… ?
Mettre en place des ateliers de désintoxication du cratolecte. De tels ateliers pourraient s’inscrire dans le cadre de nos formations syndicales, et prendre la forme de conférences gesticulées.
Substituer au cratolecte un contre-lexique (à élaborer branche par branche, métier par métier). Certaines terminologies ont contaminé tous les domaines, d’autres sont à exhumer plus localement. Un travail d’élaboration de contre-propositions peut être conduit.
Pratiquer la subversion : jeter un pavé dans la gueule du management. À l’image des Décroissants qui jetèrent jadis un « Pavé dans la gueule de la pub » [13], reprenons à notre compte le procédé classique de détournement de pubs, et réjouissons-nous par avance de l’infini des possibles qu’ouvrent les trésors de conneries déployés par les cratolocuteurs.
[1] « Algérie : changer de nom pour tirer un trait sur le passé colonial ? », Emeline Wuilbercq, 31 janvier 2014.
[2]Sur le « temps réel » et la force de la réaction, voir l’analyse d’Éric Hazan, ibid., p76.
[3]Lire à ce sujet l’excellent article de Clotilde Dozier et Samuel Dumoulin, « La bienveillance, cache-misère de la sélection sociale à l’école », Le Monde diplomatique, septembre 2019.
[4] La novlangue managériale Emprise et résistance, Agnès Vandevelde-Rougale, Editions Erès, Toulouse, 2017, p.25.
[5] Affrontement, combat
[6] De l’interpellation, Jean-Jacques Lecercle, Editions Amsterdam, 2019
[7] Problèmes de linguistique générale, II, ch.6, « Structure de la langue et structure de la société », Emile Benveniste, Editions Gallimard, 1983 (1974), p.98.
[8]Ibid., p.98
[9]Id., p. 100
[10]Problèmes de linguistique générale, I, ch. 26, Paris, Gallimard, 1993 (1966)
[11]Problèmes de linguistique générale, I, ch.26, Emile Benveniste, op. cit., pp.309-10
[12]L’ordre du discours, Leçon inaugurale au Collège de France, Paris, Michel Foucault, Editions Gallimard, 2018 (1971), p. 41
[13] Un pavé dans la gueule de la pub, Casseurs de pub, Editions Parangon/L’Aventurine, 2004.
