Les aléas du droit de grève dans la Constitution
La mise en oeuvre du droit de grève n’est jamais simple. Ce droit permet aux travailleurs de faire valoir des revendications en cessant le travail et en créant de la sorte une contrainte, une gêne pour l’employeur. En réalité, le droit de grève est toujours un droit d’opposition : il vient contrarier, bousculer, contredire les autres droits – essentiellement la liberté d’entreprendre et la liberté d’aller et venir – dans le but précisément de remporter une prétention. À vrai dire, une grève qui ne gêne personne n’a guère d’utilité ; elle est toujours, par nature, un acte de résistance et de conflit. En comparaison, les autres droits constitutionnels n’ont pas le même inconvénient. Évidemment, on peut toujours importuner autrui en s’exprimant, en écrivant, en se déplaçant, en exerçant son droit de propriété, mais il s’agit toujours d’un exercice marginal et heureusement peu courant des libertés. En cela, le droit de grève est depuis longtemps un droit discuté et contesté. Et pourtant…
Droit contesté, le droit de grève est aussi un droit dont l’ancrage constitutionnel est fréquemment souligné. Il est très courant, en effet, de lire dans les décisions du juge judiciaire une référence explicite au « septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », avec souvent un rappel complet de la formulation, y compris dans les décisions des juges du fond et y compris dans le cadre d’affaires tout à fait ordinaires. Ce qui n’est pas si courant. Viendrait-il à l’esprit d’un magistrat de citer l’article 4 de la Déclaration de 1789 pour tous les problèmes touchant la liberté contractuelle ? Les juges font-ils référence à la Constitution toutes les fois qu’est en cause le droit de propriété ? Cela arrive, évidemment, mais les situations sont rares. L’explication tient peut-être au caractère – justement – conflictuel du droit de grève. La référence habituelle à la Constitution dans les jugements évoquant la grève témoigne d’une nécessité argumentative, d’un besoin pour le juge de justifier un phénomène qui vient contrarier de nombreux droits et libertés.
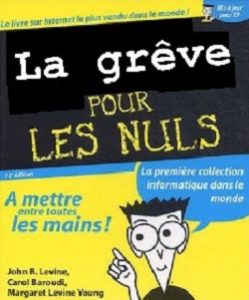 Cette utilisation récurrente du septième alinéa du Préambule de 1946 par les juges judiciaires entraîne une difficulté pratique bien inconfortable pour celui qui cherche – comme c’est le cas ici – à exposer un « droit constitutionnel de la grève », et à trier ce qui est du ressort de la Constitution et ce qui n’en est pas. À vrai dire, tout élément relatif au régime juridique de la grève, jusqu’aux détails les plus infimes, semble découler plus ou moins directement des dispositions de la Constitution. Ceci explique la très grande richesse des manuels de contentieux constitutionnel en matière de grève1, parfois tout autant prolixes que les ouvrages de droit social sur cette question. Il nous semble pourtant que l’attitude du « tout constitutionnel » ne reflète pas la réalité de ce qu’apporte effectivement le droit constitutionnel au droit de grève.
Cette utilisation récurrente du septième alinéa du Préambule de 1946 par les juges judiciaires entraîne une difficulté pratique bien inconfortable pour celui qui cherche – comme c’est le cas ici – à exposer un « droit constitutionnel de la grève », et à trier ce qui est du ressort de la Constitution et ce qui n’en est pas. À vrai dire, tout élément relatif au régime juridique de la grève, jusqu’aux détails les plus infimes, semble découler plus ou moins directement des dispositions de la Constitution. Ceci explique la très grande richesse des manuels de contentieux constitutionnel en matière de grève1, parfois tout autant prolixes que les ouvrages de droit social sur cette question. Il nous semble pourtant que l’attitude du « tout constitutionnel » ne reflète pas la réalité de ce qu’apporte effectivement le droit constitutionnel au droit de grève.
Ici, les chiffres sont d’un secours évident. Ils permettent de dessiner plus nettement les contours du droit de grève dans le quotidien de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Avec un résultat étonnant : en cinquante ans d’existence, le Conseil constitutionnel a rendu… neuf décisions sur le droit de grève2. Seulement. Dans le contentieux de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le constat est encore plus sévère : plus de trois cents décisions QPC rendues à ce jour, dans toutes sortes de domaines, et une seule mentionne le droit de grève, au demeurant « noyé » dans les autres droits sociaux puisque les requérants avaient invoqué de façon très générale une atteinte « aux alinéas cinq à huit du Préambule de la Constitution de 1946 »3.
Cette pauvreté statistique du contentieux constitutionnel de la grève peut s’expliquer par deux considérations. D’abord, il est évident que les décisions du Conseil constitutionnel dépendent des lois contrôlées et il faut bien constater, en matière de grève, un silence relatif du législateur. Peu de lois, donc peu de décisions. En comparaison, il est certainement plus aisé d’invoquer une atteinte à la liberté individuelle ou au principe d’égalité compte tenu du flot important des dispositions législatives dans ce domaine. Ensuite, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si elle a connu une première période plutôt dynamique – on y reviendra -, se caractérise aujourd’hui par un niveau de protection du droit de grève relativement faible. Ce constat pourrait justifier, au moins dans le contentieux QPC, le peu d’entrain des requérants pour dénoncer des atteintes au droit de grève. En tout état de cause, cette faiblesse de la protection constitutionnelle mérite d’être expliquée et discutée. À ce titre, il nous semble que le droit de grève dans le contentieux constitutionnel se caractérise par deux tendances : d’abord une écriture inachevée du principe, une écriture continue, qui fragilise certainement ses fondements ; ensuite un contrôle limité du Conseil constitutionnel, témoignant d’une jurisprudence finalement peu audacieuse.
L’écriture continue du droit de grève
L’écriture d’un principe constitutionnel consiste en une sorte de va-et-vient constant entre le texte de la Constitution et son interprète – essentiellement le Conseil constitutionnel. Le droit de grève n’échappe pas à ce constat. Il se différencie néanmoins des autres droits et libertés par un fondement textuel problématique et dont le Conseil constitutionnel a tenté de cerner les contours avec plus ou moins de bonheur.
A – Les défauts du texte
Selon le septième alinéa du Préambule de 1946, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». La formule est assez neutre, presque asséchée. Elle contraste avec le style lyrique et passionné de la Déclaration de 1789. Elle s’explique néanmoins par le contexte particulier de l’adoption de la Constitution de la IVe République.
En 1946, le constituant français souhaitait prolonger au rang constitutionnel un desserrement progressif des contraintes pesant sur la grève depuis plusieurs décennies.
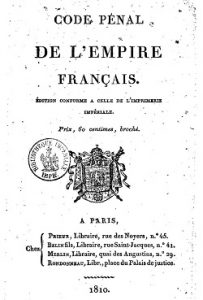
Interdit par le code pénal de 18104, le phénomène va se diffuser lentement dans la société française à la Restauration, sans être autorisé toutefois par le droit. En réalité, au XIXe siècle, la grève n’est pas combattue en elle-même par le pouvoir étatique. C’est davantage son parfum contestataire qui est en cause, parce qu’elle suppose une liberté de réunion considérée comme le terreau de toute opposition. Les révolutionnaires l’avaient compris et ils vont bien se garder de consacrer les libertés « collectives » dans la Déclaration. Peu à peu, les esprits évoluent. À la fin de la Monarchie de Juillet, la pratique des « banquets républicains » s’intensifie. Dans ces banquets, se mêlent les débats d’idées les plus divers, y compris en matière professionnelle. Le pouvoir politique accepte progressivement les groupements et la répression se fait moins pressante. La IIe République, dans son élan réformateur, ouvre la porte au droit de grève, mais la chute rapide des institutions entraîne avec elle les revendications des travailleurs. Finalement, il faut attendre la toute fin du Second Empire5 et la loi du 25 mai 1867 pour que les « cessations concertées du travail »6 soient enfin autorisées.
D’un point de vue constitutionnel, la IIIe République est une parenthèse : elle ne consacre aucun droit, aucun principe, et c’est la première fois – ce sera d’ailleurs la dernière – que le constituant ne met pas en chantier une nouvelle déclaration de droits. Logiquement, le droit de grève n’est pas consacré au rang constitutionnel à cette époque. Il faut donc attendre la Libération et l’écriture d’une nouvelle Constitution pour que le principe soit enfin proclamé dans les lignes du nouveau Préambule.
D’une manière générale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le peuple français souhaite consacrer les droits de « l’homme situé »7 : non plus l’Homme abstrait de 1789, mais l’Homme en famille, l’Homme aux loisirs, l’Homme « en tant que femme » et, évidemment, l’Homme au travail. À ce titre, l’intention des constituants de reconnaître un authentique droit constitutionnel de grève était à la fois louable et conforme à l’évolution des moeurs de la société française à cette époque. Malheureusement, le résultat ne va pas être complètement satisfaisant…
Au mois d’avril 1946, un premier projet de Constitution est présenté aux électeurs. Il contient une « déclaration de droits » qui annule et remplace la vieille Déclaration de 1789 et qui contient un « droit de grève reconnu à tous » (art. 32). Mais les Français refusent. Il faut réécrire rapidement un nouveau texte pour éviter un vide juridique qui serait désastreux pour le pays. La Commission se met au travail à l’été 1946 et, malheureusement, le droit de grève va subir plus que d’autres les conséquences de l’échec du premier projet.
En effet, dans le premier texte présenté aux citoyens, le droit de grève était rédigé de la sorte : « Le droit de grève est reconnu à tous dans le cadre des lois qui le réglementent ». L’important était bien de reconnaître à tous un droit de grève, avec une précision – mais cela n’était qu’une précision – selon laquelle la loi doit définir les contours du principe nouvellement consacré. Entre le texte du mois d’avril rejeté par les Français, et celui du mois d’octobre finalement adopté, la formule « reconnu à tous », qui faisait toute la force et l’intérêt du droit de grève, a disparu pour laisser place au texte que l’on connaît aujourd’hui. À la lecture des travaux parlementaires, il apparaît que ce changement de formulation ne témoigne pas d’une volonté des constituants de restreindre le droit de grève, ni même de lui ôter son caractère « universel ». À plusieurs reprises, le rapporteur de la Commission a indiqué que le texte avait une vocation générale et qu’il reviendrait à la loi d’y instaurer les limites nécessaires8. La raison du changement de formule est, à vrai dire, plus factuelle.
Au mois de mai 19469, quelques semaines après le rejet du premier projet de Constitution, les parlementaires adoptent une loi qui interdit aux producteurs et aux paysans de « retenir les stocks » de marchandises produites, ce qui est considéré à l’époque comme une interdiction à peine déguisée, pour les agriculteurs, de se mettre en grève10. Il s’agissait alors d’éviter qu’un mouvement paysan ne vienne accentuer la pénurie des denrées alimentaires et freiner la reconstruction du pays après la Libération. Au nom de l’intérêt général, les parlementaires avaient donc adopté cette disposition particulièrement attentatoire à la liberté des producteurs. Et, de fait, le droit de grève n’était pas reconnu… à tous. Ainsi, au mois d’août 1946, au moment de rédiger le nouveau projet de Constitution, il était donc bien délicat, pour les parlementaires, de reconnaître un droit de grève « à tous » alors même que, précisément, une loi venait de contester cette universalité. Certains députés s’en offusquèrent lors des débats11, mais le rapporteur de la Commission écarta les inquiétudes en indiquant que cette nouvelle rédaction du droit de grève n’aurait aucune conséquence sur la portée du principe12. Et finalement, ce qui était secondaire, ce qui était accessoire dans le principe initialement consacré – « [il] s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » – est devenu, au gré d’un changement de formulation, l’élément central du septième alinéa.
B – Les corrections de la jurisprudence
La formulation relativement pauvre et d’une certaine manière énigmatique du droit de grève appelait des précisions du juge. En 1946, le Préambule n’est pas encore « justiciable ». La Constitution de la IVe République organise bien un contrôle de constitutionnalité, mais son article 92 exclut expressément les droits fondamentaux du champ de compétence du « Comité constitutionnel ». Logiquement, les premières précisions viennent donc du juge ordinaire. Avec, en premier lieu, l’arrêt Dehaene du Conseil d’État du 7 juillet 195013. Au-delà de la solution bien connue à propos des fonctionnaires, cet arrêt est avant tout important en ce qu’il consacre la valeur normative du droit de grève et son application directe en l’absence de loi « faisant écran ».
Pour le Conseil constitutionnel, il faut attendre la décision du 25 juillet 197914. Dans cette décision, le Conseil reconnaît pour la première fois la valeur constitutionnelle du droit de grève en considérant que, « aux termes du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : “Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent” ; qu’en édictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». En réalité, cette décision est une retranscription assez fidèle de l’arrêt Dehaene, mais avec une différence fondamentale : le Conseil constitutionnel précise bien – contrairement au Conseil d’État – que le droit de grève est « un principe de valeur constitutionnelle ». En cela, il souligne la pleine effectivité du principe et son insertion dans le bloc de constitutionnalité. À l’époque, c’est-à-dire à la fin des années 1970, beaucoup s’interrogeaient sur la valeur normative des principes sociaux du Préambule de 1946, et notamment le droit de grève en raison de la formulation elliptique du septième alinéa. Avec cette décision, le Conseil consacre ainsi, pour la première fois, la valeur réellement constitutionnelle du droit de grève.
Autre précision importante, dans sa décision du 25 juillet 1979, le juge constitutionnel détaille le contenu de cet « intérêt général » susceptible de limiter le droit de grève : pour les services publics, il s’agit du principe de continuité du service public qui possède également une valeur constitutionnelle. Autrement dit, tout intérêt général ne peut justifier une atteinte au droit de grève. Seul un intérêt général lui-même de valeur constitutionnelle autorise une méconnaissance du septième alinéa. Ce constat offre au droit de grève – au moins en théorie – une protection renforcée en comparaison des autres droits et libertés. Beaucoup de principes constitutionnels ne nécessitent pas, en effet, un intérêt général particulier, un intérêt général plus important, de niveau constitutionnel. À ce jour, le Conseil a identifié trois sortes de principe susceptibles de justifier une atteinte au droit de grève : le principe de continuité des services publics, le principe de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens15 et, plus récemment, le très classique principe du respect de l’ordre public16.
En dehors de ces deux aspects – consécration expresse du droit de grève et nécessité d’un intérêt général lui-même de rang constitutionnel -, le Conseil constitutionnel n’a malheureusement pas apporté au droit de grève les précisions nécessaires qu’il méritait. Deux exemples en témoignent.
En premier lieu, il est courant de lire que le Conseil aurait forgé, dans sa jurisprudence, une authentique définition constitutionnelle du droit de grève. Notons d’emblée qu’il est peu courant pour le juge constitutionnel de définir les principes et les notions contenues dans la Constitution. Le travail de définition est avant tout un travail doctrinal. Cela dit, il arrive que le juge se prête au jeu des définitions, la plupart du temps lorsqu’il est nécessaire de tracer la frontière entre une pratique qui serait protégée par la Constitution et une autre qui ne le serait pas. En matière de grève, une définition de la notion apparaît dès la première décision du 25 juillet 1979. En l’espèce, le juge constitutionnel évoque la grève comme « la cessation concertée du travail ». La formule n’est guère originale, mais elle a le mérite de s’inspirer de la jurisprudence bâtie de longue date par le juge judiciaire et reprise fréquemment par le législateur. Cela posé, il faut souligner que le Conseil constitutionnel n’a évoqué cette définition de la grève que dans trois décisions seulement, toutes avant les années 1990, et toutes à propos des services publics17. Mieux : dans les trois cas, il s’agissait en réalité d’une expression empruntée directement à la loi contrôlée18. En réalité, toutes les fois où le juge constitutionnel s’est référé à la « cessation concertée du travail », c’est en référence au texte examiné qui contenait lui-même cet énoncé. Il semble donc exagéré de dire que le Conseil aurait consacré, dans sa jurisprudence, une définition « constitutionnelle » du droit de grève. À vrai dire, il a surtout recopié une expression retenue par les lois déférées, comme il le fait au demeurant assez souvent.
Autre « précision » apportée par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence et qui mérite quelques précisions : la notion de « besoin essentiel du pays ». Cette notion apparaît également dès la première décision du 25 juillet 1979. Elle permet au juge constitutionnel de justifier les atteintes au droit de grève – par exemple l’instauration d’un service minimum – lorsque l’activité en cause correspond à un « besoin essentiel du pays ». Il faut noter que cette notion est une invention du Conseil constitutionnel. À notre connaissance, elle n’apparaît pas dans les décisions du Conseil d’État ou de la Cour de cassation avant 1979. Ce qui pose un problème d’interprétation : que faut-il entendre précisément par « besoin essentiel du pays » ? Une certitude : la notion paraît plus large que celle d’ordre public puisqu’elle permet de justifier un grand nombre de limitations apportées au droit de grève. Un exemple : dans sa décision du 12 avril 201319, le Conseil d’État admet la restriction du droit de grève des salariés d’EDF en invoquant – justement – la nécessité de préserver un « besoin essentiel du pays ». Jusqu’à cette décision, il n’avait jamais mobilisé cette notion inventée par le Conseil constitutionnel. Et pour cause : la jurisprudence Dehaene évoque la protection de l’ordre public, ce qui suffit normalement pour autoriser l’intervention des autorités administratives en matière de grève. Mais pas toujours… En l’espèce, le mouvement des grévistes n’avait suscité aucune violence contre les biens ou les personnes, et il était particulièrement délicat pour le Conseil d’État de constater une atteinte à l’ordre public. Une solution s’offrait à lui : autoriser les restrictions du droit de grève des salariés d’EDF en invoquant judicieusement… les « besoins essentiels du pays ». Évidemment, cette décision se justifie par le particularisme de l’espèce, à savoir un mouvement de grève dans une centrale nucléaire. Mais demain : les pharmacies, les restaurants, les supermarchés ?
La protection limitée du droit de grève
Il n’est guère facile d’apprécier le niveau de protection d’un principe constitutionnel. Si le nombre de censures est un élément important, il n’est pas le seul et il n’est pas toujours déterminant. Le Conseil constitutionnel peut, en effet, exiger un intérêt général plus ou moins fort ; il peut aussi exercer un contrôle plus ou moins serré des intentions du législateur ; il peut enfin encadrer plus ou moins fermement l’application de la loi en utilisant ses fameuses « réserves d’interprétation ». L’ensemble de ces éléments dessine une sorte de tableau général, parfois très explicite, souvent impressionniste. Quoi qu’il en soit, en matière de droit de grève, le résultat n’est pas encourageant. Deux éléments en témoignent : un contrôle très limité de la compétence exclusive du législateur et une faible protection du régime juridique de la grève.
A – La protection limitée de la compétence du législateur
Le septième alinéa du Préambule de 1946 n’est pas bavard, mais il est assez clair sur un point : le droit de grève doit s’exercer dans le cadre des lois votées par le législateur. Et seulement lui. Ce qui exclut, par un raisonnement a contrario somme toute logique, l’intervention d’autres autorités – publiques ou privées. À vrai dire, il existe peu de principes constitutionnels qui exigent l’intervention exclusive du Parlement. Si l’on excepte les droits environnementaux adoptés en 2005, le droit de grève est en réalité le seul. Ailleurs, la compétence du législateur se déduit tantôt de la tradition légicentriste française, hostile à l’intervention de l’administration en matière de droits fondamentaux, tantôt de l’article 34 de la Constitution qui exige une action des parlementaires dès lors qu’est en jeu une question touchant l’exercice des « libertés publiques ». En revanche, pour le droit de grève, le principe est nettement posé par la disposition même qui le consacre : seul le législateur est compétent. Mais compétent pour quoi ?
Ici commence le travail interprétatif du Conseil constitutionnel. Normalement, « réglementer » un droit, c’est déterminer l’ensemble de son périmètre juridique : les titulaires, les exceptions, les permissions, les interdictions. Mais dès le début de sa jurisprudence, le juge constitutionnel a adopté une interprétation très restrictive du septième alinéa en estimant que la « réglementation » était simplement synonyme de « limitation » : « Les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci »20. Précision anodine en apparence, mais en réalité très importante : le législateur est compétent pour tracer les « limites », nous dit le Conseil constitutionnel, et seulement les limites ; en dehors de ces limites, une autre autorité peut toujours intervenir pour… réglementer le droit de grève. Et ainsi, le droit de grève « qui s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » s’est transformé en un droit de grève « qui s’exerce dans le cadre des textes qui le réglementent ».
À ce propos, la doctrine oppose souvent la jurisprudence du Conseil d’État et celle du Conseil constitutionnel. Le premier, dans son arrêt Dehaene, aurait autorisé le gouvernement à réglementer de façon générale le droit de grève – en méconnaissance de la Constitution, donc. Le second aurait au contraire réservé cette compétence au seul législateur. L’affirmation possède sa part de vérité, mais il faut la nuancer. Car, à vrai dire, il est exagéré de dire que le Conseil constitutionnel réserve la réglementation du droit de grève au seul législateur. On l’a vu : il existe des cas pour lesquels il admet l’intervention d’autres autorités dès lors que cette intervention ne « limite » pas le droit de grève. Et, évidemment, la marge de manoeuvre de l’administration dépend de l’appréciation qui est faite, par le Conseil constitutionnel, de cette limitation. Ce qui pose justement de nombreuses difficultés.
À ce jour, en dehors du Parlement, le Conseil constitutionnel a admis l’intervention de deux autorités différentes pour « réglementer » le droit de grève : l’autorité administrative et les partenaires sociaux.
Le premier cas n’est pas spécifique au droit de grève. Depuis toujours, ou presque21, le Conseil constitutionnel autorise l’intervention du gouvernement pour mettre en oeuvre les lois votées, notamment dans le domaine des droits sociaux. Sur ce point, le droit de grève ne fait pas exception. Dans trois décisions relatives à la grève22, le Conseil constitutionnel a ainsi admis la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer les « modalités d’application » des dispositions adoptées. À chaque fois, le juge a vérifié que la loi encadrait suffisamment la délégation de compétence accordée au gouvernement – ce qui est évidemment une bonne chose pour le droit de grève. Il reste que, depuis 1979, aucune délégation n’a été jugée contraire à la Constitution…
Le second cas est plus problématique. Le Conseil constitutionnel admet également une délégation de compétence aux partenaires sociaux eux-mêmes. En effet, depuis sa décision du 25 juillet 198923, il autorise une intervention des conventions collectives pour « déterminer les modalités concrètes de mise en oeuvre des lois », c’est-à-dire pour édicter de véritables mesures d’applications des normes législatives – ce qui est en principe une compétence du pouvoir réglementaire. Cette jurisprudence très favorable à l’intervention des partenaires sociaux est justifiée par une disposition constitutionnelle : le huitième alinéa du Préambule de 1946 qui invite les travailleurs à participer, par le biais de leurs délégués – c’est l’élément important -, à la détermination collective des conditions de travail. Cela dit, il existait un doute quant à l’application de cette jurisprudence en matière de droit de grève pour deux raisons. D’abord car la Cour de cassation, de son côté, n’admet pas que les partenaires sociaux interviennent pour réglementer le droit de grève. L’arrêt Société Transports Séroul du 7 juin 199524 est assez clair à ce sujet. Ensuite car, contrairement à d’autres domaines du droit du travail, il existe justement une disposition dans la Constitution – le septième alinéa du Préambule de 1946 – qui réserve au législateur, et à lui seul en principe, le soin de réglementer le droit de grève.
En dépit de ces arguments, le Conseil constitutionnel a fait le choix d’une solution bien différente. En effet, il a admis, dans sa décision du 16 août 2007, la conclusion de conventions collectives afin « de préciser les modalités d’application des règles fixées pour l’exercice du droit de grève ». Cette solution renforce considérablement la négociation collective et le droit à participation des travailleurs – certains diront que le « cadeau » s’adresse en premier lieu aux syndicats et non aux travailleurs… Pour le droit de grève, en revanche, la situation est moins plaisante. Au final, la formule du septième alinéa du Préambule « s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » n’emporte plus guère de conséquences particulières : en réalité, le droit de grève peut être « réglementé » aussi bien par l’autorité administrative que par les conventions collectives.
B – La protection limitée du régime juridique de la grève
Au-delà des problèmes de compétences, le juge est également intervenu pour préciser les règles constitutionnelles entourant le régime juridique du droit de grève.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a précisé qui sont les titulaires du droit de grève. Deux questions se sont posées à cet égard.
La première, assez classique, est celle de savoir si les fonctionnaires sont, ou non, des titulaires du droit consacré par le septième alinéa du Préambule de 1946. Question classique, mais légitime : de nombreuses lois adoptées après 1946 ont refusé de reconnaître le droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires25. Il faut dire aussi que la question est loin d’être tranchée dans la doctrine et qu’elle alimente régulièrement les colonnes des revues juridiques jusqu’au milieu des années 198026. En dépit de ce débat, le Conseil a très rapidement pris position en faveur d’une conception « universelle » du droit de grève : dès la première décision du 25 juillet 197927, il a admis l’application du septième alinéa « aux services publics ». En principe, le droit de grève est donc reconnu aux fonctionnaires. En pratique toutefois, le juge constitutionnel se montre extrêmement tolérant quant aux limitations imposées par la loi dans la fonction publique. À ce titre, il adopte une formulation très ambiguë dans son considérant de principe puisqu’il admet « jusqu’à l’interdiction du droit de grève à certains agents ». Or, normalement, la loi ne peut interdire le droit de grève à certains agents puisque la Constitution elle-même proclame un droit en la matière. À proprement parler, la loi peut seulement interdire l’exercice du droit de grève. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel est souvent très indulgent avec le Parlement : par exemple, il admet la mise en place d’un service minimum28, il admet aussi une retenue sur salaire plus que proportionnelle au montant du traitement29, il autorise également la procédure de préavis30, et il admet enfin l’intervention obligatoire des syndicats dans le déclenchement des mouvements31. Tout cela contribue à une protection plutôt sommaire du droit de grève des fonctionnaires.
La deuxième question qui se pose à propos des titulaires du droit de grève est celle du rôle des syndicats. Les syndicats sont un rouage fondamental de la démocratie sociale. Ils sont souvent les artisans majeurs des grandes avancées en matière de droit du travail et constituent un relais indispensable entre les salariés, souvent dispersés, et les employeurs ou les pouvoirs publics. Cela posé, le droit de grève ne peut pas être un « droit » des syndicats. De la même manière que les partis politiques structurent les élections, mais ne remplacent jamais les électeurs, les syndicats ne peuvent pas être les véritables titulaires du droit de grève. Malheureusement, dans la fonction publique, la loi confie souvent aux organisations syndicales un rôle primordial, notamment pour la mise en oeuvre des mouvements. La doctrine s’en est souvent offusquée32 – à raison -, mais le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré ces dispositifs en considérant que « le rôle reconnu aux organisations syndicales pour le dépôt d’un préavis de grève laisse entière la liberté de chaque salarié de décider de participer personnellement ou non à celle-ci »33. Ce qui est vrai : le travailleur peut décider de participer, mais c’est bien le seul choix qu’il peut exercer ; à vrai dire, il n’a malheureusement pas le droit de décider d’exercer son droit de grève, il peut simplement choisir de se joindre ou non à un mouvement engagé ailleurs, au niveau des instances syndicales.
Au-delà du problème des titulaires, se pose la question des conditions de mise en oeuvre de la grève. Ici aussi, le Conseil constitutionnel a précisé un certain nombre d’éléments qui limitent sensiblement le niveau de protection du droit de grève.
À ce titre, le juge constitutionnel est intervenu dans plusieurs décisions pour statuer sur la constitutionnalité des mécanismes de « déclaration préalable ». En effet, certains textes exigent, en matière de services publics, une déclaration préalable des agents qui souhaitent rejoindre un mouvement de grève. Ce système n’a rien d’anodin. Normalement, les libertés publiques se caractérisent par un régime dit « répressif », c’est-à-dire que les individus exercent librement les activités concernées et c’est seulement en cas d’abus que les autorités publiques peuvent « réprimer » les comportements anormaux. Parfois, néanmoins, certaines libertés sont soumises à un régime plus contraignant, le régime de la déclaration préalable : ici, l’exercice de la liberté est conditionné par l’information obligatoire d’une autorité. C’est le cas, par exemple, de la liberté de réunion sur la voie publique. En tout état de cause, le système doit rester exceptionnel. Or, justement, le Conseil constitutionnel a admis avec beaucoup de facilité ce mécanisme de la déclaration préalable à propos du droit de grève. Par exemple, à propos des enseignants, il a estimé dans sa décision du 7 août 200834 que le système était conforme à la Constitution. Preuve, là aussi, que le niveau de protection constitutionnelle du droit de grève demeure très relatif.
Autre élément significatif : l’obligation d’un préavis. Cette obligation est intimement liée à celle d’une déclaration préalable. Il s’agit d’une restriction notable du droit de grève puisque le travailleur doit respecter un délai minimal entre le moment où il informe les autorités compétentes de son intention de se mettre en grève et le moment où il exerce effectivement son droit. En matière de préavis, tout est affaire de degré. Un préavis assez court pourra être considéré comme justifié par les travailleurs ; à l’inverse, un préavis trop long prendra les traits d’une interdiction déguisée. Dans sa décision du 16 août 200735, le Conseil constitutionnel estime qu’un délai de treize jours imposé pour certains travailleurs permet « une négociation effective » et qu’il « n’apporte pas de restriction injustifiée aux conditions d’exercice du droit de grève ». Outre le fait que le juge constitutionnel ne justifie guère sa solution, il est tout de même permis de penser que ce délai de treize jours est relativement important et qu’il méritait peut-être d’être évalué avec plus de fermeté.
La protection du droit de grève par le Conseil constitutionnel n’est sans doute pas irréprochable, mais le contentieux en la matière n’est pas figé. La nouvelle procédure de la QPC est un moteur puissant d’évolution : les avocats, les syndicats et même les travailleurs se saisissent lentement mais sûrement de ce nouvel instrument. Dans ce contexte, nul doute que le droit de grève fera l’objet de nouvelles décisions et qu’il sera commenté, discuté, défendu ou contesté. À l’évidence, le droit de grève n’est pas un droit qui laisse indifférent. Mais après tout, c’est peut-être là sa plus grande qualité !
Pierre-Yves Gahdoun – Avril 2014
1 En ce sens, par ex., B. Mathieu et M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002. 599 s. – T. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel, Litec, 2004. 258 s.
2 Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Rec. Cons. const. 33 – Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-117 DC, Rec. Cons. const. 42 – Cons. const., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, Rec. Cons. const. 15 – Cons. const., 18 sept. 1986, n° 86-217 DC, Rec. Cons. const. 141 – Cons. const., 28 juill. 1987, n° 87-230 DC, Rec. Cons. const. 48 – Cons. const., 16 août 2007, n° 2007-556 DC, D. 2007. 3033, obs. E. Dockès, F. Fouvet, C. Géniaut et A. Jeammaud ; ibid. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Dr. soc. 2007. 1221, étude V. Bernaud ; RFDA 2007. 1283, chron. A. Roblot-Troizier ; Rec. Cons. const. 31 – Cons. const., 7 août 2008, n° 2008-569 DC, AJDA 2008. 1565 ; ibid. 2410 , note M. Verpeaux ; D. 2008. 2064 et les obs. ; Dr. soc. 2009. 147, étude V. Bernaud ; RFDA 2008. 1233, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; Rec. Cons. const. 359 – Cons. const., 15 mars 2012, n° 2012-650 DC, AJDA 2012. 574 ; Dr. soc. 2012. 708, étude V. Bernaud ; Constitutions 2012. 333, obs. C. Radé ; Rec. Cons. const. 149 – Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC, AJDA 2013. 1252 ; ibid. 2014. 142, étude Emilien Quinart ; RDT 2013. 565, obs. C. Wolmark ; RDSS 2013. 639, note S. Brimo ; Constitutions 2013. 408, chron. M. Ghevontian ; JO 16 juin, p. 10025. V. également, Cons. const., 22 oct. 1982, n° 82-144 DC, Rec. Cons. const. 61 – Cons. const., 20 juill. 1988, n° 88-244 DC, Rec. Cons. const. 119 et n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, Rec. Cons. const. 78 (dans ces décisions, le droit de grève est cité sans être contrôlé).
3 Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC, AJDA 2013. 1252 ; ibid. 2014. 142, étude Emilien Quinart ; RDT 2013. 565, obs. C. Wolmark ; RDSS 2013. 639, note S. Brimo ; Constitutions 2013. 408, chron. M. Ghevontian ; JO 16 juin, p. 10025.
4 C. pén. 1810, art. 415, qui interdit les coalitions d’ouvriers « pour faire cesser en même temps de travailler ».
5 L. 6 juin 1868.
6 L. 25 mai 1864, qui supprime le délit de coalition, mais le remplace par un délit d’atteinte « au libre exercice de l’industrie ou du travail » (art. 414 du code pénal).
7 G. Burdeau, La démocratie, 1956, coll. « Politique », Seuil, 1978.
8 V. not. Assemblée nationale constituante, 2e séance du 19 mars 1946, JO 20 mars, p. 881.
9 L. n° 46-1024, 14 mai 1946.
10 « Les paysans n’ont pas le droit de retenir leurs produits, sous peine de tomber sous le coup de la loi du 14 mai 1946. Cette loi, nous l’avons adoptée sans débat, parce qu’il fallait donner au ministère du Ravitaillement les armes qu’il demandait, mais il est certain que, ce jour-là, nous avons porté à la paysannerie un coup considérable », intervention de M. de Sesmaisons, séance du 28 août 1946, JO 29 août, p. 3371.
11 Ibid.
12 « Je donne d’ailleurs toute garantie à l’orateur : il n’est nullement question de faire de distinctions entre les différentes catégories de travailleurs », ibid., p. 3371.
13 CE, ass., 7 juill. 1950, Dehaene, Lebon 426 ; RD publ. 1950, 691, concl. F. Gazier, note M. Waline.
14 Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Rec. Cons. const. 33.
15 Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-117 DC, Rec. Cons. const. 42.
16 « En imposant aux salariés des entreprises entrant dans le champ d’application de la loi d’informer leur employeur de leur intention de participer à un mouvement de grève, le législateur a entendu mettre en place un dispositif permettant l’information des entreprises de transport aérien ainsi que de leurs passagers afin, notamment, d’assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l’ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle », Cons. const., 15 mars 2012, n° 2012-650 DC, AJDA 2012. 574 ; Dr. soc. 2012. 708, étude V. Bernaud ; Constitutions 2012. 333, obs. C. Radé ; Rec. Cons. const. 149.
17 Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Rec. Cons. const. 33 – Cons. const., 18 sept. 1986, n° 86-217 DC, Rec. Cons. const. 141 – Cons. const., 28 juill. 1987, n° 87-230 DC, Rec. Cons. const. 48.
18 Pour la décision de 1979, elle visait à contrôler la « loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail » ; pour la décision de 1986, selon l’article 57 de la loi contestée : « En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou à la société prévue à l’article 51 […] » ; enfin, pour la décision de 1987, la loi du 30 juill. 1987, qui fait l’objet du contrôle, abrogeait l’article 2 de la loi du 19 oct. 1982 évoquant une « cessation concertée du travail ».
19 CE, 12 avr. 2013, n° 329570, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines, au Lebon ; AJDA 2013. 766 ; ibid. 1052 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; Dr. soc. 2013. 608, note P.-Y. Gahdoun ; RFDA 2013. 637, concl. F. Aladjidi ; ibid. 663, chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau .
20 Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Rec. Cons. const. 33.
21 Cons. const., 11 juin 1963, n° 63-5 FNR, Rec. Cons. const. 37.
22 Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Rec. Cons. const. 33 – Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-117 DC, Rec. Cons. const. 42 – Cons. const., 16 août 2007, n° 2007-556 DC, D. 2007. 3033, obs. E. Dockès, F. Fouvet, C. Géniaut et A. Jeammaud ; ibid. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Dr. soc. 2007. 1221, étude V. Bernaud ; RFDA 2007. 1283, chron. A. Roblot-Troizier ; Rec. Cons. const. 31.
23 Cons. const., 25 juill. 1989, n° 89-257 DC, Rec. Cons. const. 59.
24 Soc., 7 juin 1995, n° 93-46.448, Sté Transports Séroul, Bull. civ. V, n° 180 ; D. 1996. 75 , note B. Mathieu ; Dr. soc. 1995. 835, obs. J.-E. Ray ; ibid. 1996. 37, note C. Radé ; RDSS 1996. 115, obs. J.-M. Lhuillier ; RTD civ. 1996. 153, obs. J. Mestre .
25 L. n° 48-1504, 28 sept. 1948, relative au statut spécial des fonctionnaires de police (art. 2) ; L. n° 58-1270, 22 déc. 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (art. 10) ; L. n° 72-662, 13 juill. 1972, portant statut général des militaires (art. 11).
26 En ce sens, par ex., D. Loschak, La dégradation du droit de grève dans les services publics, Dr. soc. 1976. 56.
27 Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Rec. Cons. const. 33.
28 Ibid.
29 Cons. const., 28 juill. 1987, n° 87-230 DC, Rec. Cons. const. 48.
30 Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, Rec. Cons. const. 33.
31 Cons. const., 18 sept. 1986, n° 86-217 DC, Rec. Cons. const. 141.
32 Not. S. Dion-Loye et B. Mathieu, Le syndicat, le travail et l’individu, trois personnages en quête d’un rôle constitutionnellement défini, Dr. soc. 1990. 532 .
33 Cons. const., 16 août 2007, n° 2007-556 DC, D. 2007. 3033, obs. E. Dockès, F. Fouvet, C. Géniaut et A. Jeammaud ; ibid. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Dr. soc. 2007. 1221, étude V. Bernaud ; RFDA 2007. 1283, chron. A. Roblot-Troizier ; Rec. Cons. const. 31.
34 Cons. const., 7 août 2008, n° 2008-569 DC, AJDA 2008. 1565 ; ibid. 2410 , note M. Verpeaux ; D. 2008. 2064 et les obs. ; Dr. soc. 2009. 147, étude V. Bernaud ; RFDA 2008. 1233, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; Rec. Cons. const. 359.
35 Cons. const., 16 août 2007, n° 2007-556 DC, D. 2007. 3033, obs. E. Dockès, F. Fouvet, C. Géniaut et A. Jeammaud ; ibid. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Dr. soc. 2007. 1221, étude V. Bernaud ; RFDA 2007. 1283, chron. A. Roblot-Troizier ; Rec. Cons. const. 31.
- Les aléas du droit de grève dans la Constitution - 6 juin 2017



