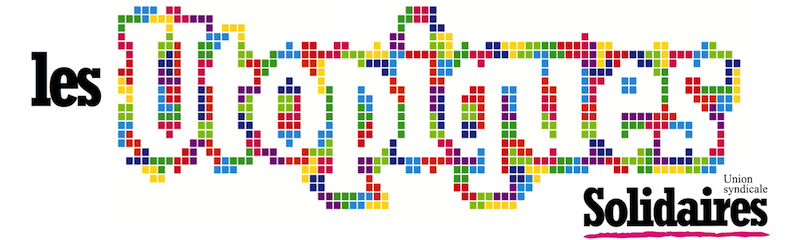Syndicalistes face au fascisme
Il est rarement fait mention du rôle des syndicalistes pendant la Seconde guerre mondiale. Pourtant face à l’occupation allemande et au régime de Vichy, de nombreux syndicalistes organisèrent des actions de résistance. Le rôle des syndicalistes fut suffisamment significatif pour que les deux centrales, la CGT (réunie pendant la guerre en 1943) et la CFTC, soient partie prenante du Conseil national de la Résistance (CNR). Le temps de l’occupation puis le temps de la résistance sont aussi des temps où se bousculent les règles du syndicalisme tel que constitué depuis le début du XXe siècle. En effet, plus que jamais, les syndicalistes assument un rôle qui rencontrent l’action politique. A ce titre, le caractère révolutionnaire du syndicalisme s’affirme, ce qui les autorisera d’ailleurs probablement à faire avancer de nombreuses transformations au sein du CNR. A l’heure où l’extrême-droite a les clés du pouvoir, un retour sur les pratiques et questionnements des militants syndicaux n’est pas inutile.
Conceptrice-animatrice d’ateliers de philosophie, Anouk Colombani est membre de SUD Culture Solidaires et de l’union interprofessionnelle Solidaires Seine-Saint-Denis (93) dont elle est co-secrétaire. Elle est également une des animatrices du site ruedelacommune.com et des activités liées.
![Le recto du premier numéro clandestin de La Vie ouvrière, en janvier 1940 ; reproduit dans 1940-1944, Les V.O. de la nuit, éditions de La Vie ouvrière, 1984 ; [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/7-Illust1-Colombani-Syndicalistes-face-au-fascisme-713x1024.webp)
Un syndicalisme au fond du trou
Rappelons d’abord un élément central. Après le Front populaire, le syndicalisme vit une période de crise grave. La crise résulte notamment de la droitisation de la vie politique à partir de 1938. Un événement marquant est la réaction au 12 novembre 1938, date à laquelle Edouard Daladier publie des décrets remettant en causes les conquêtes du Front populaire et en particulier la semaine de 40 heures. La CGT appelle à la grève le 30 novembre. La répression est terrible, avec notamment 800 000 ouvriers licenciés mais aussi 1731 procédures judiciaires pour entrave à la liberté du travail et 806 peines de prison ferme requises dont une centaine à plus de deux mois d’emprisonnement [1].
![Verso du numéro clandestin de La Vie ouvrière, en mars 1941 ; reproduit dans 1940-1944, Les V.O. de la nuit, éditions de La Vie ouvrière, 1984. [Coll. CM]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/7-Illust2-Colombani-Syndicalistes-face-au-fascisme-744x1024.webp)
Entre décapitation des militants et départs volontaires pour désaccord avec la stratégie, la CGT est largement impactée. Les 4 millions du Front populaire sont fort éloignés. L’élan de 1936 est derrière, l’année 1939 est difficile et la CGT passe sous le million avec le déclenchement de la guerre. Avec la guerre, ce sont plus d’un million de conscrits [2] issus des rangs cégétistes qui disparaissent à nouveau. Enfin, l’ex-partie « confédérée » de la CGT, organisée autour de Léon Jouhaux, décide fin septembre 1939 la mise au ban de la partie dite unitaire -les communistes- à la suite de l’invasion de la Pologne par l’URSS (conséquence du pacte germano-soviétique). Les communistes, autour de Benoit Frachon, publient un texte, « Pour l’unité du syndicalisme », dans lesquels ils en appellent à l’unité ouvrière contre les impérialismes, mais ils sont démis de leurs mandats. Si certains entrent en clandestinité comme Benoit Frachon. D’autres sont arrêtés dès le 18 octobre, comme Henri Raynaud.
Des syndicalistes peuvent-ils être clandestins ? La mise au ban des communistes
Dès novembre 1939, apparait pour les syndicalistes apparentés communistes la question de la clandestinité. Après quelques semaines dispersées, l’action reprend. En janvier 1940, reparait La Vie ouvrière, le journal de la CGT, qui informe de la stratégie à tenir. A partir de mars, sont lancés des comités pour l’indépendance et l’unité du mouvement syndical. Ces comités ont leur importance car ils permettent une sorte de double du syndicat. Si les communistes n’occupent plus les mandats, leur organisation leur permet tout de même d’influer sur la ligne voire, de diriger le syndicat depuis les cellules clandestines. Les historiens ont ainsi trouvé dans les archives des rapports de police attestant du caractère « fictif » des nouveau dirigeants de syndicats locaux. Morgan Poggioli résume ainsi l’action de ces comités : « Elle se traduit par la diffusion de la presse clandestine, par l’attisement du mécontentement social, par une incitation à l’absentéisme, à ralentir la production selon la formule “à salaire diminué, travail diminué” », à se blesser volontairement pour ne plus pouvoir travailler, voire à des appels au sabotage ».
Les syndicalistes pétainistes
Du côté de la CGT, un nouveau désaccord apparait avec la défaite de juin 1940. Un courant autour de René Belin commence à appuyer le nouveau régime en constitution. Ce même Belin, membre du Bureau confédéral, est nommé Ministre du travail le 14 juillet 1940. Un débat s’engage dans la CGT sur le soutien à ce régime, débat qui aboutit à la suppression de la référence à la lutte des classes dans les statuts au profit d’une collaboration de classe. Belin fait dissoudre les confédérations (9 novembre 1940) et prépare la rédaction d’un texte appelé « La Charte du travail », qui paraitra en octobre 1941. Il fait remplacer les syndicats dans les entreprises par des syndicats corporatistes, soumis aux intérêts de l’État et des patrons dans cette logique de « collaboration ».
Le « manifeste des 12 »
Mais Belin n’est pas suivi par l’ensemble de la CGT. A la suite de la dissolution des confédérations, d’autres dirigeants opèrent un rapprochement avec la CFTC qui aboutit sur un texte appelé « Principes du syndicalisme ». Signé par 12 dirigeants syndicaux (9 ex-CGT et 3 ex-CFTC [3]) pour refonder le syndicalisme en ce début de nouveau régime, le manifeste met en avant 6 points dans cet ordre :
« A. Il doit être anticapitaliste et, d’une manière générale, opposé à toutes les formes de l’oppression des travailleurs.
B. Il doit accepter la subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général.
C. Il doit prendre dans l’État toute sa place et seulement sa place.
D. Il doit affirmer le respect de la personne humaine, en dehors de toute considération de race, de religion ou d’opinion.
E. Il doit être libre, tant dans l’exercice de son activité collective que dans l’exercice de la liberté individuelle de chacun de ses membres.
F. Il doit rechercher la collaboration internationale des travailleurs et des peuples. »
Avec ce texte, même si ce n’est jamais dit explicitement, les 12 dirigeants s’opposent au régime de Vichy et posent les fondements d’un syndicalisme sous l’occupation. Par exemple, l’antisémitisme est dénoncé, deux mois après que les premiers décrets contre les Juifs sont parus. Le geste important est aussi l’union inattendue entre des dirigeants des deux centrales, face à la situation, le syndicalisme propose un processus d’union. Cela perdura durant toute la guerre, et ce malgré les désaccords. D’autant plus, que la situation ouvre des rapprochements avec les unitaires qui avaient été exclus.
Des résistances syndicales à l’union du syndicalisme
C’est donc dans cette situation qu’est le syndicalisme à partir de la fin de l’année 1940. Ceux qui s’opposent au régime de Vichy sont à la fois du côté de la clandestinité et du côté de la légalité. C’est ce double ancrage étrange et périlleux qui leur permet d’être efficace. Cet attelage perdurera jusqu’à la fin de l’occupation ouvrant des manœuvres de résistance par la grève mais aussi une refonte du syndicalisme, de ses revendications et une reconnaissance de son action qui lui donnera sa place au sein du Conseil national de la Résistance.
Quelques grèves
Pouvait-on faire grève sous l’occupation allemande ? En mai 1941, c’est en tout cas, ce que tentent les mineurs du nord. Cette grève s’effectue dans des conditions très spécifiques puisque le département du Nord est en « zone interdite » rattaché directement au commandement militaire allemand. Les mines constituent une ressource cruciale : la durée de travail est allongée et les pauses supprimées. Les salaires restent bloqués. Ainsi les mineurs sont contraints à un travail extrême et un appauvrissement dans le même temps. Des micro-grèves et des arrêts de travail adviennent dès le début de l’occupation, ce qui fait réagir les Allemands qui durcissent les conditions. Cette situation permet au comité populaire de construire une grève d’ampleur le 1er mai 1941. Plusieurs dizaines de milliers de mineurs cessent le travail.
![Rapport de police sur les arrestations lors des grèves dans la région lyonnaise, en octobre 1942. [Archives départ. du Rhône – 45 W 65]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/7-Illust3-Colombani-Syndicalistes-face-au-fascisme-773x1024.webp)
Une grève est alors déclenchée côté belge le 10 mai. Cette grève qui dure jusqu’au 18 mai s’avère victorieuse. Les salaires sont augmentés. La même chose démarre côté français le 27 mai. Jusqu’au 9 juin plusieurs dizaines de milliers de mineurs font grève. Leurs femmes s’engagent aussi par des manifestations dans les corons. Mais contrairement à la Belgique, les autorités allemandes ne cèdent pas et répriment la grève. Plusieurs centaines de mineurs sont arrêtés et plus de 205 expédiés en camp de concentration. Cependant la grève donne confiance à des milliers d’hommes. Certains entrent dans la résistance, d’autres poursuivent le travail dans les mines, en organisant le ralentissement du travail, voire des sabotages.
La grève des mineurs fut la plus longue de l’occupation, mais elle donne des éléments pour que soit déclenchées d’autres grèves et aussi pour l’organisation du ralentissement du travail. En octobre 1942, à Lyon, des grèves ont lieu dans des ateliers de la SNCF. C’est bientôt toute la région qui est touchée. Une extension vers l’Auvergne et la Bretagne suit. Ces grèves sont déclenchées en réaction à la mise en place du service du travail obligatoire. Des cheminots étaient directement réquisitionnés pour être envoyé en Allemagne.
Ces mouvements vont constituer des points d’appui pour l’organisation du syndicalisme dans la résistance. En effet, le mouvement syndical va très clairement s’engager dans l’organisation de l’entraide autour des réfractaires au STO. Il s’agit souvent d’organiser le passage dans la clandestinité et le ravitaillement de ceux qui perdent de fait leur travail. Il est cependant à noter le caractère autant social que « patriotique » de nombre de ces grèves. Ce sont souvent des grèves anti-allemands. L’action syndical prend ainsi appui sur le ressentiment contre l’occupant. Les militants essayant par ailleurs, notamment via la presse clandestine, d’insuffler un caractère plus révolutionnaire aux revendications. De fait, le syndicalisme pendant la guerre fut à la fois une réaction aux injustes pratiques subies au quotidien et un accélérateur des réflexions sur le syndicalisme et ce qu’il peut.
Rebâtir le syndicalisme
Ce travail concret dans les entreprises et la participation de plus en plus frappante de militants syndicaux aux réseaux de résistance vont faire bouger les lignes des groupes syndicaux encore actifs. Notons en particulier que les confédérés (Jouhaux, etc.) et la CFTC sont à l’origine du mouvement de résistance Libération Nord. Le 1er avril 1943, le journal clandestin de la CGT, La Vie ouvrière, publie un appel pour le1er mai sous la bannière de l’unité. Le 17 avril 1943, la CGT finit par se réunifier lors des accords dit de Perreux. C’est la résultante du travail commun fait sur le terrain. Ces accords ne mettent pas de côté les désaccords, nombreux, entre les militants mais il officialise une unité d’action pour la suite. Par ailleurs la CGT et la CFTC (clandestines) se retrouvent à la table du Conseil national de la Résistance le 27 mai 1943. Les deux centrales sont ainsi reconnues comme des actrices importantes de la résistance et de la construction de la future France.
Il est notable de constater que les présences des syndicats à la table est une reconnaissance explicite de la centralité du travail et des travailleurs dans la société. Les grèves, les actes de sabotage, le ralentissement au travail sont la preuve du poids des travailleurs, et leur capacité de résistance dans le travail même freine directement le projet nazi et le projet vichyste. On trouve là une des raisons pour lesquelles les syndicats seront largement à l’initiative de nombres de mesures du CNR. Il s’agit d’imposer une refonte de la démocratie et de la république avec une composante sociale. Celle-ci est inspirée du travail du Front populaire et du travail des deux centrales syndicales. Le CNR fait même mention d’une démocratie économique et sociale.
![Manifestation de femmes du 7 novembre 1942 à Lyon. [Archives départ. du Rhône – 45 W 67]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/7-Illust4-Colombani-Syndicalistes-face-au-fascisme-1024x905.webp)
L’occupation française se termine avec les grèves insurrectionnelles parisiennes. La police, la poste, le rail, nombre de secteurs participent à asphyxier Paris à l’été 1944 accélérant la libération de la capitale. La CGT, ragaillardie, est à la manœuvre. A ce titre, il est intéressant de lire le contenu de La Vie ouvrière. Le numéro 209 (juin 1944) [4] publie ainsi l’avis d’un secrétaire d’UD sur les possibilités de la grève et de l’insurrection nationale. Le texte de 2 pages est un vrai manuel de syndicalisme. Le secrétaire anticipe une situation de grève sous occupation en mettant en lumière les différents scénarios et la nécessité de se coordonner même coupé les uns des autres. Il rappelle : « il ne suffit pas de lancer le mot d’ordre de grève générale pour qu’il soit appliqué », il explique aussi le travail fait depuis plusieurs mois : « nous faisons l’impossibilité pour avoir un réseau serré d’organisations ». Il critique les attentistes, explique la constitution des différents comités en vue d’être efficace, le lien entre les « masses », les espaces organisés, la distinction entre les groupes armés et les groupes dans les entreprises… Ce texte montre l’ampleur de la réflexion et du travail que pouvaient mener certains dirigeants illégaux. Un travail qu’on mesure mal, car l’histoire se concentre sur les grandes figures et les grands espaces. Or ce sont bien l’ensemble des ramifications du syndicalisme qui vont permettre les résistances.
Conclusion
Cette période étrange pour le syndicalisme révolutionnaire que fut l’occupation montre la capacité du syndicalisme à résister au fascisme. Il a fallu pour cela que le syndicalisme repose ses bases : anticapitalisme, lutte des classes, centralité des travailleurs, et se démarque de l’idée de corporations. Mais ce qui a constitué le cœur de la résistance syndicale et de toute la Résistance- c’est la capacité d’une résistance au quotidien, dans le travail même, de la prise de « responsabilité » comme disaient les militants de cette période face à une situation de guerre, d’occupation et de dictature. Autant d’éléments qu’il est aujourd’hui nécessaire d’avoir en tête, si nous voulons réellement résister.
⬛ Anouk Colombani
[1] Morgan Poggioli, « La CGT et la répression antisyndicale (août 1939-décembre 1940) : Entre légalisme et apprentissage de la clandestinité ». Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2016/2 N° 130, 2016. p.149-162. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2016-2-page-149?lang=fr.
[2] Ibid.
[3] Le texte, publié le 15 novembre 1940, est signé par Oreste Capocci, Léon Chevalme, Albert Gazier, Eugène Jaccoud, Robert Lacoste, Pierre Neumeyer, Christian Pineau, Louis Saillant, Victor Vandeputte (CGT), Maurice Bouladoux, Gaston Tessier, Jules Zirnheld (CFTC).
[4] CGT, Le mouvement syndical dans la résistance, éditions La Courtille, 1975,p.219-220
- Quand l’économie de guerre sert les partisans de l’austérité, version brutale - 31 juillet 2025
- Une autre économie, pour une paix juste et durable - 30 juillet 2025
- Face à la déstabilisation du monde : opposer le visage de la solidarité - 29 juillet 2025