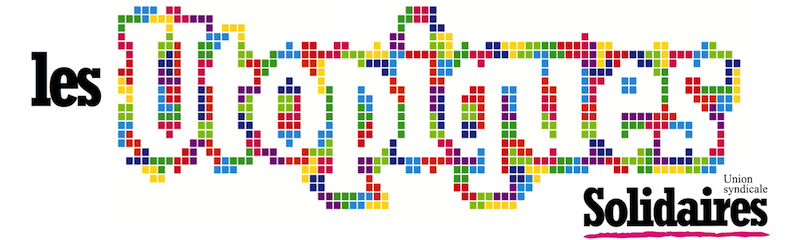L’extrême droite en marche vers le pouvoir, ce que peut le syndicalisme
Militante syndicale à la retraite, j’ai eu le temps, le recul pour écrire ce texte qui ne constitue en aucune manière une critique des positionnements actuels ou passés de Solidaires. Il s’agit pour moi dans une période de crainte et de doutes, de participer aux réflexions à partir de mes engagements passés ou toujours actuels.
Retraitée d’Orange, militante de SUD PTT, Verveine Angeli a été membre du Secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires de 2014 à 2020. Membre d’ATTAC-France, elle est aussi active au sein de la Fédération des associations de solidarité avec tou∙te∙s les immigré∙e∙s.
![[Solidaires]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/3-Illust1-Angeli-Lextrême-droite-en-marche-vers-le-pouvoir-Ce-que-peut-le-syndicalisme-727x1024.webp)
La saga de l’été sur les postes à l’Assemblée, la nomination d’un·e Premier·ère ministre et d’un nouveau gouvernement ne saurait cacher l’ampleur du désastre en cours. L’extrême droite continue sa lente mais certaine progression. Et l’angoisse qui nous a tous et toutes étreint·es lors des élections législatives est là pour le montrer. Nous avons eu peur et nous avions raison. Nous avions raison, car personne ne serait épargné dans une telle situation. Les sans-papiers bien sûr (et ils/elles ont toujours peur), mais ceux et celles qui agissent dans le combat social ou dans les mouvements extérieurs aux entreprises aussi. Les institutions de la Cinquième République avec le scrutin à deux tours ont « sauvé » très momentanément l’affaire. Ce texte s’attache aux questions syndicales et ne traite pas des enjeux directement politiques, dont les enjeux les plus immédiats des conséquences des choix de Macron ou des positionnements des partis. Cela ne veut pas dire que cela ne concerne pas le syndicalisme mais il y aurait sans doute d’autres débats à avoir.
Que pouvons-nous faire dans un contexte comme celui-ci, caractérisé par cet éclatement politique qui ne donne aucune certitude, y compris sur un avenir proche ? Éclatement qui traduit une très forte polarisation sur certaines questions : racisme, question coloniale, questions internationales, féminisme, libertés individuelles… et une polarisation différente sur les questions sociales. Et ce, dans un contexte où les questions démocratiques sont essentielles : avec la permanence d’un « centre » au pouvoir qui se présente de plus en plus comme la seule garantie « contre les extrêmes », avec sa politique néolibérale à outrance et sa manière dictatoriale de l’imposer. La continuité dans cette manière de gouverner et les formes caricaturales qu’elle prend aujourd’hui contribuent largement aux tensions.
![Le 24 août 2024, lors de la manifestation du 28ème anniversaire de l’attaque contre les sans-papiers de l’église Saint-Bernard à Paris. [Serge D’ignazio]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/3-Illust3-Angeli-Lextrême-droite-en-marche-vers-le-pouvoir-Ce-que-peut-le-syndicalisme.webp)
Il faut ajouter à cela, un contexte européen et international, où la présence ou la direction de l’extrême droite dans certains gouvernements tend à banaliser la situation. C’est particulièrement vrai de l’Italie où le gouvernement de Meloni n’est pas présenté comme une catastrophe qui menacerait de mettre le pays à feu et à sang, contrairement à un Milei en Argentine ou un Trump par exemple. Tout ceci en dit long aussi sur les responsabilités européennes (tant que l’UE et l’OTAN ne sont pas menacés, on ne dit rien). S’ajoutent à ce tableau les très grandes incertitudes sur la situation politique à la rentrée, l’instabilité institutionnelle prévisible, ce qui rend difficiles des perspectives de mobilisations interprofessionnelles. Il est nécessaire à ce stade de penser les responsabilités du syndicalisme, à court terme bien sûr, mais aussi à plus long terme car les derniers évènements renvoient à des problèmes anciens. Revenir sur ces préoccupations ne doit pas empêcher de saisir des opportunités que pourrait offrir la situation.
Quelle évolution du syndicalisme ?
D’élections en élections, les études confirment l’éclatement du corps social, l’adhésion d’une partie importante des ouvrier·ères et employé·es aux idées d’extrême droite, même si ces mêmes études montrent maintenant une adhésion de parties importantes de toutes les catégories socio-professionnelles, élargissant l’impact de ces idées. Nous le savons, le syndicalisme en général et pas seulement le nôtre, est en recul, a du mal à exister dans certaines catégories, dans certains secteurs, dans de nombreuses entreprises, dans certaines géographies. Nous ne pouvons pas penser que la baisse globale (pas seulement en France) d’organisation des travailleur·euses dans les syndicats n’ait pas eu de conséquences ; conséquences immédiates sur la capacité de ceux-ci, y compris quand les syndicats sont unis, à organiser, voire participer à la lutte et à des grèves en particulier. C’est aussi le poids politique global des syndicats qui est en recul, recul que les gouvernements de Sarkozy à Macron en passant par Hollande se sont empressés de vouloir matérialiser (syndicats renvoyés à des « corps intermédiaires » méprisés, droit de grève et de représentation attaqués). Mais il y aussi des conséquences plus profondes, puisque cette baisse a commencé il y a longtemps, sur la conscience de classe, car les luttes des travailleur·euses ne sont pas de la génération spontanée. Ce n’est pas seulement parce qu’ielles ne peuvent pas faire grève que leur participation aux luttes est difficile, c’est aussi que le recul de l’organisation concrète renforce l’idée qu’on ne peut pas agir.
Nous avons subi des années de radicalisation des attaques néolibérales (retraites, sécurité sociale, chômage, services publics, salaires) et antidémocratiques (traité constitutionnel, représentation des salarié·es, 49.3 comme mode de gouvernement…) et, dans le même temps, une baisse régulière de l’organisation des travailleur·euses, toutes organisations confondues, avec des gouvernements et un patronat extrêmement dur face aux mobilisations partielles ou interprofessionnelles. Dans le même temps, ces gouvernements ont dû répondre à des mobilisations (mariage pour tous, PMA pour toutes, droit à l’avortement dans la Constitution…) quitte, sur certains sujets, à faire de la pure démagogie (les violences faites aux femmes par exemple), mais tout cela a pu donner l’idée que le « positif » ne concernait pas les besoins immédiats des couches populaires, et que les gouvernements n’étaient prêts à satisfaire que des revendications sociétales de certain·es et pas à répondre aux exigences sociales. Le résultat est là : une frustration grandissante parmi les couches populaires et une conscience de classe en recul, ce qui constitue un problème pour polariser la société autour d’alternatives progressistes et favorables aux travailleur·euses. D’où, la formule « le RN on n’a pas essayé… ».
Nous ne sommes pas responsables du déclassement vécu par la population dans des régions entières, ni de la trappe à bas salaires qu’ont constituées toutes les réformes permettant la suppression des cotisations sociales sur les salaires les plus bas, ni de l’appauvrissement des chômeur·euses et des travailleur·euses pauvres et/ou précaires. Nous ne sommes pas responsables de la généralisation de la sous-traitance et de l’éclatement des statuts. Nous ne sommes pas non plus responsables des règles de représentativité syndicale ni de la remise en cause des droits de représentation des salarié·es dans les entreprises. En revanche, c’est notre rôle de pouvoir, même dans cette situation, construire le syndicalisme partout, en dépit des divisions du monde du travail, et de comprendre qu’il ne peut y avoir de victoire durable face à l’extrême droite et à ses idées sans relance de l’organisation massive des travailleur·euses, ni de transformation sociale sans unification de la classe ouvrière. Il n’y a pas de réponse unique ou de méthode facile car nous faisons face, et ce n’est pas nouveau, à deux types différents d’adversaires et de menaces et ce, en même temps. Il nous faut donc tenir tous les bouts alors que les enjeux peuvent parfois sembler contradictoires : comment le syndicalisme peut-il gagner du poids auprès des salarié·es touché·es par le discours du RN tout en se développant aussi parmi les travailleur·euses immigré·es, les enfants d’immigré·es ?
Les Gilets jaunes : une alerte en mouvement
Le mouvement des Gilets jaunes a constitué un symptôme de ces difficultés et de ces divisions. Un mouvement social qui a posé de façon spécifique plusieurs questions : rapport aux mesures visant le changement climatique, rapport aux impôts, au pouvoir d’achat et au salaire comme si l’enjeu de classe se situait dans les rapports avec l’État (autre conséquence du néo-libéralisme), exigences démocratiques (le référendum d’initiative citoyenne, tant critiqué). Ceci créant une identification sociale très spécifique : un mouvement qui s’est vécu comme populaire mais pas comme salarié, ni de travailleur·euses, mais qui en cela est aussi très représentatif de certaines évolutions du monde du travail. Se sont créées des dynamiques de rassemblement dans des lieux et pour des couches sociales peu organisées, que ce soit par le mouvement syndical, politique ou associatif.
La faiblesse des liens avec le mouvement syndical, le rejet par une partie majoritaire (et y compris dans nos rangs) de ce mouvement ont révélé un problème politique et un problème social : qui est là pour défendre les conditions de travail, de transport et de vie des couches populaires qui se sont exprimées à ce moment-là ? La question n’est pas que seule la lutte syndicale aurait un sens, ou que tout mouvement sur des questions sociales doit nécessairement passer par le syndicat, bien au contraire. Mais l’existence d’un mouvement qui a duré plusieurs mois sur ces thématiques, qui a pesé sur la situation générale y compris en obtenant certaines victoires, est tout autant un symptôme des reculs du syndicalisme que l’expression d’une volonté collective nouvelle et différente de celle du mouvement syndical, toutes organisations confondues.
Globalement, l’expérience de lutte et d’organisation de ce mouvement ne s’est pas matérialisée sous une forme durable et progressiste. La polarisation qu’il avait constituée est maintenant retombée, sans que les thèmes des revendications portées aient disparu, laissant à nouveau des pans entiers des classes populaires sans perspective, projet ou programme. Cette situation marque aussi un échec au moins partiel des tentatives de faire vivre le combat sur « la fin du monde et la fin du mois », échec révélé tant par les reculs gouvernementaux cédant aux forces les plus réactionnaires et aux lobbyistes en matière d’environnement que dans le retrait de la CGT de l’Alliance écologique et sociale. Sur ce terrain-là aussi, l’extrême droite tisse son discours.
Construire un outil pour tous·tes les travailleur·euses
La force du syndicalisme réside dans sa capacité d’action corporative, au sens de la défense des intérêts professionnels et sectoriels dans les entreprises et les branches, et dans ses moyens d’unifier le combat de classe en élevant le niveau de vie, les conditions de travail et d’existence de la totalité de ceux et celles qui travaillent. Au vu des modifications du monde du travail depuis plusieurs décennies, il s’est avéré particulièrement difficile de tenir la totalité de ces enjeux que ce soit dans les luttes d’entreprise, sectorielles ou interprofessionnelles Pourtant, ce ne sont pas les grands mouvements interprofessionnels qui ont manqué, le nombre de lieux de manifestations et leur caractère massif, y compris dans les petites villes, étant là pour montrer que la volonté de se battre existe. Mais il faudrait savoir quelle appropriation réelle de ces mouvements a eu lieu ? Quelle politisation ? Est-ce que le mouvement syndical s’en est trouvé renforcé et dans quels endroits ? Quel impact des dernières mobilisations retraites, par exemple, sur les personnes qui s’étaient mobilisées sur les ronds-points ?
![[Solidaires]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/3-Illust5-Angeli-Lextrême-droite-en-marche-vers-le-pouvoir-Ce-que-peut-le-syndicalisme-732x1024.webp)
Cela interroge plusieurs choses : notre rhétorique sur la grève générale (avec qui, quand, comment ?), notre mode de construction des mobilisations (l’unité syndicale bien sûr, mais quelle place pour les travailleur·euses dans ces mouvements pour quelle politisation, quelle démocratie ouvrière), nos propositions de lutte (grèves, blocages, manifestations…). Si les références du mouvement syndical, ses traditions, et les nôtres en particulier, sont toujours valides, comment adapter le combat à cette situation concrète ? Comment faire participer le plus grand nombre et ne pas se comporter comme une avant-garde ? Et d’un point de vue revendicatif et d’action, comment traiter la question des salaires, mais aussi celle, majeure, du pouvoir d’achat, dans des contextes de difficultés de rapport de force : SMIC, cotisations sociales, échelle mobile des salaires, indexation sur le prix des loyers, de l’énergie… Comment traiter des exigences démocratiques : réponse au 49.3, exigences référendaires, démocratie dans les entreprises ? Il est clair que la réponse à ces questions ne se joue pas à court terme. En revanche, les alertes nous montrent dans quel sens vont les choses si on ne les modifie pas : affaiblissement du syndicalisme dans son crédit, son rôle, son poids politique et social, et passage d’une partie du monde du travail sous la domination politique ou au moins l’influence de l’extrême droite.
![[Solidaires]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/3-Illust2-Angeli-Lextrême-droite-en-marche-vers-le-pouvoir-Ce-que-peut-le-syndicalisme.webp)
Féminisme, antiracisme, faire bloc
Le monde du travail est profondément divisé selon le genre, l’origine, la race au sens sociologique du terme. Ces dernières années, les premier·ères concerné·es ont posé les enjeux des discriminations et de l’égalité, construit des mobilisations, engrangé des victoires : mouvement #metoo, mariage pour tous·tes, PMA pour toutes, visibilité des mobilisations contre les féminicides, contre les crimes policiers, des sans-papiers… Les effets boomerangs sont inévitables, c’est aussi le signe d’une progression de ces combats. En dépit des limites, de leurs imperfections, des divisions, des difficultés organisationnelles, ces mouvements constituent une menace pour des courants réactionnaires qui trouvent un écho dans la population.
Cela renvoie au fait que le racisme, le sexisme sont une manière d’assumer la revendication d’un privilège quand on pense en être dépourvu, d’exiger de ne pas être au plus bas dans le combat pour des ressources qui peuvent être rares : emploi, accès aux prestations sociales, au logement, aux services publics, etc. Le caractère systémique des dominations et des discriminations produit des ressorts profonds jusque chez les individu·es. Sentiments conscients ou non, mais qui affaiblissent la conscience de classe et les combats de classe à mener. C’est en ce sens, et parce que le RN l’exprime de la façon la plus nette et la plus durable, que ce vote est un vote raciste d’abord, tout en étant un vote de rejet des politiques gouvernementales. Pour contrer ces effets, le syndicalisme doit organiser celles et ceux qui sont les victimes de ces discriminations dans le monde du travail et permettre que le syndicalisme soit vécu comme un instrument de leur lutte. Parce que c’est en assumant le combat le plus concrètement que l’antiracisme et le féminisme peuvent s’imposer dans toute la société ; et le monde du travail en est un lieu incontournable. Faire peser plus la parole et l’action féministes, antiracistes, LGBTQI+ dans le monde du travail, et en conséquence dans la société, c’est faire de cette lutte plus qu’un enjeu de combat entre intellectuel·les, même si leur apport est décisif, ou entre militant·es.
![Une des très nombreuses manifestations des sans-papiers de Chronopost à Alfortvillle (94), en lutte depuis bientôt trois ans ; ici devant la préfecture du Val-de-Marne. [Solidaires 94]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/3-Illust4-Angeli-Lextrême-droite-en-marche-vers-le-pouvoir-Ce-que-peut-le-syndicalisme.webp)
C’est aussi parce que ces questions comme enjeux revendicatifs prendront de la place, que ces combats et les personnes qui les portent seront respectés, que celles-ci pourront parler aussi au nom de tous ceux et celles qui travaillent, que nous pourrons faire reculer les idées d’extrême droite. Pour gagner du terrain, il faut se montrer et s’imposer partout. C’est loin d’être satisfaisant aujourd’hui dans nos organisations et cela contribue, là aussi, à affaiblir le poids de l’organisation des travailleurs et travailleuses. Les revendications et mouvements féministes comme antiracistes sont toujours largement perçus comme extérieurs au mouvement ouvrier et syndical, même si, sur les questions féministes, des progrès réels ont été faits. Il est possible et souhaitable que les combats féministes et antiracistes s’ancrent dans des réalités organisationnelles multiples, dans des organisations spécifiques, dans la non-mixité, mais c’est par la présence dans nos rangs de ceux et celles qui les portent que nous pourrons intégrer pleinement ces revendications, faire grandir le syndicalisme en faisant en même temps reculer l’extrême droite. Cela implique plus que des déclarations et des résolutions de congrès (même si c’est important), mais des initiatives, des décisions organisationnelles, des choix de développement…
Sortir de la spirale de la décroissance par le haut…
La dégradation de la situation politique en France a connu une accélération à la faveur des manipulations électorales de Macron. Si les enjeux globaux ne peuvent se résoudre de façon rapide, il faut néanmoins tracer des pistes qui ne peuvent pas être celles des petits pas. Sommes-nous capables de répondre seul∙es à ces enjeux ? Y-a-t-il une autre organisation qui le serait ? La réponse est clairement non. Les enjeux de recomposition syndicale à la lumière de cette accélération doivent être rediscutés. Il peut y avoir différentes attitudes :
- Rester en l’état, dans une forme de conservatisme organisationnel qui permettra peut-être de maintenir la représentativité acquise par Solidaires, mais qui ne résoudra en rien les problèmes politiques actuels et les difficultés posées au syndicalisme. Les risques sont gros de ne pas pouvoir résister aux prochaines vagues.
- Une autre attitude peut exister dans nos rangs ou chez certain∙es de nos partenaires : la volonté de construire un front commun avec les partis politiques et les mouvements sociaux progressistes. Si des alliances ponctuelles peuvent être faites ou des discussions sur des appels à voter, additionner des forces minoritaires est-il en mesure de régler le problème de fond ? Les partis, y compris les plus à gauche, sont en situation de carence d’organisation et de représentation dans les couches populaires. Alors, si travailler ensemble est possible, faire partie d’une forme de front commun permanent ne répondrait pas aux problèmes de fond ; sans parler des enjeux d’indépendance du syndicalisme. Et il faut le répéter, si les agendas peuvent parfois se rencontrer, ce n’est pas généralement le cas comme le montre la séquence de cette fin d’été.
- Un processus allant vers l’unification syndicale des syndicats de transformation sociale ne se suffirait pas à lui-même. Mais la question posée et le projet enclenché auraient le mérite de dynamiser la construction d’équipes syndicales dans des lieux où elles sont absentes, de mettre en arrière-plan les divisions existantes, de donner à voir sur la place publique une volonté unitaire permettant de montrer une force résolue à défendre les revendications et les droits de tous·tes contre l’extrême-droite. Cela matérialiserait aussi un rapport de force organisationnel acquis dans les combats de décembre 95 jusqu’à la dernière grève interprofessionnelle sur les retraites, et pèserait sans aucun doute sur le reste du mouvement syndical.
Prendre des initiatives unifiées de construction syndicale dans les secteurs ou les régions où les syndicats sont faibles, organiser des permanences intersyndicales et les faire connaître, faire des bourses du travail des lieux d’accueil dynamiques, prendre en commun la défense des travailleur·euses sans papiers, faire des listes communes lors d’élections professionnelles, multiplier l’organisation d’initiatives comme celle des intersyndicales femmes, prendre langue en commun avec les associations locales et syndiquer… Il y a un champ à explorer pour avancer. Toujours dans une volonté d’inverser la tendance, il y aurait sans doute aussi intérêt à regarder d’autres expériences syndicales à l’international, sans qu’il soit évidemment possible de plaquer d’autres schémas de construction. Mais nous aurions tort de nous priver de tels échanges au vu des contacts nombreux et du réseau syndical international que nous avons construit. Bien sûr, tout cela ne relève pas de notre seule décision, et les obstacles sont nombreux tant au niveau interprofessionnel que dans les secteurs forces de chacune des organisations, mais la période nous demande réflexion et initiative.
⬛ Verveine Angeli
- Quand l’économie de guerre sert les partisans de l’austérité, version brutale - 31 juillet 2025
- Une autre économie, pour une paix juste et durable - 30 juillet 2025
- Face à la déstabilisation du monde : opposer le visage de la solidarité - 29 juillet 2025