Le syndicalisme et sa dette historique avec la lutte des femmes

La lutte des femmes se mènerait au détriment de la lutte des classes, puisque pour Marx, Engels et leurs disciples les moins ouverts, la domination masculine étant née avec les sociétés de classe, elle serait destinée à disparaître avec la révolution sociale. Mais les femmes n’ont pas attendu dans leur cuisine que la révolution sociale arrive : au début de ce XIX siècle, nombreuses sont celles qui participent à l’organisation des luttes des ouvriers et ouvrières. De la grève des fileuses de Troyes en 1791, aux émeutes de Nottingham en 1812, des troubles de subsistance en 1816, aux grèves des blanchisseuses de Chaillot en 1828, des barricades de 1830, aux grèves des couturières et lingères de Vouvray en 1833, des émeutes d’Elbeuf en 1846 et des grèves ouvrières de 1843 et 44, en passant par le mouvement chartiste de 1830, des femmes sont leaders dans les trade-unions de l’Angleterre victorienne et meneuses dans nombre de luttes, y compris en France.
Mais dans le premier tome du Maitron [1], répertoriant la période de 1789 à 1864, sur 15.379 notices … 435 concernent des femmes. Dans les 10 pages de son avant-propos, Jean Maitron ne fait référence qu’à une seule femme, Flora Tristan [2]: « Hommage a été rendu à Flora Tristan, l’extraordinaire petite bonne femme comme dira son petit-fils le peintre Gauguin, et à l’Union ouvrière, nationale, avec de possibles prolongements internationaux, qu’elle essaya d’édifier en France en 1843 ». L’Union Ouvrière est l’œuvre maîtresse de Flora Tristan, publiée grâce à une souscription qui la conduisit à un porte-à-porte militant auprès de « personnalités » comme de « simples travailleurs et travailleuses ». Pour faire entendre cet appel à la constitution de la classe ouvrière, elle accomplit un tour de France où son enthousiasme généreux est mis à rude épreuve et au bout duquel, seule et épuisée, elle meurt, à quarante et un ans. L’Union ouvrière est le premier manifeste politique cohérent d’une femme qui ne dissocie pas la lutte des femmes de la lutte ouvrière. C’est aux plus démunies, aux plus exploitées d’entre elles qu’elle adresse cette apostrophe qui nous touche encore aujourd’hui : « Mes sœurs, je vous jure que je vous délivrerai. » En cette même année 1964 où Jean Maitron publie le premier tome de son œuvre, Madeleine Gilbert écrit, citant Edith Thomas : « Avant Karl Marx, 5 ans avant, Flora découvre en substance l’idée neuve : l’émancipation des travailleurs sera œuvre des travailleurs eux-mêmes. Nul n’avait dénoncé avec moins d’illusion que Flora, la condition misérable de la femme ouvrière ; nul avant elle n’avait lié aussi étroitement la libération de la femme et celle du prolétariat tout entier [3] ».

Il est vrai qu’en ces temps-là, Proudhon écrit : « Nous ne savons si, en fait d’aberrations étranges, le siècle où nous sommes est appelé à voir se réaliser à quelque degré celle-ci : l’émancipation des femmes. Nous croyons que non [4]». Pour lui, la femme ne peut être que « ménagère ou courtisane [5]». Mieux vaut s’attarder sur la réponse de Jeanne Deroin [6], paru dans L’Opinion des femmes, journal dont le premier numéro est paru le 28 janvier 1849 : « A votre dilemme, Monsieur, j’en opposerais un autre, qui pour moi est un axiome : esclave et prostituée ou libre et chaste, pour la femme il n’y a pas de milieu. La prostitution est le résultat de l’esclavage de la femme, de l’ignorance et de la misère. » Révolutionnaire de 1848, Jeanne Deroin consacrera toute sa vie à la lutte pour l’abolition des privilèges. En 1849, avec notamment l’écrivaine et féministe Pauline Roland [7], elle réalise le projet décrit et défendu par Flora Tristan dans la brochure L’Union Ouvrière [8]: une Fédération des associations ouvrières « afin de lutter contre les injustices frappant les travailleurs ». C’est bien sûr pour respecter les termes de l’époque que nous n’écrivons pas « des travailleuses et des travailleurs ». Cependant, un chapitre de la brochure a pour titre « Pourquoi je mentionne les femmes ». Les responsables de la Fédération sont arrêté·es le 29 mai 1850 : 38 hommes et 9 femmes. A l’issue du procès, en novembre 1850, Jeanne Deroin est condamnée à 6 mois de prison. Cette Fédération de 104 organisations ouvrières, imaginée, initiée et portée par des femmes fait partie de l’héritage collectif qui permis la naissance de l’Association internationale des travailleurs (la 1ère Internationale) en 1864. Mais, au mythique meeting fondateur de Saint-Martin’s Hall, le 28 septembre 1864, tous les délégués sont des hommes. Aucune femme n’est mentionnée parmi les membres fondateurs de l’AIT.
AUCUNE FEMME !
Les femmes étaient restées aux portes du meeting ! Lors du recensement de la population de Londres en 1851, parmi la « population active » on dénombre « 709 312 hommes et jeunes gens, 408 609 femmes et jeunes filles [9] ». Veuves et épouses sont intégrées aux « non-actifs ». Ne sont donc comptabilisées, ni les épouses qui travaillent gratuitement [10] pour monsieur dans les commerces, cabinets, marchés, etc. ni les veuves qui doivent manger, se vêtir, se loger -même sans époux ! L’auteur lui-même, indique que le nombre des femmes « actives » est sous-évalué : « On remarque tout de suite que le secteur des domestiques est sous- estimé, puisqu’il se recrute surtout parmi les femmes. » Au moins 50% du prolétariat londonien, les travailleuses, est restée aux portes du Saint-Martin’s Hall.
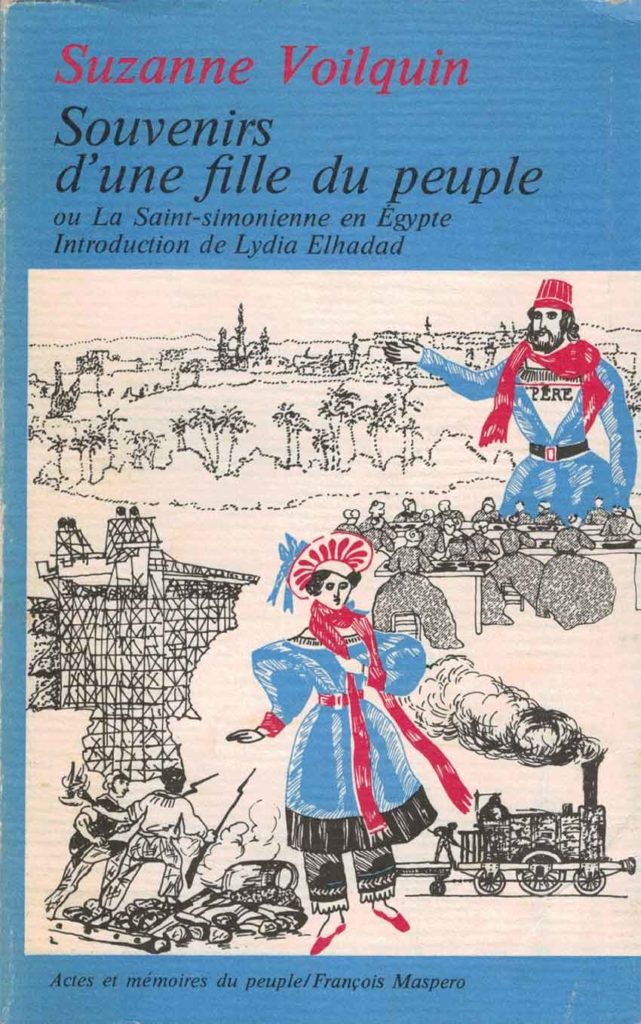
L’association internationale des travailleurs se donne pour objectif la coordination des luttes syndicales et populaires de tous les pays. Les femmes existent dans les luttes syndicales et dans tous les pays. Mais dans le manifeste inaugural de l’AIT, écrit par Marx, on parle 12 fois des « ouvriers », 9 fois des « travailleurs », 4 fois des « hommes ». D’ouvrière, il n’y a que « la classe », de travailleuses, il n’y a que « les masses » ou « les classes » ; on trouve 1 mention de « femmes », et c’est à propos « du travail des enfants » où il est constaté que « la classe des potiers, hommes et femmes, présente une population très dégénérée ». Pour être exhaustif, on ajoutera 1 fois les « mères » car « la mortalité infantile a diminué, parce que, enfin, il est permis aux mères de donner le sein aux nouveau-nés. » Voilà la place des femmes, des ouvrières, des travailleuses parmi les 3547 mots de ce texte fondateur pour le mouvement ouvrier, dont le syndicalisme. En 1865, il est admis que les femmes puissent prétendre à devenir membres de l’AIT. Le 25 juin 1867, Harriet Law [11] est admise au Conseil général et, pendant les cinq années suivantes, elle est la seule femme représentante. « Au reste, les dames ne peuvent se plaindre de l’Internationale qui a élu une dame, Madame Law au Conseil Général. » [12]. Après l’admission de Harriet Law, nous, les femmes, devons-nous taire !
Le pouvoir symbolique de l’écrit ne légitime que ce qui est nommé ; son absence fait disparaitre toute trace dans l’Histoire : les paroles s’envolent, les écrits restent. Les Flora, les Jeanne, les Pauline, les Désirée, les Eugénie, les Adèle et toutEs les autrEs, ont disparu, dépossédées de leur légitimité dans les luttes, de leurs écrits, de leurs réflexions, de leur rôles moteur dans la construction du syndicalisme. On se sert des femmes pour les luttes mais leurs collègues révolutionnaires les jettent dès lors qu’il faudrait mentionner qu’elles existent, agissent, pensent, organisent…
Partout dans le monde, à l’accusation de « diviser la lutte de la classe ouvrière » s’ajoute celle de « concurrence déloyale » dans le marché du travail ; d’où les grèves, soutenues par les syndicats, contre l’embauche de femmes. Dans son travail précité, Madeleine Guilbert relève (en France) « entre 1890 et 1908, 54 grèves d’hommes, dans le seul objectif d’empêcher que les femmes entrent dans les ateliers ». En 1913, la section lyonnaise de la Fédération du livre CGT, refuse à Emma et Louis Couriau leur inscription au syndicat au motif qu’elle soit, elle, une femme et lui de ne pas l’avoir empêchée de travailler en tant que typographe. Le syndicat, par la grève, impose au patron de renvoyer Emma. Cette affaire a toutefois amené le syndicalisme à, finalement, admettre la défense du travail des femmes et le droit des femmes mariées à travailler. Ceci restera toutefois trop peu pris en compte dans les faits, et parfois même, encore combattu. L’ouverture de tous les métiers aux femmes comme aux hommes demeurent à réaliser, plus encore à banaliser. Et il se trouve bien des collectifs syndicaux pour s’y opposer ; parfois au nom de « mesures protectrices envers les femmes » (ne devrait-on pas, au contraire, demander leur extension à tous et toutes dans ce cas ?) ; parfois pour dénoncer une tentative de déqualification (acceptée dès lors qu’elle ne s’applique pas aux hommes ?). Le même processus s’applique d’ailleurs vis-à-vis des personnes immigrées et/ou racialisées. Avec les conséquences en matière d’inégalités, de discriminations, … et le recul des droits de tous et de toutes, pour n’avoir pas voulu reconnaitre et soutenir les luttes autonomes et spécifiques, seul moyen de les inscrire dans l’indispensable projet émancipateur global.
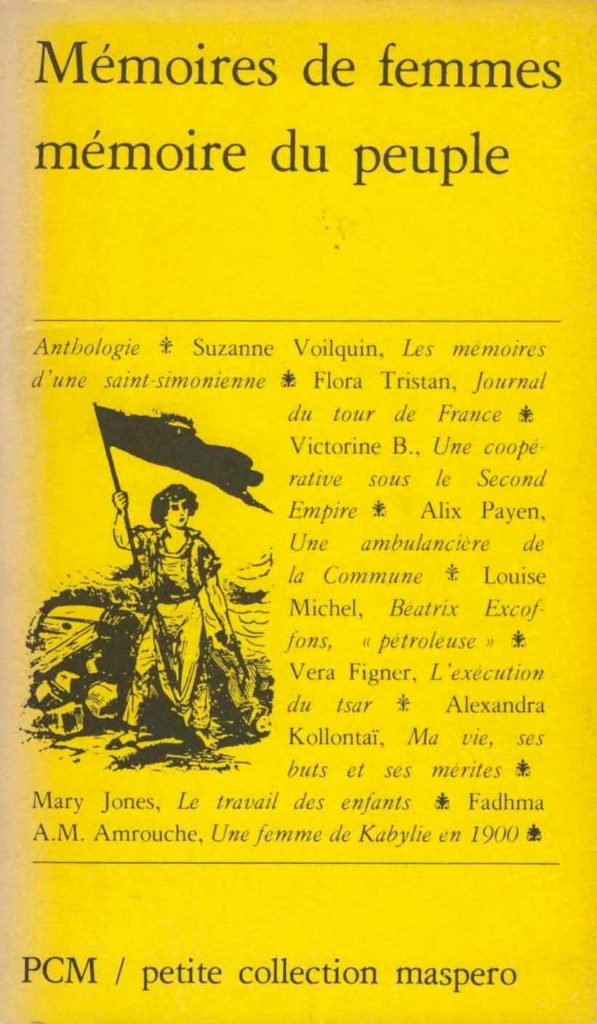
Dans son livre, Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive, Silvia Federici explique comment le capitalisme balbutiant de la fin du moyen-âge, amène la réorganisation complète du statut des femmes à travers un procès d’asservissement et d’enfermement dans la famille moderne, afin de produire et reproduire la force de travail dont le capitalisme a besoin. Pour elle, le capitalisme est patriarcal ; elle décortique les mécanismes de cette conjugaison dans son dernier livre [13]. En instituant l’incapacité juridique de la femme mariée, le code civil publié en 1804 consacre l’infériorité de la femme face à l’homme : au nom de la famille et de sa stabilité, les femmes sont soumises à l’autorité du mari : le « devoir d’obéissance » de la femme envers le mari n’est aboli qu’en 1938 ; le droit d’exercer une profession ou d’ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation du mari ne date que de 1965 … La « femme au foyer » arrangeait tout le monde : le capitalisme et ce socialisme qui, lui aussi, accepte les « privilèges masculins [14] » dans le droit au travail comme dans le droit politique. Même si, Marx a « oublié » le travail domestique et la question de la domination et de l’oppression des femmes dans son analyse de l’exploitation, la théorie dite « marxiste » est particulièrement utile et riche en instruments intellectuels pour penser l’oppression des femmes et le changement de leur statut. L’oppression des femmes et leur exploitation ont été amplement pensées et débattues, à la fois avec et contre Marx et entre féministes, dans leurs moindres recoins, depuis au moins 50 ans. Le capitalisme et le patriarcat sont deux modes d’exploitation qui s’articulent, ce qui ne signifie que l’éventuelle disparation de l’un entrainerait celle de l’autre ; pour certains courants féministes, ils sont autonomes. Au rapport capitalisme/patriarcat, s’ajoute la question de la racialisation, traitée par d’autres articles dans ce numéro [15]. Dans quelle mesure l’oppression des femmes se construit-elle indépendamment ou intrinsèquement de l’exploitation capitaliste ? Les analyses féministes sont riches et variées, les confrontations théoriques et politiques non résolues, encore en ébullition.
Le mouvement féministe des « années 68 » se heurte à un mur, s’agissant de la principale organisation ouvrière du pays, la CGT. Pas seulement un mur ; ainsi, lors de la manifestation parisienne du 1er mai 1976, malgré une négociation préalable, le cortège féministe est violemment repoussé par le service d’ordre de la CGT. Symbolique, cet exemple ne sera pas le seul. Lors du congrès confédéral de 1970, la CGT affirme ne pas faire sienne une conception « féministe de l’égalité », considérée comme étroite. En 1973, elle confirme à travers les textes de congrès : « La conception “féministe” selon laquelle la société aurait été construite “par les hommes et pour les hommes” est erronée ». Les revendications féministes des années 70 se soldent par la reprise en main du secteur féminin, sous l’impulsion du secrétaire général, Henri Krasucki [16]. La CGT est alors la seule organisation syndicale a publié, depuis 1955, un journal mensuel spécifiquement destinée aux femmes ; mais Antoinette se veut un « magazine féminin », pas « féministe ». Au début des années 80, confrontées aux contradictions entre prise en compte des revendications féministes et maintien de l’orthodoxie héritée du PCF, Antoinette connait une crise qui se solde par le licenciement des rédactrices. Le titre disparait quelques années plus tard. S’en suit une « décennie silencieuse » sur la question du féminisme. Ce n’est qu’à l’aube du XXIème siècle, et 28 ans après Mai 68, que le féminisme n’est plus dénoncé officiellement par le PCF et la CGT, comme une idéologie divisant la classe ouvrière, les exploité·es. Lors d’une conférence intitulée « Les rendez-vous manqués du féminisme et du mouvement ouvrier », à l’occasion d’un stage de formation des femmes du PCF, le 30 mars 1996, Françoise Picq pouvait se réjouir que la manifestation du 25 novembre 1995 [17] ait été préparée, pour la première fois, par les féministes et par les organisations de gauche et d’extrême gauche (et des organisations syndicales !). Les organisations de gauche, dit-elle, se mobilisent « pour les droits des femmes » et elle ajoute : « Le mouvement social a fait sien le principe de la Conférence de Pékin [18], que les droits des femmes sont partie intégrante et indivisible de tous les droits humains et des libertés fondamentales ».
La lutte en suspens depuis 150 ans contre le patriarcat, la lutte non livrée par le syndicalisme traditionnel contre l’exploitation domestique des femmes, est revenu comme un boomerang. Flora Tristan l’avait pourtant déjà décrit : « Comme la caste des parias indiens qui sont considérés par les castes supérieures comme impurs et polluants, les femmes sont depuis tellement longtemps mises à l’écart de l’humanité que le mépris dont elles font l’objet va en quelque sorte de soi. Au point qu’il suffit qu’elles touchent à une branche de l’industrie, il suffit qu’elles deviennent majoritaires pour que cette branche soit frappée de discrédit, de dévalorisation et que les salaires baissent [19]».
Dans l’équation néolibérale de ces 30 dernières années, la réduction « du cout du travail » a été au centre des mesures économiques des gouvernements successifs. Ces restructurations pour réduire la « masse salariale », le remplacement de fonctionnaires par des contractuel·le.s dans le secteur public, les licenciements en masse dans le privé, ont accompagnés une attaque impitoyable envers les acquis sociaux et les droits des travailleurs et travailleuses. Cette politique de « flexibilisation du marché du travail » voulue par l’Etat, le patronat et le capital, n’a pas seulement précarisé une partie importante de la population, elle a également mis en place un ensemble d’étapes obligatoires, numériques ou présentielles, que les travailleuses et travailleurs doivent effectuer pour prétendre au « privilège » d’un emploi, d’une allocation, d’un service public, d’une information. Elles ont un dénominateur commun, au cœur du fonctionnement du marché du travail : ce sont des tâches effectuées gratuitement. Des associations, des services publics et des entreprises fonctionnent hors droit du travail, grâce à des milliers d’heures de travail effectuées gratuitement ou semi gratuitement par des bénévoles, des jeunes en service civique, des stagiaires, des allocataires du RSA, etc. Andrew Ross, professeur d’analyse sociale et culturelle à l’Université de New York et activiste social, y voit le « stade ultime du capitalisme » ; pas Maud Simmonet, pour qui « la question du travail gratuit ne nait pas avec les stages ni la téléréalité. Elle a déjà été débattue […] il y a plus de 40 ans à propos du travail gratuit effectué par les femmes dans l’espace domestique. […] L’analyse du travail domestique n’est pas seulement à l’origine des réflexions sur le travail gratuit : elle les condense et c’est à ce titre qu’elle apparait incontournable [20] ».

L’organisation du travail utile à cette étape du capitalisme, a modifié le statut du « travailleur salarié » traditionnel en réduisant ses droits, en poussant même jusqu’à sa gratuité … très majoritairement pour les femmes. Le temps passé en tâches domestiques par un homme seul est de 2 heures et de 2h43 pour une femme ; dans le cas des couples sans enfant, ce temps est de 2 h07 pour l’homme et de 3h28 pour la femme ; pour les couples avec un enfant l’homme effectue 2 h10 de travail gratuit et la femme 4 h05. Ces statistiques de l’INSEE de 2012 sont claires !
Par sa gratuité imposée, le travail domestique est un déni de travail et par conséquent une négation au statut de travailleuse.
Le travail gratuit n’est pas en dehors du « marché du travail » ; pour une très grosse part, c’est le travail domestique, mais il y aussi celui effectué par les étudiant·e.s , jeunes diplomé·e.s et privé·e.s d’emploi, déguisé en stages « obligatoires » , utiles à trier les « dignes de confiance et suffisamment méritants pour l’hypothétique emploi à la clé ; par les bénéficiaires du RSA à travers des campagnes « d’intérêt général » pour rétribution à la communauté d’être payé·e.s « à rien faire ». Les multiples contrats-bidons inventés par les gouvernements successifs pour ne pas payer les jeunes ou encore les nombreuses activités de « service public » aujourd’hui assurées par des bénévoles dans des associations.
Par sa gratuité imposée par le patronat et l’état, toutes ces « tâches » sont un déni de travail et utilisé d’une part pour maintenir ou aggraver le taux de chômage, d’autre part pour réduire les droits de celles et ceux qui exercent un travail « non gratuit »

Faibles rémunération, précarité, dépendance, recul de la syndicalisation, toutes ces caractéristiques des emplois féminins ont conduit plusieurs chercheurs et chercheuses à voir dans les transformations actuelles de l’emploi, « la féminisation du travail » (expression popularisée par la philosophe américaine Donna Haraway). La déqualification est une vieille stratégie qui s’applique aujourd’hui à des salarié·es auparavant protégé·es. Dénoncer l’oppression des femmes à travers le travail domestique est essentiel. Il est nécessaire de combattre ce système, dont l’ensemble du patronat bénéficie via l’abaissement du « coût du travail ». C’est une des tâches du syndicalisme de lutte et de transformation sociale que de s’y attaquer.
La dette historique du syndicalisme envers les femmes est immense : autant que leur rôle dans les luttes qui ont construit le mouvement ouvrier et permis d’arracher tous les droits sociaux. Leur absence dans la fondation de l’AIT est révélatrice d’un déni de reconnaissance de leur statut de travailleuse ; elle illustre le refus de leur légitimité à la sphère publique, à leur émancipation. Aujourd’hui encore, l’activité féministe n’a pas acquis cette légitimité pleine et entière. Les luttes non menées contre l’exploitation domestique des femmes, contre leur oppression et la division sexuelle du travail pèsent sur la situation de celles-ci en premier lieu ; mais aussi de toute la classe ouvrière. Le syndicalisme, pour être le plus puissant outil de lutte, a une part de responsabilité dans cet état de fait. Deux siècles plus tard, les propos de Flora Tristan sont toujours d’actualité : « il faut montrer que l’émancipation des femmes est non seulement dans leur intérêt mais aussi dans celui de toute l’humanité. L’émancipation des femmes sera aussi celle des hommes ». Sans oublier que l’émancipation des femmes ne peut venir que des femmes elles-mêmes.
[1] Le Maitron est le nom d’usage d’un ensemble de dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier dirigé par Jean Maitron, jusqu’à sa mort en 1987. L’œuvre se poursuit.
[2]Flora Tristan (1803-1844) est l’une des figures majeures du féminisme et du socialisme français (https://maitron.fr/spip.php?article24362).
[3] Les femmes et l’organisation syndicale avant 1914, Madeleine Guilbert, CNRS, 1964.
[4] Le Peuple, 12 avril 1849.
[5] Citation : « La femme qui commande humilie son mari, et tôt ou tard elle le coiffe. La femme qui, dans le mariage, cherche le plaisir, ne vaut pas mieux : C’est une petite catin, paresseuse, gourmande, bavarde, dépensière, à qui son mari ne suffit pas longtemps. Donc, courtisane ou ménagère ; j’ai eu raison de le dire, et n’en démords pas », De la pornocratie dans les temps modernes, Proudhon, 1875 (œuvres posthumes).
[6] Jeanne Deroin, née le 31 décembre 1805 à Paris, morte le 2 avril 1894 à Londres ; ouvrière lingère puis institutrice, directrice de journaux « féministes » ; animatrice, sous la Deuxième République, d’associations ouvrières qui furent l’ébauche des syndicats (https://maitron.fr/spip.php?article29854).
[7] Marie Désirée Pauline Roland, née à Falaise le 18 prairial an XIII (7 juin 1805) et morte à Lyon le 16 décembre 1852, est une féministe socialiste française (https://maitron.fr/spip.php?article37228).
[8] « Flora Tristan et l’Union ouvrière », Toutes à y gagner ; vingt ans de féminisme intersyndical, Eleni Varikas, Editions Syllepse, 2017.
[9] The results of the census of Great Britain in 1951 », E Cheshire (1856) ; repris par François Bedaria dans « Londres au milieu du XIXe siècle : une analyse de structure sociale », Annales. Economies, sociétés, civilisations, 23ème année, n°2, 1968.
[10] Voir les écrits sur le travail « para professionnel » développés par Christine Delphy.
[11]Harriet Teresa Law (née Frost , 5 novembre 1831 – 19 juillet 1897) était conférencière salariée du mouvement laïc et s’est adressée à de nombreux publics, souvent hostiles, à travers le pays. Seule femme membre du Conseil général de l’AIT, elle y engage un débat notamment avec Karl Marx et Friedrich Engels. De 1877 à 1878, elle publie The Secular Chronicle, qui couvrait des sujets tels que le socialisme, l’athéisme et les droits des femmes.
[12] Lettre de K. Marx à L. Kugelmann, 12 décembre 1868.
[13] Le capitalisme patriarcal, Silvia Federici, Editions La fabrique, 2019. Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive, Silvia Federici, Editions Entremonde, 2017.
[14] Pour une théorie générale de l’exploitation, Christiane Delphy et Diana Leonard, Editions Syllepse, 2019 (première parution en anglais, 1992).
[15] Voir aussi Les utopiques n°8, « antiracisme et syndicalisme », Eté 2018.
[16] Henri Krasucki, né Henoch Krasucki le 2 septembre 1924 à Wołomin dans la banlieue de Varsovie en Pologne et mort le 24 janvier 2003 à Paris, est secrétaire général de la Confédération générale du travail de 1982 à 1992. Résistant, il fut membre actif de la section juive des FTP-MO pendant la deuxième guerre mondiale.
[17] Cette manifestation a rassemblé des dizaines de milliers de personnes et s’est pleinement inscrit dans la dynamique de ce qui allait devenir le mouvement de grève et manifestations de novembre/décembre 1995.
[18] A Pékin du 4 au 15 septembre 1995 a eu lieu la 4ème conférence mondiale sur les femmes : Lutte pour l’Égalité, le Développement et la Paix. Le Women’s Rights Are Human Rights »de Hillary Clinton deviendra un slogan des mouvements féministes dans les décennies suivantes. Les thèmes principaux abordés sont la promotion et l’autonomisation des femmes en matière de droits humains, les femmes et la pauvreté, les femmes et leur pouvoir décisionnel, la petite fille, les violences faites aux femmes et d’autres domaines de préoccupation. On peut douter de la pertinence du choix de Pékin comme lieu d’une conférence sur les droits humains et les libertés fondamentales, mais les constats faits sont justes.
[19] « Flora Tristan et l’Union ouvrière », Toutes à y gagner ; vingt ans de féminisme intersyndical, Eleni Varikas, Editions Syllepse, 2017.
[20] Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?, Maud Simmonet, Editions Textuel, 2018.
- Le syndicalisme et sa dette historique avec la lutte des femmes - 11 octobre 2020
