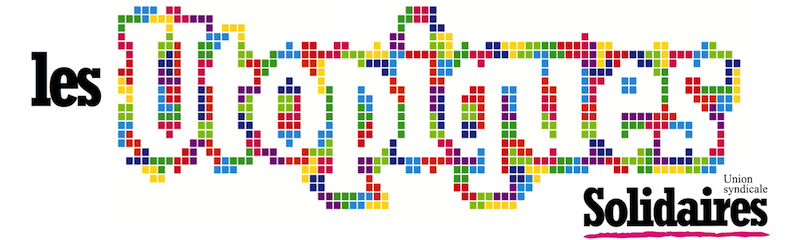Quel bel été !
Ce texte est bâti à partir de documents travaillés dans le cadre de l’Union nationale interprofessionnelle des retraité⸳es Solidaires (UNIRS) et de contributions répondant à l’appel lancé au sein de Solidaires en juillet dernier. Il est enrichi d’écrits d’autres camarades, car il ne nous parait pas utile de récrire des choses déjà fort bien exprimées. Nous ne prétendons nullement couvrir l’ensemble des problématiques actuelles, mais souhaitons en pointer quelques-unes.
Gérard Gourguechon, ex-secrétaire général du Syndicat national unifié des impôts (SNUI, aujourd’hui Solidaires Finances publiques), a été porte-parole de l’Union syndicale Solidaires jusqu’à son départ en retraite, en 2001. Il est co-secrétaire de l’Union nationale interprofessionnelle des retraité∙es Solidaires (UNIRS). Cheminot retraité, coopérateur des éditons Syllepse, Christian Mahieux est membre de SUD-Rail et de l’Union interprofessionnelle Solidaires Val-de-Marne, il coanime le Réseau syndical international de solidarité et de luttes et participe à Cerises la coopérative et à La révolution prolétarienne.
![Vu à la fête de L’Humanité. [P. Vassallo]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/5c-Illust1-GourguechonMahieux-Quel-bel-été.webp)
L’extrême droite en tête lors des élections du 9 juin
Commençons chronologiquement, par les élections européennes du 9 juin 2024 qui virent une extrême-droite largement en tête, face à des « partis de gouvernement » en déconfiture, dont celui du président de la République. La gauche a concouru divisée. La NUPES [1], qui avait été présentée par certain·es comme un nouvel espoir et un renouveau, s’était dissoute dans une série de candidatures isolées : le Parti communiste français, puis les Ecologistes, puis Place publique avec le Parti socialiste, et enfin la France insoumise. Le soir de ces élections européennes, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national (RN), fort de ses résultats, demande au président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale afin de « ne pas rester sourd au message envoyé par les Français ». Et, alors que constitutionnellement rien ne l’y obligeait, le président de la République, à la surprise générale, ou presque, y compris dans son camp, décide de dissoudre l’Assemblée nationale et de provoquer des élections législatives anticipées.
Les élections législatives
L’idée que la France puisse être dirigée par un gouvernement d’extrême-droite provoque un choc dans une partie de la population. Les élections législatives se déroulent sur deux tours, les 30 juin et 7 juillet 2024. Très rapidement après l’annonce de la dissolution, les partis de gauche, qui venaient de faire éclater la NUPES, se regroupent et se mettent rapidement d’accord sur un programme électoral, probablement plus d’opposition que de gouvernement, et sur une répartition des circonscriptions pour éviter de se concurrencer sur le terrain électoral. Outre les ex-NUPES (FI, les Ecologistes, PCF, PS), le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) intègre l’alliance électorale nommé Nouveau front populaire (NFP) ; Lutte ouvrière (LO) dépose ses candidatures propres. Le soir du premier tour, les listes d’extrême droite du Rassemblement national sont largement en tête dans un très grand nombre de circonscriptions. Si notre système électoral se déroulait sur un seul tour, le RN aurait disposé d’une très large majorité à l’Assemblée nationale. Si la répartition des sièges était proportionnelle aux résultats nationaux de chaque parti, le RN aurait été très largement la première force au Palais Bourbon [2].
Au sein de l’Union syndicale Solidaires, le débat est organisé à travers plusieurs Comités nationaux, pour préciser notre positionnement. Le Conseil d’administration de l’Union nationale interprofessionnelle des retraité·es Solidaires (UNIRS) en discute le 18 juin. Il est décidé d’appeler à faire barrage à l’extrême-droite et à ses alliés et à toujours porter nos revendications immédiates et de transformation sociale. Une minorité préconisait d’appeler à voter NFP. Entre les deux tours, le « barrage républicain » contre l’extrême-droite se met partiellement en place entre les candidatures NFP, une partie des macronistes et parfois les Républicains, la droite officielle. A l’issue du deuxième tour, à la surprise générale, ce sont les élu·es NFP qui sont légèrement les plus nombreux et nombreuses, devant les élu·es de l’ancien camp du président de la République puis le Rassemblement national. Finalement, le barrage républicain a en partie fonctionné, et grâce aux désistements et au scrutin majoritaire, les 37 % [3] de voix des électeurs et électrices d’extrême-droite n’ont donné que 25 % des député·es [4]. Ce fut un ouf de soulagement.
La gauche est devenue la minorité parlementaire la plus importante [5], le « centre » résiste mieux qu’il ne pouvait l’espérer et Macron, qui mettait déjà en œuvre en partie la politique du RN sur l’immigration et l’éducation au prétexte de mieux le désarmer, sort affaibli mais tout de même avec le deuxième groupe parlementaire. Cependant, la gauche ne devait pas être euphorique et faire comme si le programme du NFP avait été approuvé par la majorité relative des Français et Françaises [6] : de la même manière que les électeurs et électrices de gauche qui ont voté pour un candidat centriste ou de droite pour battre le RN ne sont pas devenu·es macronistes, les électrices et électeurs venu·es de la droite ou du centre n’adhèrent pas pour autant au programme du NFP tout en ayant voté pour ses candidats et candidates, contre le RN. Et personne ne devrait faire comme si la question du RN avait été réglée une fois pour toutes.
Le Gouvernement remplace le Gouvernement en attendant un Gouvernement
Nous avons ensuite connu la phase de désignation d’un nouveau Premier ministre. Selon les usages, le Premier ministre en exercice, Gabriel Attal, remet sa démission au président de la République. Macron la refuse. Nouvel étonnement. Reste que tout ceci semble autorisé par la lettre de la Constitution dont l’article 8 dit que « Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ». Pendant des semaines nous allons avoir un gouvernement démissionnaire qui va gérer les affaires courantes, ce qui crée des imbroglios institutionnels qui devraient en choquer plus d’un·e et qui, finalement, « passent » : des ministres démissionnaires mais toujours en activité sont devenu·es en même temps député·es ! Le Premier ministre par intérim, Gabriel Attal, était aussi chef du groupe présidentiel à l’Assemblée nationale ! Ceci fait de sérieuses entorses à la séparation des pouvoirs, pourtant socle de la République bourgeoise : des parlementaires occupent des fonctions de ministres gérant les affaires courantes, c’est-à-dire continuant d’appliquer la politique en œuvre depuis 2017…
Le programme, rien que le programme… Mais comment ?
S’en est suivi un nouvel embrouillamini duquel il est difficile d’extirper quelques visions claires. Quelques-uns et quelques-unes de LFI font comme s’ils/elles avaient obtenu la majorité absolue aux élections et annoncent qu’ils appliqueront leur programme, tout leur programme, et rien que leur programme. D’autres, au NFP, estiment qu’il faudra discuter avec des parlementaires extérieurs au NFP du fait de l’absence d’une majorité à l’Assemblée nationale, au risque de se faire immédiatement traiter de « social-traître » par les premier·es cit·es. Nous voyons aisément que, dans la situation actuelle, ce n’est pas possible pour le NFP de gouverner seul. Par exemple, pour abroger la réforme des retraites de 2023, ceci ne peut se faire que par une loi, un nouveau décret ne peut pas remettre en cause le décret d’application d’une loi. Rendre la loi de 2023 inapplicable par un nouveau décret est impossible ; sauf à ne pas respecter la Constitution de la 5ème république, ce qu’aucun groupe parlementaire n’évoque. Pour faire passer une nouvelle loi, il faudrait au moins 289 député·es et le NFP en est loin. Ce qui pourrait être possible, ce serait de réduire une partie des objectifs de la réforme, d’en modérer l’application. Pour éviter d’être qualifié·es rapidement de traitres, certain·es donc fanfaronnent, en faisant déjà comme si : comme si tous leurs électeurs et électrices étaient 100 % pour le programme, alors que, parfois, l’élection résulte du « désistement républicain ». La question qui se pose, c’est comment mettre en œuvre un programme que plus des deux tiers des citoyens et citoyennes n’ont pas approuvé. Par l’article 49-3 de la toujours respectée Constitution de 1958 ?
Le feuilleton de la nomination du Premier ministre
Pendant ce temps-là, le groupe arrivé le premier aux élections, le NFP, se cherche un candidat ou une candidate pour le poste de Premier ministre. Après quelques coups fourrés entre membres du NFP, après quelques divers noms avancés, après que quelques personnes réapparaissent en jouant des coudes, l’accord semble se faire au sein du NFP autour de la personne de Lucie Castets, inconnue du grand public. Comme pour le choix des candidatures aux législatives, comme pour la répartition des circonscriptions électorales, comme pour le programme, de nouveau, il faudrait faire confiance à celles et ceux qui se sont mis d’accord sur son nom ; c’est-à-dire les quatre partis politiques qui ont préempté le nom de Nouveau front populaire. Mais Macron, dont le parti a évité le pire, grâce au « désistement républicain », fait comme si rien n’était changé, et considère que c’est toujours sa ligne politique qui doit être appliquée. Il anticipe sur une éventuelle motion de censure ultérieure et, au nom de la stabilité institutionnelle, refuse de nommer la candidate du NFP. Il choisit même Bernard Cazeneuve, en faisant comme si c’était le candidat du NFP, alors que Bernard Cazeneuve a publiquement dénoncé l’accord électoral conduisant à la constitution du NFP.
![Manifestation parisienne du 19 janvier 2023. (D. Maunoury]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/5c-Illust3-GourguechonMahieux-Quel-bel-été.webp)
Immédiatement, les médias dénoncent l’ambigüité de la gauche qui ne voudrait pas arriver au pouvoir ; en réalité, Macron faisait tout pour que la gauche, certes pas majoritaire, mais première, ne puisse en rien mener quoi que ce soit. Ce n’est pas à Macron d’anticiper une éventuelle motion de censure contre un éventuel gouvernement, c’est à l’Assemblée nationale de le faire, le moment venu et quand elle en jugera. Ceci devient ubuesque : Macron est, par la Constitution, le garant des institutions et du respect de la Constitution, c’est lui qui est à l’origine de la crise institutionnelle que traverse le pays du fait de sa dissolution intempestive, et il vient se draper ensuite de la stabilité institutionnelle pour refuser le verdict des élections ! Nous voyons Macron manœuvrer pour essayer de construire une majorité de droite autour de Renaissance (Ensemble pour la République). La droite LR, qui maintient un groupe à l’Assemblée nationale, fait monter les enchères en affirmant qu’ils/elles ne gouverneront que sur leur base. Quelques-un·es, à droite, s’interrogent sur une alliance avec le RN pilotant un gouvernement qui pourrait avoir le soutien, au cas par cas, des député·es de droite et du centre (dont Renaissance). La clarification annoncée par Macron serait réussie, sans doute pas comme il l’entendait : tout le monde verrait que ce centre, c’est déjà la droite, et que l’extrême-droite, c’est toujours une droite dont le patronat s’arrange très bien. Dans tous les cas, il s’agit bien d’éviter tout programme qui viendrait contester, ne serait-ce qu’à la marge, les profits et les privilèges du capital. Et, pour ce faire, les entorses à la « démocratie », ce n’est pas un problème. Ce qui nous est toujours présenté comme la rationalité économique, c’est la poursuite et l’accentuation des mesures prises, notamment depuis 2017, de concentration des capitaux et des profits dans les mains de la minorité déjà la plus riche. Nous entendons Macron et nombre de représentants et représentantes des intérêts du capital parler de recherche du compromis, sachant que, de leur côté, il y a toujours refus total de quelque compromis que ce soit qui viendrait rogner les profits : l’économie est exclue du champ démocratique, l’économie relève des « lois du marché », c’est-à-dire que les plus forts bouffent les plus faibles.
Pendant des semaines, nous avons donc vu Macron manœuvrer, refuser de nommer la candidate finalement retenue par le NFP, le regroupement disposant du plus grand nombre de député·es. Malgré les tensions, le NFP résiste aux tiraillements et à l’éclatement. Ne pouvant appliquer son programme compte-tenu de son absence de majorité parlementaire, le NFP, en refusant tout compromis, permet plus facilement à Macron de poursuivre ses manœuvres pour le rapprochement de toutes les droites. Pendant des semaines, les supputations quant au « profil idéal » pour Matignon vont se poursuivre. Nous voyons certaines et certains refuser, et d’autres (parfois à qui personne ne songeait) faire savoir qu’ils et qu’elles sont disponibles « pour servir le pays ». Ce qui semble clair, c’est qu’au lendemain du second tour, compte-tenu de l’extrême tension qui apparaissait entre les différentes composantes du corps électoral, l’urgence pour celles et ceux qui s’étaient auto-désigné·es comme étant le « camp républicain », celui qui était parvenu à repousser le danger du RN à Matignon, aurait dû logiquement être de parvenir à un accord de gouvernement pour mettre en œuvre une politique permettant d’apaiser ces tensions (réduction des inégalités économiques, sociales, culturelles, écoute des populations et des corps intermédiaires, réimplantation des services publics, dont l’école et la santé, sur l’ensemble des territoires, etc.). Mais il n’en n’a rien été. Les affrontements partisans et de court terme ont primé. C’est pourtant l’humilité qui devrait l’emporter. La partition de l’échiquier politique en trois blocs devrait obliger à débattre, à construire des compromis, à écouter. Ou alors, il faut affirmer haut et fort et expliquer sans relâche qu’il n’y a pas de solution progressiste possible dans le cadre des institutions actuelles, celles de la Constitution que Mitterrand dénonçait comme Le coup d’Etat permanent [7], avant de fort bien s’en accommoder, comme celles et ceux qui lui ont succédé et aspirent aujourd’hui à le faire.
![[La Croix Et La Banniere – Formes des luttes]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/5c-Illust4-GourguechonMahieux-Quel-bel-été-724x1024.webp)
Habemus Primus minister !
Après 55 jours sans gouvernement, Emmanuel Macron a choisi de nommer Michel Barnier comme premier ministre. C’est une nouvelle période d’attente qui s’est ouverte, celle de la constitution d’un gouvernement, avec, de nouveau, de multiples supputations. Barnier, homme de droite et sur le nom duquel le RN n’a pas posé son veto, tente de se trouver une minorité de droite qui puisse tenir quelques mois. Barnier doit, pour ce faire, procéder à des équilibres pour essayer d’élargir sa base parlementaire. C’est toute la période du choix des ministres, des secrétaires d’État, etc. Avec encore les élucubrations de la presse et des commentateurs. Ensuite, le 1er octobre, il y a la déclaration de politique générale de Michel Barnier devant l’Assemblée nationale. Le 2 octobre, le Comité national de l’Union syndicale Solidaires en a fait le bilan :
« Michel Barnier a donné dans son discours de politique générale la tonalité de la politique du gouvernement qu’il dirige. Sans surprise, il a confirmé la poursuite de la politique ultra-libérale au service des plus riches. Sous prétexte de déficit public, des réductions records des dépenses publiques et sociales sont au menu de sa politique. Elles amèneront de nouvelles régressions pour les services publics et les droits des travailleurs et travailleuses. Même s’il a annoncé vouloir mettre un peu plus à contribution, et de façon temporaire, les plus fortunés, la justice fiscale n’est pas au rendez-vous, loin de là ! S’agissant de la réforme des retraites, il se dit prêt à des aménagements mais sans remise en cause de l’équilibre financier du système. Pour Solidaires, il ne saurait y avoir de négociations à la marge sans revenir au préalable sur le recul de l’âge légal de départ. Amplification du Revenu de solidarité active (RSA) conditionnel, réforme de l’assurance chômage sous forte contrainte financière ou reprise de l’examen du projet de loi logement de vente à la découpe du logement social, augmentation largement insuffisante du SMIC juste avancée de deux mois, participation, intéressement… c’est Macron qui a écrit le discours de Barnier.
Le Premier ministre reprend de plus plusieurs idées nauséabondes de l’extrême droite en choisissant notamment de faire des immigré·es les boucs émissaires des difficultés sociales comme sur les questions sécuritaires avec l’extension des dispositifs mis en place lors des Jeux olympiques ou la révision de l’excuse dite de minorité ainsi que la remise en cause de l’Aide médicale de l’Etat (AME). De plus, la composition de son gouvernement est un signal désastreux à l’égard des femmes et des LGBTQI. Les femmes sont en effet pour la plupart reléguées à des postes subalternes. De plus, six ministres ont voté contre le mariage pour tous, l’une s’est abstenue. Plusieurs ministres ont voté contre l’inscription de la liberté d’avorter dans la Constitution. Pour l’Union syndicale Solidaires, l’arrivée au gouvernement de personnalités aussi réactionnaires est inacceptable. Les déclarations de principe du Premier ministre à cet égard n’inspirent aucune confiance.
L’argent est là pourtant : les profits des grandes entreprises françaises n’ont jamais été aussi hauts, les richesses n’ont jamais été aussi concentrées. Pourtant, les inégalités sociales augmentent, et la bifurcation écologique ne cesse de reculer. À cet égard, les déclarations du Premier ministre encourageant le nucléaire, menaçant les éoliennes et les mesures visant à lutter contre l’artificialisation des sols sont particulièrement inquiétantes. »
Et le syndicalisme dans tout ça ?
Dans une contribution écrite début juillet [8], notre camarade Simon Duteil écrivait : « Nous sommes (le syndicalisme) la force sociale la plus organisée et la plus implantée sur le territoire avec une capacité de coordination à toutes les échelles. Nous organisons des millions de travailleuses et de travailleurs [9]. Bien sûr il existe nombre de structures, en particulier des collectifs et des associations, qui travaillent au quotidien dans les quartiers, dans les villages, sur les terrains de sports, auprès de différentes catégories de la population. Mais aucune avec la force de frappe des syndicats. […] Syndiquer, syndiquer, syndiquer ! Sommes-nous en train de mener une information générale auprès de nos collègues, de la population, vers les endroits où il n’y a pas d’implantation syndicale ? La période est périlleuse. Nombre de personnes se rendent compte qu’être isolé n’est plus une possibilité, surtout si on est une cible directe de l’extrême-droite (femme, racisé·e, LGBTQUIA+, antifasciste…). Et quel meilleur outil pour se défendre et pour lutter au quotidien au travail que le syndicat ? Il n’y a pas à attendre, c’est le moment de proposer de toute part de nous rejoindre et d’accompagner les nouvelles et nouveaux camarades, y compris par beaucoup de formations. […] »
Le propos de Simon n’est pas de mythifier la force du syndicalisme. Nous connaissons nos faiblesses ; mais le syndicalisme joue un rôle central dans la lutte pour l’émancipation sociale. A notre sens, il doit le jouer en toute autonomie ; ce qui n’a jamais voulu dire sans faire de politique. Bien au contraire, le syndicalisme est politique ; il construit ses réflexions politiques, ses actions politiques, ses visées politiques, en toute indépendance parce qu’il est la seule force organisée sur la seule base de l’appartenance à une classe sociale, celle des exploité·es. Notre autonomie en tant que classe sociale implique de ne pas être à la remorque de partis politiques pour faire de la politique. A l’inverse, elle n’a jamais signifié que nous ne devions avoir aucun contact, aucune démarche commune avec ceux-ci. En cela, toute une partie du débat sur la nécessité de dépasser la Charte d’Amiens n’a pas grand sens. « La Charte d’Amiens pose comme principe une indépendance de classe, une capacité de la classe des opprimé∙es à avoir son propre projet émancipateur. L’indépendance n’a en effet aucun sens, si l’organisation prétendument indépendante n’a pas sa propre vision, ses orientations stratégiques propres. La double besogne dont parlait Fernand Pelloutier constitue une des spécificités majeures du syndicalisme révolutionnaire. Les modèles socio-démocrates dans leurs versions réformistes et/ou radicales, le travaillisme, opèrent une séparation entre l’économique et le politique et délimitent des champs de compétences séparés pour les organisations syndicales et les organisations politiques. […] Ce qui change par rapport à 1906 est sans doute la pluralité des acteurs et actrices. Le syndicalisme ne peut plus prétendre se suffire à lui-même et est bien obligé d’accepter de travailler avec toute une série d’associations, de mouvements de luttes spécifiques. Il y a donc tout lieu de penser qu’une confrontation au sein même du mouvement social est nécessaire pour élaborer de nouvelles perspectives de transformation de la société. Chacun à partir de sa réalité sociologique et de son expérience est en mesure d’apporter des éléments permettant de construire l’ensemble. Dans ce cadre, la capacité de l’organisation syndicale, à partir également de sa réalité de classe, à élaborer des éléments de réponses stratégiques constitue un enjeu. Un enjeu majeur pour ancrer les réponses du mouvement social dans une perspective de classe. Ce travail d’élaboration des composantes du mouvement social n’implique pas que les partis et courants politiques n’auraient plus aucune pertinence. Cela signifie que les partis politiques et les composantes du mouvement social acceptent, dans les faits, le pluralisme et la pluralité des légitimités. [10] »
Notre classe sociale
L’appel à contributions lancé dans l’Union en juillet évoquait la recherche de quelques repères qui puissent nous aider dans nos positionnements collectifs. Il en est un, qui est d’ailleurs à l’origine de notre regroupement syndical, et qui explique l’essentiel de notre création comme nouvelle structure syndicale en 1998. Ce marqueur commun qui explique pourquoi nous existons, c’est la volonté d’indépendance par rapport aux appareils politiques. Notre Union s’est faite en trois étapes avant de déboucher sur un congrès constitutif en 1998. La première étape, c’est 1981, avec le regroupement de dix syndicats autonomes qui refusaient l’alignement des confédérations syndicales sur le gouvernement de gauche arrivé au pouvoir le 10 mai 1981, lui laissant les mains libres et, finalement, le laissant impuissant face au patronat et au mur de l’argent. Ces dix organisations avaient même la prétention de vouloir faire comme en 1936.
![Dans la manifestation parisienne CGT-Solidaires-FSU du 1er octobre. [Serge D’ignazio]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/5c-Illust5-GourguechonMahieux-Quel-bel-été-762x1024.webp)
Par ailleurs, la plupart s’étaient créées en choisissant l’autonomie en 1947/1948, lors de la scission entre CGT et CGT/FO, refusant de choisir entre Moscou et New-York au début de la guerre froide, refusant de s’aligner sur le PCF ou sur les autres, mais privilégiant l’unité interne. La deuxième étape, c’est 1989, avec la création de SUD PTT après l’exclusion de la CFDT pour cause de grève alors qu’il y avait un gouvernement de gauche (Mitterrand – Rocard), soutenu par la direction de la CFDT qui ne voulait pas entraver ses choix politiques. La troisième étape, c’est 1995-1996, avec la grève de fin 1995 contre le plan Juppé de casse de la Sécurité sociale, dont l’hôpital public et les retraites. La direction de la CFDT (et aussi une partie du PS) soutenait cette réforme, mais des syndicats et des fédérations de la CFDT se sont engagés totalement dans la grève avec la CGT, FO, la FSU et le Groupe des 10. À l’issue de ce conflit, des équipes CFDT ont quitté la CFDT pour créer des syndicats SUD et rejoindre notre regroupement syndical en cours de construction, là encore pour des raisons d’indépendance syndicale par rapport aux appareils politiques et de choix de prioriser les revendications [11].
Ne pas sous-traiter notre politique à des partis
Dans la période que nous venons de vivre, nous avons eu des débats quant au positionnement de notre Union syndicale par rapport aux récentes élections. Nous n’avons guère entendu élections, piège à cons, qui fustige la délégation de pouvoir par un système de démocratie représentative. Nous partageons le texte publié sur le site syndicalistes.org [12], dès le 12 juin, par Baptiste Pagnier, militant CGT à Paris :
« Pourquoi intervenir dans le jeu électoral, malgré la longue tradition de mise à distance des enjeux politiciens par le syndicalisme français ? Parce qu’il en va ni plus ni moins que de l’arrivée d’un parti ouvertement d’extrême-droite au gouvernement, mettant en jeu la survie même du mouvement syndical (parmi beaucoup d’autres choses). Que l’on pense à l’impressionnant appareil répressif bâti patiemment ces dernières années, et à l’usage qui en serait fait s’il venait à tomber entre les mains du Rassemblement national… Nul besoin de tourner en boucle sur les entraves à la démocratie, la politique raciste, la répression tous azimuts, les attaques généralisées contre le salariat menées par Macron ces dernières années : nous avons été en première ligne pour les combattre, et sommes donc assez bien au courant de leur ampleur. Mais on parle ici d’un potentiel saut qualitatif dans la vitesse, la généralisation et la violence de l’offensive réactionnaire si l’extrême-droite venait à gagner ces élections. Sans parler de l’effet libératoire qu’elle aurait pour les violences policières ainsi que pour toutes les forces fascistes extra-parlementaires violentes, ou encore pour le patronat qui aurait une garantie d’impunité complète face à nos organisations syndicales, etc. Il y a donc un vrai enjeu à freiner autant que possible l’extrême-droite lors de ces élections. Non pas que cela résoudrait la situation politique. Mais ce serait a minima un gain de temps, un répit avant les prochaines échéances électorales, et surtout l’occasion de retrouver une dynamique de victoire et un certain enthousiasme dans le mouvement syndical.
[…] Mais il ne faut pas se faire d’illusions : quelle que soit l’issue de cette élection législative, nous aurons besoin d’un syndicalisme fort ensuite. Que la gauche l’emporte, et il faudra un mouvement social puissant pour imposer de vraies réformes et la pousser à aller au-delà d’un agenda très timoré (faut-il rappeler que les conquêtes de juin 36 l’ont largement été contre le gouvernement, par un mouvement ouvrier réveillé et revigoré par la victoire électorale de l’alliance des gauches ? ). Que le parti présidentiel conserve sa majorité, alors seul un mouvement social encore plus massif que celui de l’année 2023 pourra stopper son glissement autoritaire et sa volonté d’en finir avec tous les droits salariaux. Enfin, que l’extrême-droite gagne, et elle aura un boulevard pour déployer ses politiques racistes et ultracapitalistes : il faudra alors un syndicalisme solide pour tenir le coup. Et quoi qu’il en soit, une défaite électorale de l’extrême-droite ne solderait pas sa fin : ses partis sont désormais solidement ancrés localement, comptent des militants nombreux et formés, et se prépareraient à mieux revenir en 2027.
Ne faisons pas de fausses promesses, donc : tout ne va pas se jouer lors de cette élection. Nous ne sommes pas là pour faire croire que seul le jeu électoraliste en vaut la peine. Il faut traiter le moment à la hauteur de ses enjeux réels, sans les n’exagérer ni les minimiser : oui, nous devons diminuer autant que possible le nombre de sièges qui reviendront à l’extrême droite à l’Assemblée, et y envoyer le maximum de député·es de gauche (aussi molle soit-elle) que possible. Mais sans en faire la seule carte à jouer : la dynamique de ces prochaines semaines doit permettre de lancer un travail dans la durée, seule voie possible pour renverser le cours des choses. Travail dans la durée pour se préparer au pire : que l’extrême-droite gagne les prochaines élections ou non, elle ne restera pas loin du pouvoir, et il faut dès aujourd’hui anticiper ce que deviendraient nos organisations sous un régime autoritaire assumé, comment continuer nos activités militantes, comment faire face à une répression démultipliée, etc. Mais travail dans la durée aussi pour préparer le meilleur : pour porter l’ambition syndicale de transformation sociale radicale, autour d’une extension de la Sécurité sociale et de la rupture écologique. Parce que c’est l’objectif qu’on poursuit, et parce que pour défaire la vision sociale raciste de l’extrême-droite, il faut y opposer d’autres aspirations et d’autres projets susceptibles de soulever l’enthousiasme. Ces deux faces doivent être tenues ensemble, et abandonner l’une des deux serait se condamner à l’impuissance. Toutes deux, très concrètement, demandent un effort massif de syndicalisation, un mouvement déterminé et volontariste en direction des salarié·es non syndiqué·es, un travail d’organisation redoublé, une mobilisation généralisée des équipes militantes.
Tout cela demande de ne pas dilapider son énergie. Les rassemblements symboliques entre convaincu·es peuvent être utiles pour peser sur l’union des forces de gauche, mais ils ne convaincront pas les électeur·ices, et ne permettent que rarement d’organiser de futur·es militant·es. Si nous y participons, ce doit être en cherchant à y discuter pour « prendre la température » des présent·es, et pour montrer que nos syndicats sont un débouché concret aux volontés de mobilisation. Mais l’efficacité de notre action dans ces prochaines semaines sera d’abord fonction du temps passé avec celles et ceux qu’on ne voit pas d’habitude : les syndiqué·es et syndicats qui se trouvent hors de la vie de l’organisation et qu’il s’agit de remobiliser, mais aussi les salarié·es non syndiqué·es, les déserts syndicaux – typiquement dans les secteurs féminisés – où aucune voix de gauche ne va jamais porter.
Un risque serait que les forces syndicales ne viennent qu’en appui de la dynamique lancée par les partis politiques, en leur délégant un rôle d’impulsion et de production des mots d’ordre. Ce serait tomber dans l’illusion d’une autosuffisance des élections. Encore une fois, on ne stoppe pas l’extrême-droite en un jour. La montée du fascisme est aussi le produit de l’affaiblissement du mouvement syndical, de son incapacité à adapter ses structures pour organiser le salariat actuel et de proposer une perspective émancipatrice rassembleuse et crédible […] »
![[Boris Semeniako – Formes des luttes]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/5c-Illust6-GourguechonMahieux-Quel-bel-été.webp)
De façon réaliste, nous savions que l’issue des élections législatives pouvait être, le plus sûrement compte tenu des rapports de force idéologiques et culturels actuels, l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement d’extrême droite. De façon réaliste encore, dès lors que le système démocratique actuel nous permet plus ou moins de choisir le gouvernement auquel nous allons être confronté·es, mieux vaut en choisir un qui se présente comme le moins agressif possible à l’égard de nos revendications. C’est pourquoi le positionnement majoritaire de notre Union, pas une voix pour l’extrême-droite, paraît être un bon équilibre. Des camarades et quelques structures ont soutenu que le risque d’arrivée de l’extrême droite à Matignon était un évènement exceptionnel qui justifiait que nous appelions ouvertement à voter pour le Nouveau front populaire. Mais appeler à voter Nouveau front populaire, c’était appeler à voter pour un appareil sur lequel, collectivement, nous n’avons aucune prise [13] ; c’était aussi permettre à certaines et certains de s’autoriser à croire pouvoir disposer de notre soutien. Nous avons vu comment la NUPES, pour laquelle des camarades s’étaient aussi emballé·es, a explosé en plein vol. Une minorité proposait même de rejoindre le Nouveau front populaire, d’y adhérer en tant qu’organisation syndicale. Autrement dit : renoncer à notre capacité collective autonome de réflexion, d’élaboration et d’action, pour nous mettre au service de quatre partis politiques qui avaient déjà décidé sans nous (ni les autres mouvements sociaux) des postes à se répartir évidemment, mais surtout du programme, donc des revendications ; NFP qui, ultérieurement, n’a jamais dévié de cette vision verticale, exclusive, donc non démocratique, de la politique. Selon les principes auxquels nous disons nous référer actuellement, ceux de l’autonomie du mouvement ouvrier (sachant qu’il est toujours possible d’en changer après des débats dans nos équipes syndicales), il nous faut essayer de sauvegarder l’autonomie de notre organisation syndicale, c’est-à-dire ne pas limiter ses possibilités de choix ultérieurs par une décision qui la lierait à travers un engagement sur lequel elle n’aurait aucune maîtrise.
Le mouvement ouvrier n’a pas toujours suivi une conception délégataire entraînant la dissociation du social et du politique. Il a obtenu ses grandes victoires structurelles dans les moments où il n’a pas délégué l’action politique aux partis, aux éluFes et au patronat et qu’il leur a disputé en actes l’exercice du pouvoir. Nous en avons un bel exemple avec la création de la Sécurité sociale et des services publics. Quand on parle du programme du Conseil national de la Résistance (CNR), on oublie la démarche qui l’a rendu possible. Pendant la guerre, les « élites » sont discréditées et le mouvement populaire se substitue aux institutions qui collaborent. De fait, le peuple prend le pouvoir et imagine une autre société. Il vise la destruction de l’appareil d’Etat en place et s’y substitue, Il prend aussi la place de l’armée, il fournit un travail de portée législative. Dans ce contexte, la CGT, et même la CFTC, quand elles contribuent à l’élaboration du programme du CNR, ne se posent pas la question de savoir si elles font du syndicalisme ou de la politique. A ce moment-là, la répartition des rôles n’existe pas. Le syndicalisme, l’associatif, les partis et mouvements sont autant de portes d’entrée spécifiques pour contribuer à une construction politique à l’échelle de la société. A ce titre, la Résistance n’est pas seulement la lutte victorieuse contre l’occupant nazi, mais un grand moment d’exercice du pouvoir et de transformation de la société par et pour le peuple rassemblé. Et le retour à la normale, auquel une grande partie du mouvement ouvrier a d’ailleurs largement contribué à l’époque, sonne la fin des avancées. Cette division des taches n’existait pas non plus lors de la Première internationale dans laquelle se retrouvaient côte à côte et à égalité, des syndicalistes, des associatifs et des politiques…et même une fanfare. Mais cette dimension autogestionnaire a été occultée par l’Histoire officielle et cette omission contribue à maintenir dans l’idée que les exploité·es ne peuvent que déléguer leur pouvoir aux spécialistes de la politique.
Revenons à l’été 2024. L’urgence était que l’extrême droite ne soit pas à l’Assemblée nationale. Pour toutes celles et tous ceux pour qui tel était bien l’objectif prioritaire, les nombreuses distributions de tracts syndicaux, dans les gares, les stations de métro ou du bus, les villages, les entreprises, les marchés, etc., ont été bien plus utiles, par le public touché et par la dynamique créée, que les discussions sur le bon mot d’ordre à répéter entre nous. Une fois de plus, l’important était d’avoir un outil syndical commun efficace, pas de gagner une pseudo bataille interne, par ailleurs sans portée concrète. L’investissement de nombreuses équipes Solidaires (pas seulement !) dans ces semaines de juin/juillet invite à se demander pourquoi cela ne serait pas possible dans la durée. C’est indispensable pour combattre l’extrême droite : ça ne peut pas se limiter à quelques jours au moment des élections. Il faut reprendre le terrain : la question de l’hégémonie culturelle (l’idéologie dominante) est importante, mais l’occupation du terrain, des terrains, y concoure grandement.
![Manifestation Education nationale du 1er février 2024, à Paris. [Serge D’ignazio]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/5c-Illust7-GourguechonMahieux-Quel-bel-été.webp)
Dans cette période, il faut certainement éviter que l’intersyndicale, celle qui a gagné une relative crédibilité et légitimité lors du conflit du printemps 2023 contre la réforme des retraites, ne se mouille dans les querelles partisanes et prenne position dans la concurrence entre les écuries pour l’accès au pouvoir institutionnel, sachant que certaines et certains se positionnent déjà pour les prochaines élections, particulièrement pour la prochaine élection présidentielle, normalement fixée en 2027. À court terme, il faut continuer de porter nos revendications urgentes, mais en gardant en tête que notre objectif commun, c’est aussi la satisfaction de toutes nos revendications et une transformation sociale. Tout ce qui pourrait être gagné est bon à prendre : toute augmentation du SMIC, toute amélioration du pouvoir d’achat, tout recul sur la réforme des retraites, etc. Ce n’est pas l’orientation du gouvernement Barnier, mais nous parlons là de ce que nous voulons imposer par le rapport de forces, qui peut aussi entraîner des conséquences quant à la durée de vie du gouvernement, compte tenu de la situation parlementaire. À moyen terme, il s’agit d’obtenir des avancées sociales plus importantes et ouvrant la voie à d’autres progrès sociaux : droit de veto des travailleurs, des travailleurs et de leurs organisations syndicales dans les CSE, remise en place des CHSCT et des Délégué·es du personnel, un autre partage des richesses produites, des services publics accessibles à tous et toutes, sur tout le territoire et couvrant un champ d’activité plus important qu’aujourd’hui, etc. Ceci implique un rapport de force idéologique et politique qui n’est pas atteint. Les organisations syndicales ont tout un travail de syndicalisation à faire pour améliorer la conscience de classe du monde du travail. À long terme, il s’agit d’inverser le rapport de force entre le capital et le travail, ce qui passe notamment par une remise en cause de la totale liberté de circulation des capitaux, sans limites ni contrôles, sur toute la planète. C’est par ces libertés que le capital parvient à mettre toutes les mains d’œuvre nationales en concurrence entre elles, et tous les régimes sociaux, et toutes les réglementations sanitaires, environnementales, fiscales, etc. En parallèle doivent être posées les questions relatives à la gratuité des communs utiles à chacun, chacune, tous et toutes, à l’auto-organisation, à l’éradication de toutes discriminations, etc. Nous sommes encore très loin d’avoir gagné la bataille culturelle pour mettre en œuvre ces réformes révolutionnaires. Ceci nous montre aussi le travail à faire pour notre organisation syndicale : de la syndicalisation, du syndicalisme du quotidien, de la formation syndicale, de l’internationalisme, etc.
Contre l’extrême droite
Depuis des années, nous rédigeons des communiqués et des tracts mais, trop souvent, ils sont stockés dans les permanences syndicales et pas distribués. Trop souvent le discours syndical repose principalement sur des principes moraux : ce n’est pas bien de détester « les autres ». Ou bien, nous apportons des informations quant à la réalité de l’extrême droite dans l’histoire, dans l’histoire de la France, dans la réalité d’autres pays, hier et aujourd’hui, en revenant sur les méfaits et les conséquences dramatiques pour nombre de personnes. Nous constatons que ces discours ne suffisent pas, de même que le travail fait pour ouvrir les yeux de nos concitoyens et concitoyennes en leur montrant la réalité des votes de l’extrême droite en France et à Bruxelles, votes en total décalage avec leur discours actuel qui semble ouvert sur le social, voire sur le sociétal. Répéter que voter RN c’est immoral ou absurde et contraire aux intérêts du peuple, ça ne suffit manifestement pas pour éviter que 37 % des voix des électeurs et électrices qui votent aillent à l’extrême droite. C’est un échec quand nous constatons que, même parmi les personnes qui se reconnaissent proches d’une organisation syndicale, il y a maintenant un pourcentage significatif de gens qui se disent également proches de l’extrême droite. Et ceci est vrai aussi dans Solidaires. C’est comme ça qu’on peut comprendre qu’à la suite des révoltes fortes menées par les Gilets Jaunes puis après la forte contestation contre la réforme des retraites au printemps 2023, opposition menée par une intersyndicale unie, les résultats électoraux se mesurent principalement au RN ! L’extrême-droite apparaît à certaines personnes comme le débouché aux luttes ! Ce que nous prenons pour un non-argument, à savoir nous ne les avons jamais essayés, signifie tout de même qu’on a essayé tous les autres … et que tous les autres ont déçu, trahi, échoué, etc. Comment faire croire que tous les partis qui ont déçu, menti, trahi, échoué, etc., se seraient transformés et qu’il faudrait désormais leur faire confiance ?
« Nous ne partons pas de rien : le travail est important depuis des décennies, en particulier par notre commission antifascisme, mais aussi par et dans VISA (Vigilance et initiatives syndicales antifascistes). Mais nous devons faire ce que seul le syndicalisme peut faire : un travail de terrain patient, de reconquête dans les idées qui passera par une réflexion sur la socialisation du RN. Car si le fondement raciste est indéniablement partagé par des millions de personnes qui votent RN, et montre sa profondeur systémique, il y a aussi la question de la sociabilité du quotidien qui conforte dans le choix de l’extrême droite. […] il faut toujours repartir du concret pour éviter une position surplombante d’un discours politique ou d’une position “juste” mais pas opérationnelle si elle est inadaptée pour parler et entraîner les collègues. Penser avoir raison mais ne parler à personne, c’est l’inverse du syndicalisme. De façon plus large encore, Il y a aussi la question du rapport au travail : le discours libéral sur les “assisté·es” contre “celles et ceux qui travaillent” a fait des ravages en profondeur qu’il nous faut prendre à bras le corps. Non seulement elle alimente une partie de l’extrême droite (plus qu’avant du fait de son absorption d’une partie importante de la droite “classique”) mais en plus elle est un réel frein à la possibilité de faire accepter nos positions sociales. Il en va de même avec la négation par l’extrême-droite de la crise écologique. [14] »
Organiser notre classe sociale
Le syndicalisme est politique. Il rassemble celles et ceux qui décident de s’organiser ensemble sur la seule base de l’appartenance à la même classe sociale. Ensemble, ils et elles agissent alors pour défendre leurs revendications immédiates et travailler à une transformation radicale de la société. Depuis des dizaines d’années, un grand nombre d’associations, de collectifs, de groupements de fait, jouent un rôle considérable dans le mouvement social. Quasiment tous et toutes se sont construits parce que le syndicalisme a abandonné des champs de lutte ou les a ignorés ; de fait, ces organisations aux contours divers font « du syndicalisme » : associations de chômeurs et chômeuses, pour le droit au logement, de défense des sans-papiers, coordination de travailleurs et travailleuses précaires, etc. D’autres interviennent sur des sujets qui sont pleinement dans le champ syndical : féministes, antiracistes, écologistes, antifascistes, antisexistes, etc. Se pose aussi la question du lien avec les travailleurs et travailleuses de la terre. Il y a aussi les mouvements anticolonialistes, revendiquant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, antimilitaristes, pacifistes, etc. Tout cela concerne les intérêts et l’avenir de notre classe sociale et c’est de ce point de vue qu’il faut les traiter.
![[Solidaires]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/5c-Illust8-GourguechonMahieux-Quel-bel-été-723x1024.webp)
Si nous mettons en avant les mouvements sociaux, c’est parce que ce sont eux qui organisent les luttes, l’action directe des travailleurs et des travailleuses. Parmi ces mouvements, le syndicalisme a une particularité essentielle : comme dit précédemment, il rassemble sur la seule base de l’appartenance à la même classe sociale. C’est fondamental. Un syndicalisme de lutte bien sûr, mais aussi un syndicalisme qui ose des ruptures avec l’existant pour mieux avancer. La question de l’unité, voire de l’unification, est importante. Il s’agit aussi de redéfinir les contours de l’organisation syndicale. La notion de « centrale syndicale et populaire » n’est pas sans attrait [15].
Après la révolution de 1789, la bourgeoisie n’a accepté la République qu’une fois certaine de pouvoir y trouver ses intérêts. La République que nous connaissons aujourd’hui est issue du massacre des communeux et communeuses en 1871. La Constitution de 1958 organise la confiscation des pouvoirs par le président de la République. Nous devons agir, sans rechigner sur les moyens, pour que ces outils ne tombent aux mains de l’extrême droite. Mais ces outils-là ne seront pas ceux construisant l’émancipation sociale, la fin de l’exploitation capitaliste, des dominations, des discriminations. C’et ailleurs que ça se joue, dans les luttes et révoltes sociales. L’extrême droite n’y est guère à l’aise, on le constate lors de chaque grand mouvement, mais aussi localement, à travers les combats collectifs dans les entreprises par exemple : côte à côte, ensemble dans le combat social, le rejet de l’autre est obsolète ; ce sont aussi des espaces et des temps pour démontrer qui sont les privilégiés, les exploiteurs, les parasites, et comment cela est inhérent au capitalisme. Il n’y a rien de magique dans tout cela, mais la possibilité de redonner ainsi une place, une voix, à toutes celles et tous ceux qui sont exclu⸳es du jeu politique institutionnel. Les organisations syndicales, des associations, des collectifs, c’est-à-dire les mouvements sociaux, produisent de la politique ; ce sont stricto-sensu des « organisations politiques », sans en faire pour autant des partis, des groupements destinés à gérer les institutions dans le cadre actuel de la société.
⬛ Gérard Gourguechon, Christian Mahieux
[1] Nouvelle union populaire écologique et sociale. Coalition créée en mai 2022, dans la perspective des élections législatives du mois suivant.
[2] La remarque est faite au regard des résultats réels du 30 juin ; si ce système proportionnel avait été effectivement en vigueur sur un seul tour, on peut penser que le panorama des candidatures aurait été sensiblement différent, donc les résultats aussi ; sans pour autant qu’ils soient bouleversés.
[3] Lorsqu’on prend en compte les 33% d’abstentions, les 2,76% de votes blancs, les 0,91% de votes nuls, l’extrême droite recueille 24% des électeurs et électrices inscrit·es. Dans ce cas, bien évidemment, les chiffres de tous les partis sont à reconsidérer dans la même proportion.
[4] Après ces élections et les ralliements ou départs de dernière heure, l’Assemblée nationale compte 11 groupes parlementaires : Rassemblement national (125 député·es), Ensemble pour la République (95), La France insoumise (72), Socialistes (66), Droite républicaine (47), Ecologiste et social (38), Les démocrates (36), Horizons et indépendants (33), Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (22), Gauche démocrate et républicaine (17), UDR (16) ; il y a 9 non-inscrits. Sur les 577 député·es, le Nouveau front populaire (NFP) en compte donc 193, réparti·es dans quatre groupes : La France insoumise, Socialistes, Écologiste et social, Gauche démocrate et républicaine.
[5] Sur 577 député·es, le Nouveau front populaire (NFP) en compte 193, réparti·es dans quatre groupes : La France insoumise, Socialistes, Écologiste et social, Gauche démocrate et républicaine.
[6] Rappelons que les élections ne concernent pas le peuple vivant en France, mais seulement les Français et les Françaises : élections municipales, départementales, régionales, européennes, législatives, présidentielles, les millions de travailleurs et travailleuses immigré·es n’ont pas le droit de voter (en dehors des seul·es ressortissant·es de l’Union européenne, pour les seules élections européennes et municipales).
[7] Essai de François Mitterrand, publié en 1964.
[8] https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/la-revue-les-utopiques/contributions-et-reflexions-sur-la-periode-juillet-2024/
[9] La formule signifie que, par ses actions quotidiennes et dans la durée, dans les entreprises, les services, les localités, le syndicalisme organise des millions de travailleurs et travailleuses ; il ne s’agit pas – malheureusement – du nombre de personnes syndiquées.
[10] Thierry Renard, « De la Charte d’Amiens », Les utopiques n°22, éditions Syllepse, printemps 2022.
[11] Sur tout cela voir Les utopiques n°25, éditions Syllepse, printemps 2024, dont le dossier porte sur les 25 ans de Solidaires.
[12] Le texte complet est à lire ici : www.syndicalistes.org/nos-taches-immediates-face-a-l-extreme-droite
[13] A ce propos, dans plusieurs circonscriptions, appeler à voter NFP, c’était appeler à voter pour des candidats ou candidates chargé·es d’éliminer des « opposant·es » au sein de la FI !
[14] Contribution de Simon Duteil précédemment référencée.
[15] Par exemple, au Brésil, la « Central Sindical y Popular » CSP Conlutas regroupe en sein, à la fois des organisations syndicales au sens traditionnel du terme et ce que nous appelons « mouvements sociaux » : Movimento Mulheres em Luta (Femmes en lutte), Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (Terre, travail et liberté), Movimento Urbano dos Sem-Teto (Mouvement urbain des Sans-Toît), Movimento Quilombo Raça e Classe (Quilombo, race et classe), etc.
- Quand l’économie de guerre sert les partisans de l’austérité, version brutale - 31 juillet 2025
- Une autre économie, pour une paix juste et durable - 30 juillet 2025
- Face à la déstabilisation du monde : opposer le visage de la solidarité - 29 juillet 2025