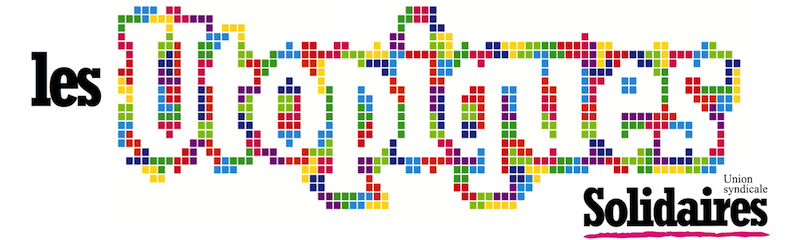Perruque…. Le retour
Pour les lecteurs et lectrices des Utopiques, la « Perruque » est un sujet déjà abordé. Bien sûr il ne s’agissait pas de la perruque de cheveux mais du terme qui désignait « la perruque au travail ». Cette pratique, très répandue et néanmoins méconnue, était définie comme « l’utilisation de matériaux et d’outils par un travailleur sur le lieu de l’entreprise, pendant le temps de travail, dans le but de fabriquer ou transformer un objet en dehors de la production réglementaire de l’entreprise ». Depuis 2017, la connaissance de ce fait social a progressé. L’article des Utopiques n’envisageait que la perruque ouvrière. Il n’existait, il y a quelques années, que deux ouvrages couvrant cette pratique. Depuis, un livre, à la demande de Syllepse, a pu paraître, élargissant largement cette question.
Entré comme coursier au Crédit Lyonnais à 15 ans, Robert Kosmann en démissionne en 1968. Après avoir exercé divers métiers, en 1973 il devient ouvrier chez Renault, où il reste jusqu’à la fermeture de l’usine de Saint-Ouen, en 1991, Après une période de chômage, durant laquelle il s’inscrit à l’université, il est embauché en 1999 aux Impôts, il coanime alors la section locale du SNUI et Solidaires 93, avant de devenir permanent syndical en 2006 pour Solidaires Industrie, jusqu’à sa retraite en 2011. Collaborateur du dictionnaire Maitron, il a écrit Sorti d’usines, (éditions Syllepse, 2018).
![Sorti d’usines. La « perruque », un travail détourné. [Syllepse]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust9-Kosmann-Perruque-Le-retour-683x1024.webp)
La « valeur travail » est aujourd’hui l’objet de débats : en témoignent par exemple, la député écologiste Sandrine Rousseau citant Le droit à la paresse de Paul Lafargue et la vive réponse du secrétaire du PCF, Fabien Roussel, défendant avec vivacité la nécessité du bien-être au travail ?! La gauche est unie dans cette défense et considère, à l’instar de François Ruffin, que le « mal-travail » [1] (cadences, charges physiques, stress, accidents, etc.) est un fléau qui empêche l’épanouissement au travail et qui pourrait se résoudre en « faisant entrer la démocratie dans l’entreprise » et propose la « participation pour un tiers des salarié-es dans les conseils d’administration ». Ce sont, à mon avis, de vieilles lunes que la gauche institutionnelle répète depuis des décennies sans, bien sûr, que le patronat y accède ou bien de manière tronquée : les conseils d’atelier à l’époque des lois Auroux de 1983 ou la participation de quelques élus syndicaux sans aucun pouvoir dans les conseils d’administration noyés au milieu des techniciens, cadres et agents patronaux (cf. l’exemple de la Régie Renault de 1945 à 1992) ont montré l’inanité de ces propositions. Ces utopies largement irréalistes valorisent une valeur travail mythifiée : « une fierté du travail, une volonté d’accomplir une mission avec des Français qui ont le cœur à l’ouvrage » déclare avec emphase François Ruffin. C’est faire peu de cas de la réalité du travail en système capitaliste, où l’individu est broyé par un système qui lui est étranger. Certes, des travailleurs et travailleuses peuvent s’épanouir dans leur travail même avec des conditions difficiles. Mais pour l’immense majorité, le travail est une nécessité économique et pas davantage. Le texte qui suit ne développe pas les quelques lignes qui précèdent mais montre que pour échapper au travail parcellisé, souvent imbécile, et qui empêche toute initiative, des contournements sont possibles, à l’exemple de la perruque qui permet à des travailleurs et des travailleuses, le plus souvent qualifié∙es (mais pas seulement) de retrouver un processus créatif. La créativité est une nécessité humaine, tant pour le chercheur qui travaille sur l’intelligence artificielle que pour l’artiste dans son atelier ou, plus prosaïquement, l’ouvrier ou l’ouvrière qui perruque pour s’abstraire d’un travail répétitif ou bien encore, plus simplement, la ménagère fière d’avoir réussi un clafoutis pour sa famille !
Il est clair que la perruque est condamnée par le patronat, strictement interdite dans les règlements et, c’est là son ambiguïté, parfois (souvent ?) tolérée. Toute recension exhaustive de ce phénomène est, par nature, impossible pour une pratique cachée ; nous donnions en 2018 [2] des exemples de sanctions allant jusqu’au licenciement ; quant au patronat, il ne souhaite pas mettre en valeur une pratique qu’il réprouve mais ne peut empêcher. Les syndicalistes, globalement, restent muets sur un usage qui, pour la plupart d’entre eux et elles, relève de l’individualisme et met en danger les militants et militantes. Dans des périodes spécifiques, ils/elles la dénonçaient comme facteur de désorganisation de la production.
![Le trusquin perruqué de Louisa Boumrar. (Coll. Robert Kosmann]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust1-Kosmann-Perruque-Le-retour-768x1024.webp)
Quelques auteurs ou ouvriers appréhendent essentiellement la perruque comme une forme de bricolage. D’autres auteurs, sociologues pour la plupart, envisagent l’ensemble des résistances au travail, y compris la perruque, comme un élément parmi d’autres de contournement des règles. D’autres encore ont insisté sur l’ambiguïté de la perruque, tacitement tolérée et qui ne serait pas dysfonctionnelle pour l’entreprise capitaliste. De nombreux observateurs mal informés, souvent journalistes, confondent perruque et travail au noir rémunéré. Des chercheurs, plus bienveillants, assimilent la perruque à un travail d’artiste ou la limitent à une démonstration de l’excellence professionnelle. Il s’agit, ici, de montrer que la perruque n’est pas, pour l’immense majorité des cas, une activité marchande malgré l’air du temps, qu’elle se différencie dans l’esprit des perruqueurs et perruqueuses d’une pratique rémunérée, qu’elle demeure toujours présente dans les ateliers et les bureaux en 2024. Les exemples de perruques inédites qui suivent en sont témoin.
Perruque chez Renault
L’ancienne usine Renault à Billancourt a vu défiler un million d’ouvriers et ouvrières en un siècle (1898-1992) ; au plus fort de son développement il y avait plus de 40 000 salarié∙es sur le même site des Hauts-de-Seine. Il existait, comme dans toutes les grandes entreprises, une école professionnelle. Celle de Renault Billancourt, créée en 1919, forma pendant 67 années les ouvriers de Billancourt ; les ouvriers seulement : l’école ne fut pas ouverte aux ouvrières, nombreuses, qui y travaillaient, à l’exception d’une courte période. En 1975, à l’occasion de « l’année internationale de la femme [3] » la direction de Renault ouvrit, avec difficulté, l’accès à un stage de formation d’ajusteur aux femmes, une initiative qui ne se renouvela pas. Après un stage de huit mois à Billancourt, Louisa Boumrar, employée au départ comme dactylo, obtint un Certificat de formation professionnelle pour adultes dans cette spécialité ; deux femmes seulement participaient à ce stage et sortirent premières de leur promotion. Après quelques difficultés dues à l’ambiance patriarcale de l’atelier, la jeune ajusteuse fut intégrée, elle se fabriqua un « trépied pour un sapin » à l’occasion des fêtes de Noël et, à l’occasion de son mariage, on lui offrit un trusquin perruqué dont elle était toujours fière en 2022. Louisa n’était pas un cas isolé. L’historien Paul Boulland, codirecteur du dictionnaire Maitron, a montré [4] qu’une partie des embauchés de Billancourt y étaient pour des raisons de militantisme. C’est notamment le parcours d’Henri Benoits, dessinateur à l’usine, militant d’extrême gauche et soutien des militant∙es algériens pendant la guerre d’Algérie [5]. Très occupé par ses activités militantes, il utilisait toutefois sa planche à dessin à des fins personnelles puisque c’est sur place, avec les conseils d’un architecte, qu’il dessina entièrement en perruque les plans de son appartement.
Perruque en milieu militaire
L’industrie militaire n’est pas en dehors de cette pratique ouvrière. En 1856 déjà, son sens a été donné. Perruque désignait à l’époque, en argot d’artisan, le travail qu’un ouvrier exécute pour soi pendant son temps de présence à l’atelier, souvent même avec des matériaux détournés. Il s’agissait donc aussi d’un outil « fait en perruque » comme ce fut le cas pour les ouvriers d’arsenaux, du bâtiment. [6] ». Les deux définitions de la perruque dans le dictionnaire d’argot et dans le Larousse de 1966 font état de travailleurs des arsenaux, puis de l’Etat. Il est probable que, déjà en 1856, les ouvriers d’État, même s’ils n’avaient pas la convention des ouvriers à statut que nous connaissons aujourd’hui, avaient des conditions de travail moins pénibles que dans les entreprises privées, malgré la longueur des journées effectuées. Nous verrons plus loin que, déjà sous l’Ancien régime, les travailleurs des arsenaux bénéficiaient de conditions qui leur permettaient de perruquer largement. On connaît une inscription modeste sur un petit pavillon berrichon, dans le Cher, fabriquée, pour sa famille, avec des moyens modernes, à la découpe plasma, en 1984, par un ouvrier des ateliers de fabrication des chars GIAT AMX à Satory (78). Le contenu, populaire et souriant, nous éloigne de la technologie militariste. Il réalisa également, dans les mêmes conditions, une « servante de cheminée » pour nettoyer le foyer de chauffage de la maison.
Plus récemment, en septembre 2019, chez Safran Aircraft Engine, à l’usine de Gennevilliers (93) qui construit des moteurs pour l’aviation civile et militaire, à l’occasion d’un départ en retraite, les salarié∙es du service de l’ingénieur matériaux lui offrirent une perruque originale. Ils créèrent, avec des éléments d’une aube de turbine haute pression du moteur de l’avion Rafale, avec comme base d’un engrenage, une fleur élégante, comme cadeau dans un service où on avait davantage l’habitude, pour certains, de se féliciter de la vente et de l’utilisation d’un avion de combat !
![Perruque en milieu militaire, « Le pas pressé ». [Coll. R.K.]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust2-Kosmann-Perruque-Le-retour.webp)
Dans les arsenaux, la perruque a toujours droit de cité, en 2021. Ainsi, à Ruelle-sur-Touvre chez Naval Group près d’Angoulême, on nous a fait état d’un carrosse à chevaux créé pour un défilé costumé. A l’arsenal de Brest, bien que les syndicalistes CFDT et CGT nous aient affirmé que la perruque était interdite par les règlements, dans les ateliers la pratique se maintenait. Lors d’un débat à la librairie Dialogues autour de mon livre sur la question, de nombreux anciens des arsenaux ont présenté leurs perruques. L’un d’entre eux était un ancien chaudronnier, perruqueur confirmé et auteur d’un mémoire d’ethnologie sur l’arsenal nous confiait une anecdote étonnante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’arsenal était occupé par la Kriegsmarine. Pourtant, la perruque y battait son plein. Devant notre étonnement, il expliquait que les marins allemands, peu motivés pour aller combattre en mer Noire sur le front de l’Est, « trouvaient le climat de Brest agréable ! », n’étaient pas pressés de voir leurs bateaux de combat réparés et toléraient la pratique perruquière qui retardait leur départ pour des contrées plus dangereuses.
![Perruque militaire, version Safran Aircraft Engine. [Coll. R.K.]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust3-Kosmann-Perruque-Le-retour-768x1024.webp)
Cette anecdote, intéressante en soi, ne peut être généralisée et des perruqueurs furent bien-sûr victimes de l’occupation nazie. Ainsi, chez Berliet, pendant l’occupation, des perruqueurs fabriquèrent des armes pour la Résistance. Un garde découvrit une feuille crayonnée représentant le croquis d’une grenade. Convoqué par le chef du personnel, l’ouvrier Roger Minet se justifia en disant « je voulais faire de la perruque, mais juste un briquet de bureau ». Le chef lui précisa « vous savez que c’est un motif de licenciement ? Roger Minet ne traîna pas, quitta l’usine et rejoignit un groupe armé clandestin. La Gestapo viendra le chercher le lendemain, sans le trouver. Un autre incident se terminera plus tragiquement. Un garde surprit un ouvrier dénommé Laval alors qu’il affûtait une vieille lame de scie en vue d’en faire un poignard ; convoqué à la direction, il expliqua qu’il voulait faire une serpette pour couper de l’herbe pour ses lapins. Moins méfiant, l’ouvrier resta à l’usine, convoqué par la gestapo, arrêté, après interrogatoire il fut déporté à Buchenwald [7].
Perruque de menuisiers
La perruque continue à être pratiquée dans la plupart des métiers [8]. Les menuisiers, bien sûr, avaient des facilités à pratiquer cet art. On connaît celle d’Alexandre Le Tréhondat qui la pratiqua de manière intensive entre 1947 et 1982 aux ateliers de la SNCF de Clichy, puis à ceux de La Folie, à Nanterre. Ouvrier très qualifié, il avait suivi l’école Boulle au début des années 1930. Sa fille vit encore au milieu de ces objets dans son appartement. Prolixe, il a fabriqué une grande partie de son mobilier d’intérieur : tables, commodes, consoles, tabourets, jeux (damiers, échiquiers, boîtes de jeux divers), couverts de cuisine en bois, mobilier de cuisine [9].
Récemment, un mini-scandale relevé par la Cour des comptes mit en cause les menuisiers du Mobilier national. Le Canard enchainé du 6 février 2019 dénonçait un rapport à charge de l’organisme de contrôle. Un encadré du rapport y dénonçait la perruque « théoriquement encadrée » et « limitée à la non-utilisation des machines du service et l’obligation d’effectuer ces perruques après le temps de travail prescrit ». Le rapport se plaint d’un « agent menuisier retraité continuant à accaparer l’ensemble du parc machine pour réaliser des cuisines en aggloméré » [10]. Le journal satirique, suivi par Le Monde du 21 février 2019, reprit l’information et le Canard, peu au fait des différences essentielles entre la perruque et le travail au noir, publia une caricature sur le sujet. Le Monde, qui fit en même temps un reportage sur la Manufacture des Gobelins, rappela que la perruque était une tradition dans les métiers d’art.
![Dessin paru dans Le Canard enchainé à propos du Mobilier national. [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust6-Kosmann-Perruque-Le-retour.webp)
Un formateur en menuiserie à Grenoble a fabriqué, en juin 2021, dans le cadre d’une école (Institut des métiers techniques) une pendule commémorative de la chanson Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, lui-même ancien communard, dédiée en 1882 à une ambulancière de la Commune de Paris de 1871. La pièce, fabriquée à l’atelier bois avec une commande numérique, présente un cerisier imaginaire portant des fruits rouges, de la couleur des aiguilles de la pendule. Le travail est issu d’un logiciel de dessin et fabriqué ensuite sur une fraiseuse à commande numérique de type AB-CAM. Le temps requis pour la conception et l’usinage fut de l’ordre de dix heures de travail. Le même perruqueur, plus récemment, en juin 2024, profitant des tolérances qui existent dans l’industrie des métiers techniques où la perruque est considérée comme un art, réalisait une rose en bois (médium de 8mm) pour l’anniversaire d’une amie. Comme la précédente perruque, le graphisme et la réalisation furent effectués, sur une commande numérique, le bois teinté dans la masse et certaines parties utilisèrent des protections de bas de porte en PVC de 2 mm. La pièce finie fut confiée aux peintres en carrosserie de l’école pour le vernis.
Aujourd’hui
Il ne s’agit là que de quelques exemples parmi des sources très nombreuses regroupant non seulement les métiers manuels (métallos, cheminot∙es, postier∙es, verriers, travailleurs et travailleuses de l’aéronautique), mais aussi les métiers de technicien∙nes et, désormais, les emplois de bureau. L’ordinateur, malgré les contrôles et les mouchards électroniques, permet un travail personnel, une « flânerie salariale » qui va du courrier électronique personnel aux jeux en réseau et, pour des technicien∙nes, créateurs et créatrices de logiciels, la possibilité d’en réaliser pour leur propre usage (comptabilité familiale ou création de jeux pour leurs enfants).
Dans Sorti d’usines, nous développions des exemples de licenciements de perruqueurs et, en même temps, de laisser-faire de la part de la maîtrise dans certains ateliers. La tolérance existe sans qu’on puisse la chiffrer. Les syndicats condamnent l’activité comme une pratique individualiste qui détourne de la grève, même si beaucoup de syndicalistes la pratiquent selon leurs propres témoignages. Son histoire est très ancienne et elle se développe très largement à partir du salariat. Son aspect international est attesté, y compris dans l’atelier du monde qu’est devenue la Chine. La perruque traverse les différences hommes/femmes, elle est pratiquée largement, sans contrainte de genre. Nous évoquions le point de vue des sociologues, ethnologues qui s’y sont intéressés. Quelques auteurs ou ouvriers l’appréhendent essentiellement comme une sorte de bricolage. Les historiens du mouvement ouvrier quittant la seule approche par les grèves, les organisations et leurs dirigeant∙es, ont intégré la perruque comme un constituant de l’identité ouvrière. Xavier Vigna fait partie des historiens qui ont pris en considération cette pratique [11].
![Boite de jeux réalisé par Alexandre Le Tréhondat. [Coll. M. LT-E]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust5-Kosmann-Perruque-Le-retour-768x1024.webp)
![Damier perruqué par Alexandre Le Tréhondat. [Coll. Michèle Le Tréhondat-Edaine]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust4-Kosmann-Perruque-Le-retour.webp)
Un autre historien, Gérard Noiriel, considère que ce type de coutumes de travail subit un affaiblissement progressif. Dans un ouvrage de référence il attestait de cette pratique répandue à Villerupt en Lorraine [12]. Dans un ouvrage ultérieur, il revint sur la perruque en développant un point de vue différent ; il envisageait « l’affaiblissement progressif des coutumes d’atelier » pour des raisons multiples qu’on peut entendre « mais surtout l’automatisation remet très souvent en cause les anciennes formes d’autonomie ouvrière ». [13] Nous ne partageons pas ce point de vue, les exemples donnés en sont une illustration. La perruque n’est probablement pas en voie d’extinction, elle n’est pas seulement du bricolage pratique pour la maison et son statut ambigu dans l’entreprise amène certains encadrants à la tolérer mais cela n’inclut pas forcément une collaboration de classe travailleurs/management. Il faut vivre ensemble, tant du côté de la maîtrise que des salarié·es pendant huit heures par jour durant des années. Cela inclut des compromis inévitables, souvent en retour d’un travail bien fait, mais cela n’empêche pas, toute notre expérience et nos entretiens le confirment, une participation aux résistances d’un autre niveau quand il s’agit de grèves et de manifestations contre l’ordre usinier. Nous renvoyons pour un point de vue développé sur ces questions à notre ouvrage, Sorti d’usines [14].
Modernité
La perruque est un objet modeste, mais c’est tout de même un fait social par l’étendue de sa pratique, en particulier dans la classe ouvrière, y compris de nos jours dans les bureaux. En tant que syndicaliste retraité mais encore en activité, mes contacts m’indiquent que la perruque à l’usine est loin d’avoir disparu ; l’automatisation n’y change rien ou pas grand-chose. L’apparition des ordinateurs, pour les ouvriers, les employés, les bureaux open space facilitent la surveillance. L’externalisation d’un grand nombre d’opérations en une myriade de sous-traitants qui ne permet plus d’avoir la matière première et les machines liées aux nombreux métiers que mobilisaient les perruqueurs et surtout la rationalisation et l’intensification du travail, rognent le temps dégagé dont disposaient les ouvrier∙es jadis. Tous ces phénomènes existent et sont un frein au travail détourné. Mais une des caractéristiques de la perruque est la quasi-impossibilité de la quantifier. On ne pourra jamais connaître l’état de la perruque au XIXe ou au début du XXe siècle et la comparer de manière rigoureuse avec ce qui existe en 2024. On peut certes imaginer qu’elle est en diminution, mais cela relève de l’intuition, de l’hypothèse envisageable. La notion de « déclin » est une notion temporelle, elle implique une rupture ; or le référent à une continuité de la perruque ne peut exister face à une pratique qui n’est ni mesurée, ni mesurable. Son actualité est même présente dans les publicités qui passent de nos jours sur les écrans de télévision. Un appel aux dons pour l’association catholique des Apprentis d’Auteuil, tournée en juillet 2018 et diffusée souvent depuis cette date, montre un jeune apprenti en formation de CAP menuiserie qui fabrique très consciencieusement une pièce de jeu d’échecs (le Roi) pour offrir à son partenaire âgé.
![Pendule en perruque. [Coll. R.K.]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust7-Kosmann-Perruque-Le-retour.webp)
![Détail de la pendule. [Coll. R.K.]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust7bis-Kosmann-Perruque-Le-retour.webp)
Dans un ouvrage paru en 2021, la journaliste Léa Salamé a publié les interviews de Femmes puissantes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, y figure et semble très fière de montrer, dans son bureau de l’Hôtel de ville, une perruque offerte : un cendrier polylobé auquel elle a contribué lorsqu’elle était étudiante inspectrice du travail. Elle visitait alors l’usine de fabrication de bouteilles de Veauche en Auvergne, les verriers sortirent une pièce du four pour lui offrir : « Je revois les ouvriers sortant cette terre en fusion du four, tordant les bords pour en faire un cendrier, puis me donnant un gros marqueur pour réaliser les motifs et les petits dessins. » [15].
Edition et bande dessinée
L’édition s’est peu emparée de la perruque. Toutefois, les élèves de Bac pro, depuis 2011, ont à leur disposition un manuel d’histoire-géographie qui évoque la perruque sous le titre « Un travail détourné : “ la perruque ” [16]. » La bande dessinée y fait référence. Le bédéaste Baru s’autobiographie en 2020, il met en scène le personnage de son père qui fabrique une sorte d’emporte-pièces, machine à couper et former les pâtes alimentaires : « Mon père a bricolé ce truc à l’usine, c’est un alliage de je ne sais pas trop quoi, on dirait du bronze ». Il remercie son père pour sa trouvaille et termine sa vignette de page en s’esclaffant « le génie du prolétaire ! » [17]. Plus développée, une BD de Baptiste Deyrail, Le pas de la Manu, parue en 2020 chez Actes Sud traite sur 230 pages de la perruque à Saint Etienne, au sein de l’ex manufacture d’armes de la ville. Dans une veine plus caricaturale, le personnage de Gaston Lagaffe du Journal de Spirou, relancé en mars 2022 au festival de la BD d’Angoulême, avait pour principale tâche de trier le courrier des lecteurs et lectrices, urgent ou en retard, ce qu’il détestait faire. Il devient en dehors de ses gaffes un inventeur astucieux qui conçoit de multiples objets et procédés, destinés principalement à faciliter son travail au bureau. Ce n’est pas un fainéant sans qualité, c’est plutôt un perruqueur original qui pratique une forme maladroite et inventive de résistance au travail de bureau, monotone et ennuyeux.
Conclusion
Nous considérons la perruque comme une activité essentielle dans un processus de créativité humaine qui se traduit pour tout un chacun de manière différente. Nous donnions en exemple en 2018 une perruque d’exception : l’ouvrier d’Air France capable de mettre dix années pour construire un petit avion monomoteur en perruque ! Un autre, à la RATP, utilisait les ateliers pour changer ses plaquettes de freins. Il n’existe pas selon nous de hiérarchie en termes de perruque ni de créativité. L’artiste prend un plaisir intense à peindre une toile ou bien à créer une sculpture, une œuvre plastique. La ménagère peut être fière comme nous l’annoncions en introduction de réussir un kouglof ou un clafoutis pour le dîner du dimanche où elle reçoit sa famille. Le besoin de créer est probablement inhérent à la totalité des individus.
![Rose en bois. [Coll. R.K.]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2025/10/13-Illust8-Kosmann-Perruque-Le-retour.webp)
La perruque ouvrière est une de ces composantes créatives, réappropriation d’un savoir-faire ; affirmée comme l’expression d’une qualification professionnelle, elle se différencie, selon les témoignages des perruqueurs et perruqueuses, des autres formes de résistance et de transgressions mais se rattache à la notion d’insubordination ouvrière décrite par Xavier Vigna à propos des grèves de 1968. Cette résistance peut être ouverte et exprimée comme de nombreux exemples qui précèdent l’indiquent. Elle peut aussi avoir été intériorisée et enfouie ; mais la transgression du travail prescrit est objectivement ou subjectivement l’une des formes de la résistance au travail. La récupération, du temps, des matériaux, l’utilisation des outils et machines à son compte ne sont pas neutres dans l’esprit d’un perruqueur, même s’il n’est pas ouvertement révolté, et même si c’est simplement pour réparer son scooter. La perruque est la fierté et la réappropriation d’un savoir-faire, une résistance à la déqualification d’un travail. Nous réaffirmons qu’elle est une forme de résistance modeste à un travail prescrit, ennuyeux, parcellisé, en miettes. Elle est l’ordinaire d’une résistance souvent dissimulée mais opiniâtre et répandue.
⬛ Robert Kosmann.
[1] François Ruffin, Mal travail le choix des élites, éditions Les liens qui libèrent, 2024.
[2] Robert Kosmann, Sorti d’usines. La « perruque », un travail détourné, éditions Syllepse, 2018.
[3] Nom donné par l’ONU.
[4] www.maitron.org : Paul Boulland « Explorer le Maitron. Billancourt au fil du Maitron : un creuset de parcours militants ?
[5] Clara et Henri Benoist, L’Algérie au cœur. Révolutionnaires et anticolonialistes à Renault-Billancourt, éditions Syllepse, 2014.
[6] Dictionnaire Esnault, 1856.
[7] Marcel Peyrenet, Nous prendrons les usines, éditions Garance, 1980.
[8] Nous renvoyons pour une description plus complète à notre ouvrage Sorti d’usines. La « perruque », un travail détourné.
[9] Je remercie Michèle Le Trehondat-Edaine qui m’a fourni documentation et photographies.
[10] Cour des comptes, rapport public annuel 2019.
[11] Xavier Vigna, L’insubordination ouvrière dans les années 68, PUR, 2007 ; Histoire des ouvriers en France, éditions Perrin,2012 ; L’Espoir et l’effroi, éditions La Découverte, 2016.
[12] Gérard Noiriel, Longwy immigrés et prolétaires, PUF, 1984.
[13] Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la société française, éditions du Seuil 1986.
[14] Voir aussi le passage sur la perruque dans la série documentaire de Stan Neumann en quatre parties « Le temps des ouvriers », quatrième épisode.
[15] Léa Salamé, Femmes puissantes, éditions Les Arènes, France Inter, 2021.
[16] Hachette manuel, d’histoire-géographie, Première Bac pro, 2011.
[17] Baru, Bella Ciao, éditions Futuropolis, 2020.
- Quand l’économie de guerre sert les partisans de l’austérité, version brutale - 31 juillet 2025
- Une autre économie, pour une paix juste et durable - 30 juillet 2025
- Face à la déstabilisation du monde : opposer le visage de la solidarité - 29 juillet 2025