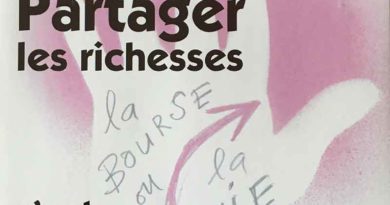L’ambition de 1945

« La priorité pour l’année à venir est de bâtir l’État-providence du 21ème siècle », tel est l’objectif que s’assigne le président E. Macron dans son discours au Congrès à Versailles le 9 juillet 2018. « Un État-providence émancipateur, universel, efficace, responsabilisant », précise-t-il, donnant ainsi à cette expression en vogue dès le tournant du siècle dans le monde de la recherche une résonance particulière puisqu’elle est portée au rang de priorité politique. Sous sa forme retentissante et un rien péremptoire, la formule est censée énoncer entre autres une adaptation de la Sécurité sociale aux défis économiques et sociaux du 21ème siècle. « 70 ans plus tard, nous pouvons [en] être fiers, mais nous devons aussi lucidement regarder en face nos échecs, nos insuffisances ou ce qu’il faut améliorer ». « L’intuition fondamentale qui a présidé au sortir de la Seconde Guerre mondiale à la création de notre Sécurité sociale », ajoute-t-il, est d’avoir pensé que « le progrès social passe aussi par un élan collectif pour assurer la dignité de chacun, c’est cela la solidarité nationale ».

Le président s’inscrit ainsi dans la longue liste d’hommes et de femmes politiques qui ont inlassablement proclamé leur adhésion aux principes de 1945, tout en réaffirmant leur volonté d’œuvrer à leur adaptation pour pérenniser l’institution. Mais force est de constater qu’à la place d’un plan structurel de réforme porté par une vision d’ensemble, nous avons connu une multitude d’interventions qui tendent de fait à réorienter le système. A l’indispensable analyse des « insuffisances » et des « échecs », s’est souvent substituée une dénonciation qui se prévaut du « bon sens ». Archaïque, inadapté aux défis-du-monde-contemporain, cet Etat social serait économiquement un frein à la croissance. On lui impute, en outre, un déclin du sens de la responsabilité individuelle. Il serait temps de lui substituer une organisation plus dynamique, mettant en œuvre des schémas technico-économiques « modernes », efficaces, adaptés à notre temps, c’est-à-dire conformes aux impérieuses lois économiques de la mondialisation. Or les questions que se posent les réformateurs de l’époque sont très différentes. Elles portent une volonté politique commune d’agir rationnellement sur la société en vue de la rendre plus juste et plus égalitaire. La conviction profonde qui les guide au vu de l’histoire passée est qu’il n’est pas de liberté sans sécurité ni d’égalité sans solidarité.
PAS DE LIBERTÉ SANS SÉCURITÉ
« L’aspiration à la sécurité sociale n’est qu’un aspect de l’aspiration des hommes à la sécurité en général », écrivait Pierre Laroque en 1953 [1]. Cette question de la sécurité à laquelle s’emploie à répondre la création de l’institution Sécurité sociale en 1945 est, en effet, bien antérieure à cette période. Les promesses de la Révolution française la rendent d’autant plus criante. La liberté individuelle proclamée en 1789 s’était révélée très rapidement un leurre pour une très large part de la population que l’exploitation industrielle maintenait aux marges de la survie, dans une situation d’infériorité sociale voire d’assujettissement.
La réalité socio-économique du 19ème siècle se caractérise par une insécurité générale du monde du travail. La situation d’extrême misère et d’exploitation dont il est victime invalide de fait cette « liberté libérale » proclamée par l’article Premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et conçue comme un droit naturel, un attribut de l’homme : « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Cette question sociale – selon l’expression consacrée – traverse tout le siècle. Le paupérisme massif et l’explosion des inégalités invalident la promesse de liberté et d’égalité civile. Ils rendent patent l’échec du projet d’auto-organisation porté par la philosophie libérale. Ils donnent à voir le caractère inopérant du « rêve libéral » en tant que conception du vivre-ensemble qui de fait perpétue, aggrave même infériorité sociale et oppression.
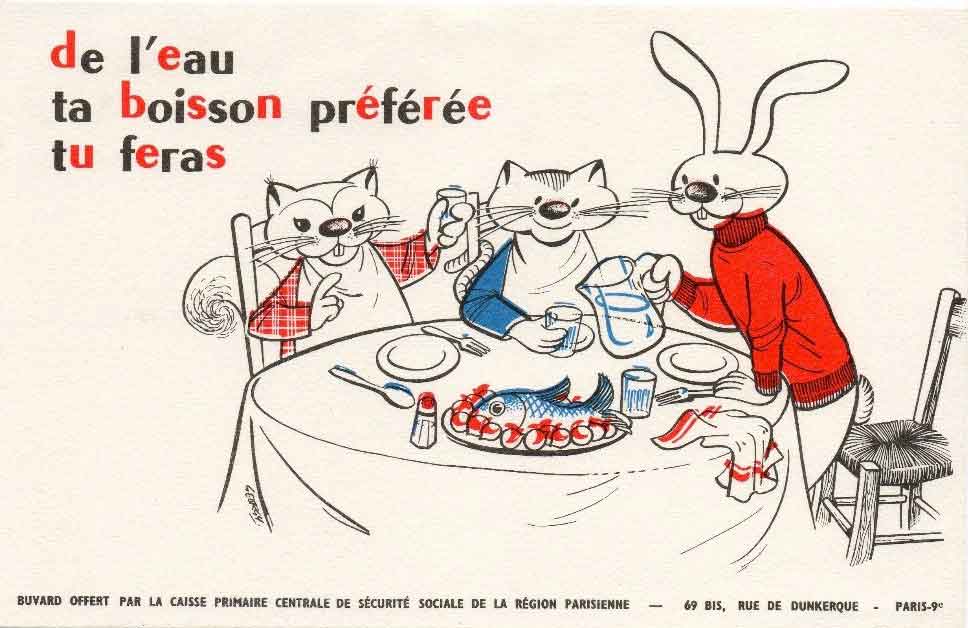
Non combattue politiquement, l’insécurité dans ses différentes expressions économiques et sociales a toujours été une source majeure de maux sociaux contre lesquels seuls pouvaient se prémunir ceux qui étaient propriétaires. Certes les ouvriers ont acquis « la propriété de leurs bras » mais cette propriété n’est pas de même nature que celle du capital car le travail « n’existe comme propriété qu’au moment même où son possesseur a la possibilité de l’aliéner. Si, donc, en un sens, le travail est la plus idéale des propriétés, on peut affirmer qu’il n’est pas la propriété idéale [2]». La sécurité apparaît alors comme un véritable privilège qui traduit les contradictions inhérentes à la démocratie. C’est bien à ce paradoxe fondamental que Jean Jaurès fait référence en déclarant : « Vous avez fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de rois, mais au moment où le salarié est souverain dans l’ordre politique, il est dans l’ordre économique réduit au servage [3]».
La justice sociale n’est pas inhérente à la démocratie, voilà la grande leçon de ce 19ème siècle. S’impose ainsi peu à peu l’idée d’une nécessaire redéfinition des notions de liberté et d’égalité qui sont dès lors perçues comme fondamentalement tributaires d’une situation de sécurité. De là découle une transformation de la conception de l’État auquel on s’emploie à attribuer désormais un rôle constitutif dans la construction de la société démocratique. Jules Ferry résume parfaitement ce que sera le projet des républicains à partir des années 1880 : « la première dette de l’Etat vis-à-vis de la classe laborieuse, c’est la liberté [4]» et, doit-on ajouter, une liberté qui ne soit plus un chemin vers la servitude mais vers l’émancipation.
Toutes les grandes lois de cette époque ont cet objectif. En éduquant (lois scolaires 1880-1882), en soignant (Assistance Médicale Gratuite 15 juillet1893), en aidant (enfants assistés 27 juin 1904 et Assistance aux vieillards, infirmes et incurables (14 juillet1905), il s’agit de rendre les individus capables d’assumer leur responsabilité et ainsi d’organiser politiquement une communauté de citoyens libres. L’ensemble de ces lois et bien d’autres (loi sur le syndicalisme 1884… bien sûr) traduisent une société qui n’est plus perçue comme un agrégat d’individus mais comme une chaîne d’interdépendances : une solidarité de fait qui doit être juridiquement, institutionnellement, financièrement organisée en une solidarité consciente et corrélée à l’égalité. La solidarité, cette « théorie d’ensemble des droits et des devoirs de l’homme dans la société [5]» sera le principe fondateur des politiques sociales, politiques de protection et donc d’émancipation, qui vont être élaborées. Si les bases de l’État social sont posées au tournant du 20ème siècle, c’est dans l’entre-deux-guerres que la légitimité de l’intervention de l’État est pleinement reconnue. La question afférente à la protection sociale et à l’intégration du monde ouvrier connaît une acuité particulière. Deux exemples très significatifs. La loi d’Assurances sociales (30 avril 1930), embryon d’un véritable système de protection (maladie, maternité, invalidité, vieillesse), pose pour la première fois le principe d’obligation d’affiliation pour les salariés rémunérés en-dessous d’un certain seuil. Dans le même temps se multiplient au sein du Conseil national économique des travaux et débats sur les moyens de redéfinir les rapports entre employeurs et employés, sur les modes d’intégration du syndicalisme dans des structures de décisions [6]. Le syndicalisme doit devenir un instrument de pacification et de transformation sociale.
PAS D’ÉGALITÉ SANS SOLIDARITÉ
Ce qui va se jouer à la Libération, tout en relevant de la même philosophie, est beaucoup plus ambitieux puisqu’il ne s’agit plus seulement de protéger les catégories les plus vulnérables du monde du travail mais de solidariser la société dans son ensemble pour la rendre plus juste et plus égalitaire. Il ne s’agit pas seulement, commente Pierre Laroque, de « garantir à chacun un droit à la vie, un minimum d’existence, mais aussi [de] réaliser un équilibre satisfaisant des situations, non pas seulement [d’] éliminer les injustices les plus criantes, mais aussi [de] se rapprocher de la justice sociale [7]». C’est d’ouvrir un « nouveau cours démocratique » dont il est question, un cours dans lequel la solution des questions sociales relèverait d’une maîtrise des logiques collectives. La Sécurité sociale, expression de la volonté politique des grandes familles politiques qui ont résisté au nazisme (gaullistes, chrétiens sociaux du MRP, socialistes et communistes), s’inscrit dans ce projet de concevoir et d’organiser rationnellement la société. La Sécurité sociale est pensée comme une « institution de la démocratie [8]», une institution indissociablement émancipatrice et solidaire. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.
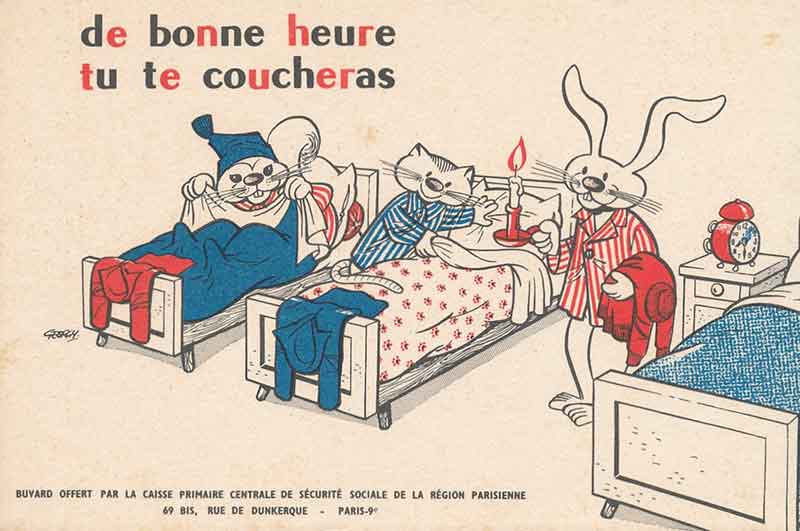
A côté du droit du travail qui se développe simultanément, la Sécurité sociale doit répondre « à la préoccupation fondamentale de débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain, de cette hantise du lendemain qui crée chez eux un constant complexe d’infériorité, qui arrête leurs possibilités d’expansion et qui crée la distinction injustifiable des classes entre les possédants, qui sont sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir, et les non-possédants, constamment sous la menace de la misère » [9]. Agir sur les déséquilibres de pouvoir consubstantiels aux relations professionnelles en réduisant l’arbitraire patronal, agir contre les risques liés à la maladie ou à la vieillesse procèdent d’une même visée politique. Il s’agit de créer les conditions d’une sécurité individuelle et collective elle-même condition de la paix sociale. « L’État aux mains des adversaires était une Bastille ; aujourd’hui aux mains des démocrates, il est un poste de commandement [10]».
L’instrument privilégié de cet État social qui vise à préserver les rapports sociaux de la violence inhérente aux relations spontanées en remplaçant les rapports de force par des rapports de droit est le droit social. À l’autorégulation des rapports sociaux toujours défavorables aux plus faibles et confortant le pouvoir des plus forts, se substitue un droit « orienté vers la résolution des antagonismes sociaux » et qui « cherche la paix par la justice [11]». Mais la réussite d’une telle entreprise n’est assurée que « si, non seulement dans les textes mais aussi dans les mœurs, ces relations cessent d’être des relations de force [12]». La force et l’effectivité des rapports de droit ne peuvent être effectives en dehors de la reconnaissance par le citoyen de leur pleine légitimité. D’où le rôle premier, central, assigné à l’éducation. Sans une lutte parallèle contre la méconnaissance et l’ignorance en vue de transformer les représentations, le droit n’apparaîtra que comme coercition et sera impuissant à transformer la réalité. C’est à cette fin que Pierre Laroque veut attribuer une fonction majeure aux syndicats dans la gestion des caisses : « Donner aux bénéficiaires eux-mêmes la responsabilité des institutions destinées à garantir cette sécurité en créant chez eux un sens conscient de leur solidarité collective. [13]» C’est grâce à une démocratie sociale soutenue par un plan « d’éducation à la solidarité » que peut se construire, se réaliser l’adhésion consciente aux principes fondateurs, condition indispensable à la viabilité du projet. En l’absence d’une conscience des responsabilités et des devoirs corollaires des droits cette institution risque de développer chez ses bénéficiaires, des logiques individualistes contraires au projet lui-même.
Les qualificatifs manquent pour désigner l’impact réel sur la société de ce que l’on a appelé « l’effort social de la Nation [14]». L’amorce assez rapide de transformations sensibles dans plusieurs secteurs atténue profondément l’incertitude du lendemain. Le sentiment d’insécurité régresse notablement pour de larges composantes de la population. La maladie, la vieillesse ne sont plus synonymes de misère. Le redressement spectaculaire de la démographie, l’augmentation de l’espérance de vie, la chute significative de la mortalité infantile (de 108 à 37 décès pour 1000 naissances entre 1945 et 1954), l’impact sur la situation des familles des prestations familiales qui cessent d’être un élément du salaire, l’accès de la population aux progrès majeurs de la recherche médicale, antibiotiques par exemple… ne sont que les éléments les plus marquants de ces transformations.
Pourtant les problèmes apparus lors de la mise en œuvre des principes ne seront jamais clairement affrontés politiquement. C’est le cas de ce que j’ai appelé l’ambiguïté fondatrice de 1945. Ce dilemme originel – couverture universelle ou catégorielle – est au cœur du glissement opéré entre ce que prévoyait le texte matriciel du Conseil national de la Résistance – Les jours heureux – (15 mars 1944) et la fameuse ordonnance du 4 octobre 1945. Le « plan complet de sécurité sociale » visait « à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ». L’ordonnance fondatrice du 4 octobre 1945 posait qu’ « il est institué une organisation de la Sécurité sociale, destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maladie ou de maternité qu’ils supportent ». D’où une série de questions sans réponse claire : la sécurité est-elle un droit de l’homme ou un droit du travailleur ? Quel type de solidarité ? Nationale dans le premier cas, catégorielle dans le second. Quel mode de financement ?… Aussi l’ambition du CNR de couvrir l’ensemble de la population se réalisera-t-elle mais avec un pragmatisme sans boussole. La porte est alors ouverte, et ce jusqu’à aujourd’hui, à de multiples conflits d’intérêts entre groupes professionnels qui aboutiront à des modes de protection profondément inégalitaires tant au niveau des prestations que de l’effort contributif ; à un recours massif aux minima et autres allocations comme réponse aux transformations du marché du travail qui débouchera sur une dualité de protection…
La question du déficit apparue assez vite fera l’objet de la même esquive d’un débat doctrinal.[15] D’abord traitée avec des « remèdes de fortune [16]», elle devient à partir des années 70 l’objet quasi-unique des débats, un véritable marronnier qui emblématise à elle seule le « problème » de la « Sécu », le fameux trou, et tend à en figer les termes dans un économisme toujours plus obstiné. Les politiques restrictives qui en découlent se sont accompagnées d’une série de modifications législatives, a priori de peu d’envergure pour certaines mais qui cependant convergent vers une même réorientation de l’institution et de la politique de protection. Par exemple, la place de plus en plus importante donnée à l’acteur privé et à l’autoprotection présentée comme vecteur de responsabilisation individuelle, sont deux tendances majeures de cette mutation. La pénétration de l’idéologie néolibérale dans ce secteur, la volonté de l’aligner « sur les règles de la partie économique [17]», se déploient d’autant plus facilement que le faible engagement en faveur de « l’éducation à la solidarité » n’a pas permis, malgré un attachement à la Sécu constamment réaffirmé par les Français, une véritable appropriation individuelle et collective de cette institution. Force est de constater qu’on est loin d’une institution Sécurité sociale vouée à la transformation sociale, au statut d’instituant « d’un ordre social nouveau » telle qu’elle était imaginée à la Libération. N’est-elle pas de plus en plus ravalée dans la représentation collective, au rang de simple organisme payeur, simple prestataire de services ? [18]
Cette crise de légitimité est la clé de de la remise en cause actuelle du socle doctrinal de 1945. Elle fait craindre la construction d’un système de protection différenciée, caractérisé par l’adjonction, à un socle commun de base, de niveaux où le cotisant « responsable » qui peut y accéder sera assuré d’un retour sur investissement. Un système de protection sociale à plusieurs étages, épousant et par là-même renforçant une fragmentation sociale toujours plus marquée. N’y a-t-il pas dans cette remise en cause de la solidarité un risque politique majeur, celui de renouer avec une « sécurité privilège » ? Pour penser un État « émancipateur, universel, efficace, responsabilisant » ne conviendrait-il pas de méditer au préalable la réponse que Pierre Laroque faisait à un interlocuteur qui s’inquiétait de ce que « deviendrait la liberté de l’homme dans une existence entièrement sécurisée » ? Certes, répondait-il, « la liberté ne se vit pas sans risques. Mais pour affronter les vrais risques, les risques nécessaires, il faut d’abord mettre fin à toutes les insécurités qui aliènent la liberté. [19] »
[1] Réflexions sur le problème social, Editions sociales françaises, 1953, p. 51.
[2] Eugène Fournière, L’idéalisme social, Editions Félix Alcan, 1910, p. 66.
[3] « La République et le socialisme : réponse à la déclaration du cabinet Charles Dupuy », Chambre des députés, 21 novembre 1893.
[4] Jules Ferry, Débats parlementaires, J.O., 1er février 1884, p. 248.
[5] Léon Bourgeois, Solidarité, Presses universitaires du Septentrion, 1998 [1896], p. 54.
[6] Un rapport très remarqué et longuement débattu, écrit par Pierre Laroque : Les conventions collectives de travail, CNE, session du 30 novembre 1934.
[7] « Préface », Succès et faiblesses de l’effort social français, S. Grévisse, N. Questiaux, M. Morisot, G. Guillaume, H. Roson, M. Gentot, P. Laroque, Editions Armand Colin 1961, p. 13
[8] La Sécurité sociale. Une institution de la démocratie, Colette Bec,EditionsGallimard, Paris, 2014.
[9] Discours prononcé le 23 mars 1945 à l’Ecole nationale d’organisation économique et sociale à l’occasion de l’inauguration de la section assurances sociales, Revue Française des Affaires Sociales, 2008/1, p. 153-163. Cette citation est reprise dans l’ordonnance du 4 octobre 1945. Il faut ajouter au nombre des « pères fondateurs », les noms de Georges Buisson rapporteur du texte à l’Assemblée consultative et Ambroise Croizat ministre de novembre 1945 à mai 1947.
[10]. « Existe-t-il deux conceptions de la démocratie ? », Georges Vedel, Études, janvier 1946, p. 28.
[11]. « Impérialisme du droit social ? », Jean, Rivero, Droit social, n° 12, décembre 1949, pp. 370-371.
[12] Les rapports entre patrons et ouvriers : leur évolution en France depuis le XVIIIème siècle, leur organisation contemporaine en France et à l’étranger, Pierre Laroque, Editions F. Aubier, 1938, p.403.
[13] « Le plan français de Sécurité sociale », Revue française du Travail, avril 1946.
[14] Succès et faiblesses de l’effort social français, S. Grévisse, N. Questiaux, M. Morisot, G. Guillaume, H. Roson, M. Gentot, P. Laroque, op. cit.
[15] Pour l’analyse de ces deux questions je renvoie à « La Sécurité sociale entre solidarité et marché », Colette Bec, Revue française de socio-économie, 1er semestre 2018, pp. 167-185.
[16] « Introduction », Jean- Jacques Dupeyroux, Droit social, n° 1, janvier 1968, p. 3.
[17] Le nouveau monde, Marcel Gauchet, Editions Gallimard, 2017, p. 458.
[18] Et pour l’Etat ne devient-elle pas une variable d’ajustement budgétaire depuis qu’il n’est plus tenu de compenser intégralement à la Sécurité sociale le coût des allègements de charge ?
[19] « Sous l’œil de son fondateur, la Sécurité sociale », Réforme, 28 nov. 1987.
- L’ambition de 1945 - 13 mai 2020