Ecologie et autogestion dans les années 1970 Discours croisés d’André Gorz et de Cornelius Castoriadis
Mai 68 est un choc culturel, l’événement ouvre une brèche dans la modernité organisée, sert de catalyseur à des idées souterraines de groupes antérieurs comme Socialisme ou Barbarie. En France, « une attitude hypercritique domine [les années 1970] où la théorie devait être une arme ». C’est la crise de la modernité organisée, la postmodernité jaillit, les identités collectives (classes, nations, etc.) qui structuraient la société sont mises en question, l’historicisme se meurt au profit d’une mise en sens spontanée du réel, hic et nunc, en dehors des grands récits.
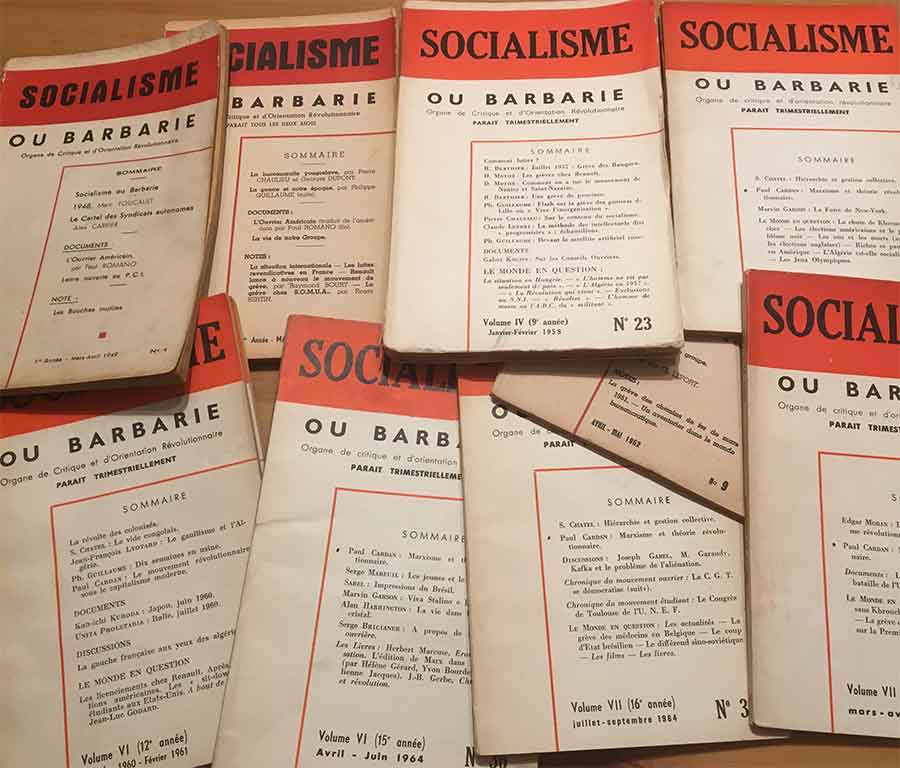
Le couple antitotalitarisme-autogestion émerge dans la continuité de la gauche non communiste qui se cherchait après-guerre. L’antitotalitarisme se nourrit des critiques des intellectuels contre le « socialisme réellement existant », de leur rupture avec les partis de gauche, en particulier le Parti communiste français (PCF), et de l’énonciation d’une démocratie radicale comme projet de transformation sociale. L’autogestion, nécessairement plurielle, possède un noyau commun, à savoir « la radicalité de l’ambition, qui se veut héritière du projet révolutionnaire de libération humaine ; le réalisme “pratique” de la démarche ; le refus de séparer les moyens et les fins, la “voie” et l’“issue” » [1]. Il s’agit d’une tentative de résolution de la dialectique moderne entre liberté et discipline par la victoire du premier terme.
Deux pensées singulières incarnent cette force nouvelle, ce courant hypercritique. André Gorz et Cornelius Castoriadis, même génération imprimée par la seconde guerre mondiale et le cycle de haute croissance qui l’a suivie, tous deux étrangers naturalisés Français, détenteurs d’une identité plurielle traduite par de multiples pseudonymes, l’un journaliste, l’autre économiste, deux marxistes, hétérodoxe pour l’un, repenti pour l’autre, ce sont deux penseurs antitotalitaires de l’autogestion [2] qui dialoguent avec les nouveaux mouvements sociaux, donnant ainsi un ancrage dans l’action à leurs discours, dans un rapport complexe entre l’idée et le réel.
Comment les discours politiques de Gorz et Castoriadis [3] participent-ils de la crise de la modernité organisée ?
Ils formulent d’abord une critique de l’hétéronomie-aliénation des sociétés modernes, sur la conviction qu’est politique tout ce qui concerne l’institution du social, c’est-à-dire la mise en forme de la coexistence humaine. C’est une critique artiste du capitalisme qui dénonce l’inauthenticité, l’étouffement de la créativité et de la liberté par la froide raison instrumentale [4], à laquelle répond la critique autogestionnaire.
LA CRITIQUE DE L’ALIÉNATION – LA VOLONTÉ DE PUISSANCE
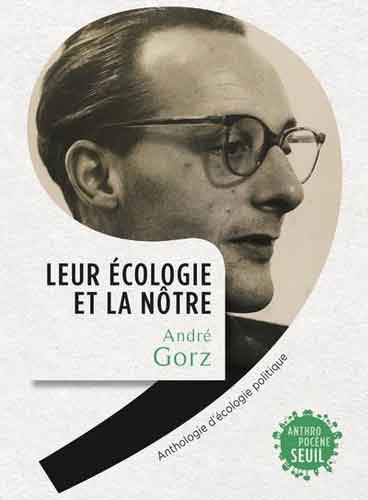
La critique se concentre sur l’essence prométhéenne de la modernité, qu’elle vienne de l’Est ou de l’Ouest. Le capitalisme est décrit comme un imaginaire actif qui transforme et bouleverse toutes les sphères de la vie sociale soumises à la logique de l’expansion illimitée de la production [5]. Y sont associés les mythes positivistes d’un sujet tout-puissant et d’un monde intégralement rationnel [6]. Mais pour Castoriadis, « cette maîtrise est une pseudo-maîtrise, et cette rationalité une pseudo-rationalité » [7]. Le communisme est lui qualifié de « catéchisme scientifico-religieux » qui sert de courroie de transmission dans le monde ouvrier au productivisme capitaliste [8], ou encore d’« idolâtrie du développement des forces productives » [9]. C’est tout le projet moderne reposant sur l’alliance de la science, de la technique et de l’économie qui est interrogé. La société technicienne qui impose sa rationalité et évacue la dimension politique des problèmes est récusée par André Gorz, engagé dans le mouvement antinucléaire : « Des choix de société n’ont cessé de nous être imposés par le biais de choix techniques. » [10]
L’économie-discipline est accusée de séparer artificiellement les fins des moyens : « Toute l’idéologie de l’économie comme “logique du choix des moyens” est basée sur cette absurdité. » [11] Il faut donc abandonner la représentation de l’Homo oeconomicus, « rompre avec la rationalité économique » [12]. Gorz rejoint ici le père de la bioéconomie, l’économiste Nicholas Georgescu-Roegen, qui, à la lumière de la loi de l’entropie de Sadi Carnot [13], visa à réinsérer l’économie dans la biosphère [14]. L’économie orthodoxe est ainsi présentée comme une science inexacte aux fausses prévisions, un « édifice formel et vide » [15] qu’il faudrait « replonger […] dans le social-historique » [16], c’est-à-dire rendre ouvert aux incertitudes. Les lois de l’économie fondées sur le projet mythique de mathesis universalis tombent, la philosophie de l’histoire marxiste où règne la nécessité aussi [17].
LA HIÉRARCHIE

Pour Castoriadis, en plus de cette volonté de puissance, l’Est et l’Ouest partagent la bureaucratie, synonyme de hiérarchie [18]. Si le premier est un « capitalisme bureaucratique total », le second est un « capitalisme bureaucratique fragmenté » [19]. André Gorz surenchérit, établissant la continuité entre les deux formes par la technique : « Le socialisme n’est pas immunisé contre le techno-fascisme. » [20] Dans les deux cas il y a « destruction des capacités autonomes au profit de la division capitaliste du travail » [21]. Toute l’organisation sociale est traversée par ce principe, il y a donc « destruction de la société civile par l’État » qui prend en charge l’individu de l’école – accusée, dans une veine illichienne [22], de formater les individus – à l’usine [23]. Car « la fonction que la hiérarchie managériale assume à l’échelle de l’usine, l’État central l’assume à l’échelle de la société dans son ensemble » [24].
L’archétype de ces sociétés bureaucratiques, c’est le nucléaire qui cristallise toutes leurs propriétés. André Gorz ne manque pas de le dénoncer en parlant de « montée de l’électrofascisme » [25] caractérisée par le déficit démocratique, l’alliance avec les intérêts économiques, la puissance du lobby, l’opacité, la centralisation et la concentration [26]. Et de décrire l’autonomisation de la technique en ajoutant que « la société nucléarisée suppose la mise en place d’une caste de techniciens militarisés, obéissant, à la manière de la chevalerie médiévale, à son propre code et à sa propre hiérarchie interne, soustraite à la loi commune et investie de pouvoirs étendus de contrôle, de surveillance et de réglementation » [27].
Si la critique artiste est dominante dans les discours, elle est articulée à une critique sociale [28]. L’aspiration à la liberté va de pair avec le besoin de sécurité : « […] il y a aliénation de la société toutes classes confondues à ses institutions. » [29] Castoriadis donne une interprétation darwinienne de la bureaucratie, il constate qu’« un système hiérarchique est basé sur la concurrence des individus et la lutte de tous contre tous » [30].
LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
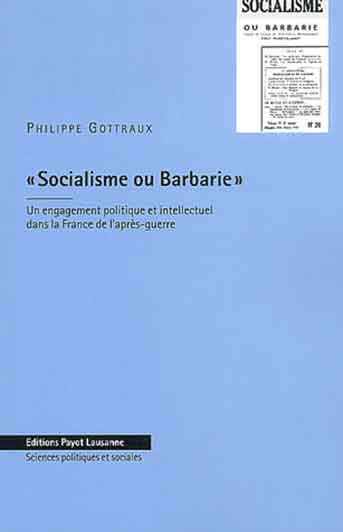
L’aliénation ne concerne pas que l’homme-producteur, le consommateur est atteint de façon plus insidieuse par l’inauthenticité. Castoriadis prend des accents tocquevilliens lorsqu’il dénonce « la privatisation des individus » [31], c’est-à-dire le repli sur l’existence individuelle, micro-familiale et les intérêts personnels, sans souci de la société autour. Il y a ainsi apathie des individus, destruction de l’espace public par cette « bureaucratisation molle, sans terreur » [32], conséquence de la « fabrication sociale de l’individu […] par la société capitaliste instituée » [33] qui procède d’une double soumission de l’individu. À son aliénation productive à la bureaucratie s’ajoute une adhésion aux « besoins économiques » suscités. C’est une forme d’amor fati [34] qui mobilise les désirs des hommes au service du capital. Le consommateur prime sur le producteur, l’aliénation est joyeuse, la servitude volontaire.
Ainsi de la « bagnole » qui, comme l’a montré Ivan Illich dans Énergie et équité [35], malgré les odes à la liberté dont elle se pare, « a pour envers une dépendance radicale » [36]. Non seulement l’énergie et l’entretien nécessaires sont marchands, mais il se produit en plus un effet de saturation de la circulation, le seuil de contre-productivité étant dépassé en raison de sa diffusion exponentielle. Toute solution alternative a dans le même temps été écartée jusqu’à créer un monopole radical de son usage. Et le cercle se referme : « D’objet de luxe et de source de privilège, la bagnole est ainsi devenue l’objet d’un besoin vital : il en faut une pour s’évader de l’enfer citadin de la bagnole. » [37]
L’autonomie prend alors tout son sens, c’est un projet d’autolimitation, indissociable en cela de la question écologique : il y a articulation de la critique artiste à la critique écologique [38]. Gorz affirme qu’« il faut rompre avec l’idéologie de la croissance » [39], et précise : « […] le lien entre “plus” et “mieux” est rompu. “Mieux”, ce peut être “moins” […]. » [40] Car, avoue Castoriadis, « la critique de la bureaucratie et de la dégénérescence de la révolution russe me conduisait à l’idée d’autonomie du prolétariat » [41].
L’UTOPIE AUTOGESTIONNAIRE – L’AUTONOMIE

L’autonomie est protéiforme : elle « peut qualifier une pensée, une volonté, un individu, une communauté, un territoire, en renvoyant au grec autonomos : qui se gouverne par ses propres lois » [42]. Elle est d’abord individuelle, c’est une quête d’authenticité : « […] c’est ma loi, opposée à la régulation par l’inconscient qui est une loi autre, la loi d’un autre que moi. » [43] Castoriadis reprend ici l’analyse freudienne qui fait de l’inconscient le réceptacle de l’environnement social. Il ne cherche donc pas à éliminer les influences extérieures, qui sont irrémédiables, mais à fabriquer un nouveau rapport élucidé à l’autre qui permette une appropriation consciente. Dès lors, cette autonomie a pour corollaire la responsabilité [44].
L’autonomie est aussi collective avec la société autonome : « […] l’auto-institution permanente et explicite de la société ; c’est-à-dire un état où la collectivité sait que ses institutions sont sa propre création et est devenue capable de les regarder comme telles, de les représenter et de les transformer. » [45] Soit une société « qui n’est pas asservie à son passé ou à ses propres créations » [46]. Ainsi la première qualité de la société autonome est la réversibilité de ses décisions, rien ne doit y être figé dans le marbre, sacralisé, puisque tout est immanent. La seconde, c’est le dévoilement des ressorts de la décision. La transparence de l’information en est la pierre angulaire, ce qui exige une démocratisation de l’information, la « coopération entre ceux qui ont un savoir-compétence et ceux qui assument le travail productif » [47]. Donc la fin de la division verticale du travail, la jonction des cols blancs et des cols bleus.
Cela signifie d’abord l’égalité, celle des salaires et du temps de travail [48]. Une égalité dans la différence : « […] nous sommes autres, mais nous voulons être égaux pour ce qui est du pouvoir » [49], dit Castoriadis. Pour maîtriser son agir, la société doit non seulement évoluer dans de petites unités décentralisées (c’est l’ère du « small is beautiful » [50]), mais aussi opérer « l’inversion des outils » [51], pour une technique au service de l’homme (de sa liberté et de sa créativité) et non l’asservissant. Une tension interne traverse l’autonomie collective. Castoriadis cherche à configurer un nouvel équilibre entre liberté et discipline, et non à pencher en faveur de l’un ou l’autre pôle : « La question de […] l’autonomie de la société est aussi la question de l’auto-limitation de la société. Auto-limitation qui a deux versants : la limitation par la société de ce qu’elle considère comme les souhaits, tendances, actes, etc., inacceptables de telle ou telle partie de ses membres ; mais aussi, auto-limitation de la société elle-même dans la réglementation, la régulation, la législation qu’elle exerce sur ses membres. » [52]
L’INSTITUTION

Castoriadis tente ainsi de résoudre ce que Luc Boltanski nomme la « contradiction herméneutique » : d’un côté, il faut croire aux institutions pour stabiliser la société, mais de l’autre, celles-ci étant incarnées, elles ne sont que des fictions [53]. Castoriadis propose de « supprimer l’État, le monopole légal de la violence dans les mains d’un appareil séparé de la société » [54]. André Gorz, lui, fait effort pour penser la transition, le dépérissement progressif de l’État. Il distingue la sphère hétéronome, à savoir l’État et le marché auxquels serait réservée la production du nécessaire, de la sphère autonome, dont l’archétype est l’atelier communal autogéré revalorisant l’intelligence de la main [55], la première sphère finançant la seconde et s’effaçant graduellement jusqu’à être remplacée par elle.
Castoriadis, de son côté, cherche plutôt les clés de la pérennisation, il se demande comment « transformer l’état exceptionnel de la révolution en un état institué de fonctionnement régulier de la société » [56]. Il ne souhaite pas la suppression des institutions mais en appelle à « des institutions nouvelles […] un nouveau type de rapport entre la société et ses institutions [57] ». Une correspondance absolue entre les institutions et la société, nouveau totalitarisme, ne lui convient pas davantage car l’absolu c’est le néant [58]. Il adopte donc une approche réaliste : « La politique devient une composante de l’auto-institution de la société, la composante correspondant à un faire lucide, élucidé autant qu’il est possible [59]. » L’autonomie n’est donc pas un état, mais un processus, un devenir-conscient [60]. Castoriadis insiste : « […] il faut dénoncer ce préjugé absolutiste pseudo-révolutionnaire, selon lequel ou bien il y aurait une coupure radicale et totale, ou bien on serait récupéré à 100 % par le système. » [61]
LES VOIES DE LA TRANSFORMATION
Les deux intellectuels pragmatiques indiquent les voies de la transition. Chez Castoriadis, cela se traduit par une vision singulière de l’histoire comme création : « Il n’y a pas de chemin ; pas de chemin qui soit déjà tracé » [62], dit-il. Cette génération spontanée a toutefois sa filiation. D’abord son mythe des origines : « Il y a une guerre historique, commencée par le dèmos grec et les premiers philosophes d’Ionie. » [63] Puis arrive la modernité qui la reformule, désacralise les institutions en même temps qu’elle les resacralise (c’est la tension interne à la loi, sans cesse à refaire et pourtant votée comme pérenne) : ce sont les révoltes anarchistes en Espagne en 1936-1937, en Hongrie en 1956 ou à l’Est comme à l’Ouest en mai 1968.
Concrètement, pour Castoriadis, la politique révolutionnaire de la société autonome, c’est la praxis opérée par le « projet », qu’il définit comme une « praxis déterminée, considérée dans ses liens avec le réel, dans la définition concrétisée de ses objectifs, dans la spécification de ses médiations » [64]. Son réalisme ne se dément pas. Alors que l’élan de Mai 68 s’essouffle à la fin des années 1970, il perçoit que l’utopie autogestionnaire ne se suffit pas à elle-même pour mobiliser les masses. Il propose donc de lier l’aspiration à l’ autonomie à une « création culturelle », un nouveau mode de vie plus désirable [65]. Mais plus encore que cette action militante consciente ayant pour horizon l’autonomie, il insiste sur les transformations obtenues sur la longue durée par les mouvements « implicites » du prolétariat, des femmes ou des jeunes [66].
André Gorz, lui, prenant acte de la mutation en cours du capitalisme qui érode son efficacité productive, affirme la fin de la conception léniniste du parti [67]. Il observe à côté des revendications économiques traditionnelles l’émergence de « revendications extra-économiques, dites “qualitatives” » [68], et propose d’articuler les revendications du travail et du hors-travail, le local et le global. S’il ne récuse pas le cadre national du syndicat, il le limite à un rôle de coordination et en appelle à « une démultiplication de la direction des luttes » [69]. Au quotidien, il s’agit de trouver le difficile équilibre entre les comités de lutte et le syndicat [70]. Les deux intellectuels insistent sur la nécessité de donner une unité, une traduction universelle, aux luttes qui, reconfigurées, semblent éclatées. Ce sont les nouveaux mouvements sociaux (féministes, écologiques, juvéniles, etc.) qu’« on peut regrouper sous l’égide de la même signification : de mouvement vers et pour l’autonomie » [71].
CONCLUSION
Les discours d’André Gorz et Cornelius Castoriadis participent de la crise de la modernité organisée, de sa réflexivité. Ils tentent de réinventer la modernité démocratique à partir de la société civile contre la « culture politique de la généralité » [72]. Cette dernière, représentée par l’État et son corollaire l’imaginaire techno-économique, ne saisit l’homme que sous l’angle unidimensionnel et hétéronome du producteur-consommateur. La « critique artiste » y puise sa force radicale, déconstruit l’aliénation. L’autonomie apparaît alors dialectiquement comme une quête d’authenticité, individuelle ou collective. Gorz et Castoriadis plaident pour un nouveau rapport aux institutions : leur critique de l’État n’est pas nihiliste, elle cherche au contraire à promouvoir la société civile et l’individu. Ce n’est que sur les voies de la transformation qu’ils divergent, là où Castoriadis donne sa préférence au conseillisme, André Gorz œuvre à l’articulation du spontanéisme et du syndicat.
Libertaire, la « critique artiste » est libéral-compatible. Luc Boltanski et Ève Chiapello font d’ailleurs l’hypothèse de son assimilation par le capitalisme : « Tournant le dos aux demandes sociales qui avaient dominé la première moitié des années 1970, le nouvel esprit s’ouvre aux critiques qui dénonçaient alors la mécanisation du monde (la société postindustrielle contre la société industrielle), la destruction des formes de vie favorables à la réalisation des potentialités proprement humaines et, particulièrement, de la créativité, et soulignaient le caractère insupportable des modes d’oppression. » [73] Cette postérité prouve que la critique venant des marges politiques peut, lorsqu’elle irrigue l’esprit d’une époque, se déployer dialectiquement jusqu’à atteindre le cœur du système et le transformer. Ce qui ne donne cependant aucune indication sur l’orientation de cette hybridation…
Aujourd’hui, cette critique est réactivée par le courant « culturaliste » de la décroissance, héritier direct de Mai 68, événement structurant d’une génération. Serge Latouche marche ainsi dans les pas de Castoriadis lorsqu’il évoque « l’invention de l’économie » [74] au siècle des Lumières, une création imaginaire qui peu à peu en vient à se déconnecter du réel. Ainsi aussi lorsqu’il propose de « décoloniser l’imaginaire » [75] pour « sortir de l’économie » [76], c’est-à-dire sortir de l’économicisation du monde et entrer dans une « société autonome » [77] où le citoyen remplace l’homme unidimensionnel producteur-consommateur. Il reprend ainsi le projet d’autonomie de Castoriadis doublement caractérisé par une rupture symbolique et la mise en œuvre d’une démocratie radicale d’institution permanente. Et il précise qu’« en toute rigueur, il conviendrait de parler d’“a-croissance”, comme on parle d’“athéisme”, plutôt que de “décroissance”. C’est d’ailleurs très précisément de l’abandon d’une foi ou d’une religion qu’il s’agit : celle de l’économie, de la croissance, du progrès et du développement » [78]. Le « courant culturaliste » est suivi par son héritier, le « courant démocratique » [79], représenté par le journal La Décroissance dont le politologue Paul Ariès a longtemps été un des contributeurs réguliers. Celui-ci, lorsqu’il parle de « renouer avec l’autonomie » [80], ne manque pas lui aussi de citer Castoriadis, dont il loue la position intermédiaire, sur une ligne de crête entre la désinstitutionnalisation et la servitude volontaire. La décroissance choisit donc la voie équilibrée d’une réinstitutionnalisation continue, c’est-à-dire une autonomie authentique, une société qui se donne à elle-même ses propres limites.
André Gorz, qui a vécu dix ans de plus que Castoriadis, a eu l’opportunité de porter lui-même son héritage dans les premières années du nouveau millénaire et d’actualiser sa pensée. Pour lui, la figure de l’autonomie c’est désormais le hacker, nouveau démiurge social : « L’activité du hacker repose sur une éthique de la coopération volontaire dans laquelle chacun se mesure aux autres par la qualité et la valeur d’usage de son apport au “pot commun”, et se coordonne librement avec eux. » [81] Mais chacun est en capacité de devenir son propre maître grâce à la technologie de l’impression 3D (c’est-à-dire la fabrication de toutes sortes d’objets à partir d’une machine solidifiant une résine liquide photosensible), outil convivial qui ouvre la voie à la réalisation de l’Homo faber et à l’utopie des ateliers communaux autogérés et en réseau [82].
À l’heure où une nouvelle brèche s’ouvre dans l’hypermodernité avec l’instabilité de tous les systèmes et la convergence des crises – économique, politique, énergétique, technique, écologique –, la « critique artiste » a l’opportunité de jaillir à nouveau, couplée à la critique sociale et à la critique écologique, dans une articulation inédite conduisant à la création d’un écosocialisme susceptible de générer une nouvelle bifurcation historique.
[1] « Construire l’autogestion », in F. Georgi (dir.), Autogestion, la dernière utopie ?, F. Georgi, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003, p. 17.
[2] L’autogestion et l’autonomie sont ici synonymes et seront employées indifféremment.
[3] Outre les nombreuses notes du texte d’origine à propos d’écrits d’A. Gorz et C. Castoriadis, on pourra aussi se reporter à « Autogestion et hiérarchie », Cornélius Castoriadis, Les utopiques n°10, Editions Syllepse, 2019 [Note de l’éditeur].
[4] Le nouvel esprit du capitalisme, L. Boltanski et E. Chiapello, Editions Gallimard, Paris, 1999, p. 83-84.
[5] « La hiérarchie des salaires et des revenus », in L’expérience du mouvement ouvrier. Prolétariat et organisation, t. 2, C. Castoriadis, Editions 10/18, Paris, 1974, p. 65.
[6] « Les significations imaginaires », in Une société à la dérive. Entretiens et débats, 1974-1975, C. Castoriadis, Editions du Seuil, Paris, 2011 [2005], p. 111.
[7] De l’écologie à l’autonomie, C. Castoriadis, D. Cohn-Bendit et le public de Louvain-la-Neuve, Editions du Seuil, Paris, 1981, p. 23.
[8] « La question de l’histoire du mouvement ouvrier », in L’expérience du mouvement ouvrier. Comment lutter, t. 1, C. Castoriadis, Editions 10/18, Paris, 1974, p. 111.
[9] « Discussion avec les militants du PSU », in Le contenu du socialisme, C. Castoriadis, Editions 10/18, Paris, 1979, p. 284.
[10] Écologie et politique, A. Gorz, Editions du Seuil, Paris, 1978, p. 26.
[11] Les carrefours du labyrinthe, C. Castoriadis, Editions du Seuil, Paris, 1978, p. 189-190.
[12] A. Gorz, op. cit., p. 23.
[13] C’est le passage irréversible de l’ordre au désordre.
[14] La décroissance. Entropie, écologie, économie, N. Georgescu-Roegen, Editions Sang de la Terre, Paris,
[15] « Les significations imaginaires », C. Castoriadis, op. cit., p. 98.
[16] « Pourquoi je ne suis plus marxiste », in Une société à la dérive, C. Castoriadis, op. cit., p. 69.
[17] Ibid., p. 69-70.
[18] « Discussion avec les militants du PSU », C. Castoriadis, op. cit., p. 284..
[19] « S’il est possible de créer une nouvelle forme de société », in Une société à la dérive, C. Castoriadis, op. cit., p. 174.
[20] A. Gorz, op. cit., p. 27.
[21] Ibid., p. 44.
[22] En référence à Ivan Illich (1926-2002), un des penseurs de l’écologie politique [Note de l’éditeur]
[23] Ibid., p. 46.
[24] Ibid., p. 124.
[25] Ibid., p. 119.
[26] Ibid., p. 114-128.
[27] Ibid., p. 123.
[28] L. Boltanski et E. Chiapello, op. cit., p. 83-84.
[29] L’institution imaginaire de la société, C. Castoriadis, Editions du Seuil, 1999 [1975], p. 164.
[30] « Autogestion et hiérarchie », in Le contenu du socialisme, C. Castoriadis, op. cit., p. 319.
[31] « Les significations imaginaires », C. Castoriadis, op. cit., p. 118.
[32] Ibid., p. 119.
[33] C. Castoriadis, D. Cohn-Bendit et le public de Louvain-la-Neuve, op. cit., p. 26.
[34] Locution latine utilisée par Friedrich Nietzsche, qui signifie « l’amour du destin » ou « l’amour de la destinée ».
[35] Énergie et équité, I. Illich, Editions du Seuil, Paris, 1975.
[36] A. Gorz, op. cit., p. 80.
[37] Ibid., p. 83.
[38] « Capitalism and its Criticism », in New Spirits of Capitalisms? Crisis, Justifications, and Dynamics, E. Chiapello, Oxford University Press, Oxford.
[39] A. Gorz, op. cit., p. 14.
[40] Ibid., p. 36.
[41] C. Castoriadis, « La question de l’histoire du mouvement ouvrier », op. cit., p. 18.
[42] L’avenir de la société alternative. Les idées 1968-1990…, D. Allan Michaud, Editions L’Harmattan, Paris, 1989, p. 30.
[43] L’institution imaginaire de la société, C. Castoriadis, , op. cit., p. 151.
[44] « S’il est possible de créer une nouvelle forme de société », C. Castoriadis, op. cit., p. 188.
[45] « Pourquoi je ne suis plus marxiste », C. Castoriadis, op. cit., p. 78.
[46] Ibid., p. 77.
[47] « Autogestion et hiérarchie », C. Castoriadis, op. cit., p. 312.
[48] « Discussion avec les militants du PSU », C. Castoriadis, op. cit., p. 293 et 295.
[49] « L’exigence révolutionnaire », in Le contenu du socialisme, C. Castoriadis, op. cit., p. 366.
[50] A. Gorz, op. cit., p. 24.
[51] Ibid., p. 27.
[52] C. Castoriadis, D. Cohn-Bendit et le public de Louvain-la-Neuve, op. cit., p. 48.
[53] Précis de sociologie de l’émancipation, L. Boltanski, De la critique. Editions Gallimard, Paris, 2009, p. 132.
[54] « L’exigence révolutionnaire », C. Castoriadis, op. cit., p. 343..
[55] . Gorz, op. cit., p. 103.
[56] « Discussion avec les militants du PSU », C. Castoriadis, op. cit., p. 290.
[57] « Ce que les partis ne peuvent pas faire », C. Castoriadis, op. cit., p. 196-197.
[58] L’institution imaginaire de la société, C. Castoriadis, op. cit., p. 169.
[59] « L’exigence révolutionnaire », C. Castoriadis, op. cit., p. 327.
[60] « La source hongroise », in Le contenu du socialisme, C. Castoriadis, op. cit., p. 382.
[61] « Ce que les partis ne peuvent pas faire », C. Castoriadis, op. cit., p. 197.
[62] « La source hongroise », C. Castoriadis, op. cit., p. 408.
[63] « S’il est possible de créer une nouvelle forme de société », C. Castoriadis, op. cit., p. 187.
[64] L’institution imaginaire de la société, C. Castoriadis, op. cit., p. 115.
[65] C. Castoriadis, D. Cohn-Bendit et le public de Louvain-la-Neuve, op. cit., p. 45.
[66] « La question de l’histoire du mouvement ouvrier », C. Castoriadis, op. cit., p. 95.
[67] A. Gorz, op. cit., p. 150.
[68] Ibid., p. 151.
[69] Ibid., p. 163-164.
[70] Ibid., p. 167.
[71] « Les significations imaginaires », C. Castoriadis, op. cit., p. 117.
[72] Le modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789, P. Rosanvallon, Editions du Seuil, Paris, 2004, p. 13.
[73] L. Boltanski et E. Chiapello, op. cit., p. 288-289.
[74] L’invention de l’économie, S. Latouche, Editions Albin Michel, Paris, 2005.
[75] Décoloniser l’imaginaire. La pensée créative contre l’économie de l’absurde, S. Latouche, Editions Parangon, Lyon, 2005.
[76] Le pari de la décroissance, S. Latouche, Editions Fayard & Pluriel, Paris, 2010, p. 87-92.
[77] Ibid., p. 211.
[78] Ibid., p. 17.
[79] Sur la distinction des courants de la décroissance, voir La décroissance, une idée pour demain T. Duverger, Editions Sang de la Terre, Paris, 2011, p. 17-18.
[80] La décroissance. Un nouveau projet politique, P. Ariès, Editions Golias, Lyon, 2009, p. 241-245.
[81] L’immatériel. Connaissance, valeur et capital, A. Gorz, Editions Galilée, Paris, 2003, p. 94.
[82] Ecologica, A. Gorz, Editions Galilée, Paris, p. 118.
