De la charte d’Amiens
Ce texte a été rédigé en 2006. C’est une contribution au colloque « Cent ans après la Charte d’Amiens : la notion d’indépendance syndicale face à la transformation des pouvoirs » *. On repèrera une poignée de références marquées par la date d’écriture. Mais s’agissant du fond, il demeure tout à fait d’actualité. D’où le choix de le reprendre ici, en excluant uniquement les passages qui s’étendaient sur les appels pour l’autonomie du mouvement social, traités par ailleurs dans ce numéro.
* Colloque international organisé par le Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique, Amiens, du 11 au 13 octobre 2006.
Thierry Renard était secrétaire de la CFDT PTT du Val-de-Marne, lors des exclusions de 1988. Il fait partie des créateurs et créatrices de SUD-PTT. Responsable juridique de cette fédération, il l’était pour l’Union syndicale Solidaires lorsqu’il écrivit cette contribution. Il est désormais avocat, spécialisé en droit administratif et droit du travail.
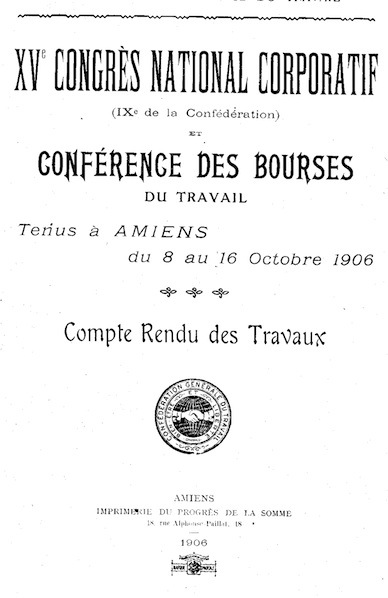
La question de l’indépendance occupe une place centrale dans les références à la Charte d’Amiens. Cette question est malheureusement traitée souvent sous l’angle quasi exclusif des rapports entre le syndicalisme et les partis politiques. La Charte d’Amiens pose pourtant comme principe une indépendance de classe, une capacité de la classe des opprimé∙es à avoir son propre projet émancipateur. L’indépendance n’a en effet aucun sens, si l’organisation prétendument indépendante n’a pas sa propre vision, ses orientations stratégiques propres. La « double besogne » dont parlait Fernand Pelloutier constitue une des spécificités majeures du syndicalisme révolutionnaire. Les modèles socio-démocrates dans leurs versions réformistes et/ou radicales (léninisme), le travaillisme, opèrent une séparation entre l’économique et le politique et délimitent des champs de compétences séparés pour les organisations syndicales et les organisations politiques. Le fait que le syndicalisme se soit donné la possibilité, voire l’obligation de penser le politique dans la Charte d’Amiens n’a pas pour autant suffi à permettre que le syndicalisme soit réellement indépendant des partis, des états, des institutions, des courants idéologiques dominants.
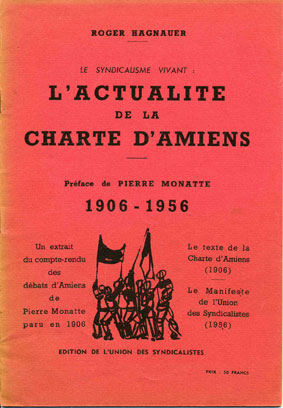
Le syndicalisme de lutte de classes et de transformation sociale, pour reprendre une formulation en vogue dans les années 70 parmi les syndicats autogestionnaires, peine aujourd’hui à élaborer des propositions, des axes programmatiques stratégiques pour la transformation radicale et anticapitaliste de la société. De nouvelles opportunités naissent cependant, à partir des pratiques sociales renouvelées, d’émergences de nouveaux acteurs et d’alliances entre les associations de luttes et une partie du mouvement syndical. Le nouveau cycle de luttes ouvert notamment par la manifestation de Seattle en 1999 contre l’OMC crée l’opportunité d’une nouvelle élaboration d’un projet émancipateur. Les partis de gauche dominants, en panne de projet politique, enfermés dans une politique d’alternance plus que d’alternative, ne remettent plus en cause le capitalisme et s’adaptent au libéralisme.
Pour autant, les rapports entre les partis, les associations de lutte et les syndicats font l’objet d’âpres discussions. Les tentatives d’instrumentalisation, de subordination n’ont pas disparu malgré les proclamations d’adhésion au principe d’indépendance. Un nouveau modèle de rapports entre les partis et le mouvement social est sans aucun doute à inventer, après les expériences du passé. Mais l’enjeu n’est certainement pas en premier lieu de définir des procédures organisant les rapports entre le mouvement social, et les partis politiques. Il y a d’abord, une impérieuse nécessité à définir les contenus de la transformation sociale.
Amiens, 1906
La Charte d’Amiens est le fruit d’un compromis entre plusieurs courants de la CGT (anarchistes, allemanistes, broussistes [1], sans affiliation idéologique). Elle s’élabore à un moment particulier, dans un contexte historique particulier (échec de la stratégie émeutière, présence de ministres socialistes au gouvernement), théorie de Pierre-Joseph Proudhon sur la « séparation » de la classe ouvrière du reste de la société, les débats du mouvement socialiste, des courants de pensée influents (allemanistes, broussistes, anarchistes). La Charte d’Amiens donne un avantage stratégique à cette alliance contre les guesdistes [2]. Ce courant voulait en effet subordonner l’organisation syndicale aux objectifs du parti. La Charte d’Amiens constitue un tout. A la fois, un projet de société, une stratégie (la grève générale), des revendications immédiates au quotidien, de l’expérimentation sociale avec les bourses du travail (double structuration du mouvement syndical – horizontal et vertical ), etc. On pourrait dire aujourd’hui, un syndicalisme de lutte de classes, interprofessionnel et de transformation sociale.
Indépendance et transformation sociale
L’enjeu du syndicalisme de transformation sociale aujourd’hui, pour ne pas être des syndicalistes qui portent une ligne politique sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir ! Si l’indépendance est abordée de manière importante sous l’angle des rapports partis-syndicats, cette question ne peut pas être résumée à cette approche. L’indépendance s’entend nécessairement vis-à-vis de l’Etat, des institutions, du patronat, et à tous les échelons géographiques. D’emblée, on peut s’interroger sur l’indépendance réelle des organisations syndicales qui n’ont pas de projet spécifique. Nécessairement, la question pour elles est d’accompagner plus ou moins les courants dominants, sans pour autant être dans un rapport de subordination organique avec tel ou tel courant. Il s’agit simplement d’être dans le main stream, dans le jeu démocratique en vigueur. De ce point de vue, la Confédération européenne des syndicats (CES) apparaît bien comme constituant un patchwork qui n’a pas de projet propre, si ce n’est d’accompagner la construction institutionnelle de l’Europe. La CES apparaît ainsi comme une organisation déconnectée des organisations affiliées et des syndicats membres de celles-ci. Le jeu institutionnel et l’expertise intégrée à la construction européenne tiennent lieu de cadre général. Il y a bien absence de construction de mobilisations sur des objectifs stratégiques propres aux salariés. Certains auteurs (R. Balme et D. Chabanet) parlent de la CES comme d’une « instance de dépolitisation ». Si la question de l’indépendance vis à vis des partis est réaffirmée dans bon nombre de cas, par les organisations syndicales, l’affirmation d’une ligne syndicale anticapitaliste et indépendante des différents interlocuteurs est dans les faits beaucoup moins affirmée.
La question de savoir si un syndicat doit avoir un projet propre pour la transformation de la société est une orientation encore moins partagée. Il y a parmi les courants syndicaux qui revendiquent une filiation directe avec la Charte d’Amiens, pour certains, un refus de prendre en compte, l’aspect « double besogne ». Avoir un projet est assimilé à un projet politique partisan, quand il n’est pas tout bonnement refusé, au nom de la nécessaire unité de salarié∙es qui, nécessairement, ne pensent pas tous la même chose. Force ouvrière en France participe de ce courant. On a pu voir au sein même de la CGT, des inflexions sur cette question. Maïté Lassalle, devant la Commission exécutive de la CGT, le 8 février 2005, déclarait : « Pour autant, on ne peut oublier que notre finalité première est revendicative, que la CGT n’est pas directement porteuse d’un projet de société et que cela nous impose, sans doute, des limites dont il nous faut rediscuter ensemble. »
Les syndicats de Solidaires peinent à avancer sur ce terrain. « Si nous ne faisons de politique nous-mêmes, ce sont les autres qui décideront pour nous ». Cette formule résume assez bien, le sentiment commun qui domine parmi les syndicats de Solidaires. Pour autant, le travail d’élaboration se heurte aux nombreuses difficultés, urgences, action et a tendance à passer au second plan. La question du rapport au politique et aux partis politiques est plus vite réglée, par la réaffirmation globale de l’indépendance. Il faut dire que, pendant des années, les résolutions générales des syndicats autogestionnaires comportaient des formules rituelles telles que « la crise du capitalisme se poursuit et s’approfondit », la référence au syndicalisme de transformation sociale figurait également en bonne place. Cet attachement perdure avec des nuances parmi les syndicats membres de l’Union syndicale Solidaires. Ainsi, « […] SUD-PTT inscrit son action dans une double continuité : celle définie en 1906 par la CGT dans la charte d’Amiens, qui assigne au syndicalisme un double objectif et une exigence : défense des revendications immédiates et quotidiennes, et lutte pour une transformation d’ensemble de la société en toute indépendance des partis politiques et de l’État ; celle du projet de socialisme autogestionnaire porté par la CFDT dans les années 70, dans la mesure où il place les travailleur∙euses et la nécessité de la démocratie la plus large au cœur de l’objectif de transformation sociale comme de la démarche visant à y parvenir. » Pour autant, le contenu de cette transformation sociale, comme le contenu du mot d’ordre des Forums sociaux mondiaux, européens, « un autre monde est possible », a du mal à prendre forme. On pourra objecter que l’idée de transformation anticapitaliste de la société a pris du plomb dans l’aile avec l’écroulement des pays de l’Est se revendiquant du communisme et que la vacuité des partis de gauche d’alternance n’aide pas à l’élaboration.
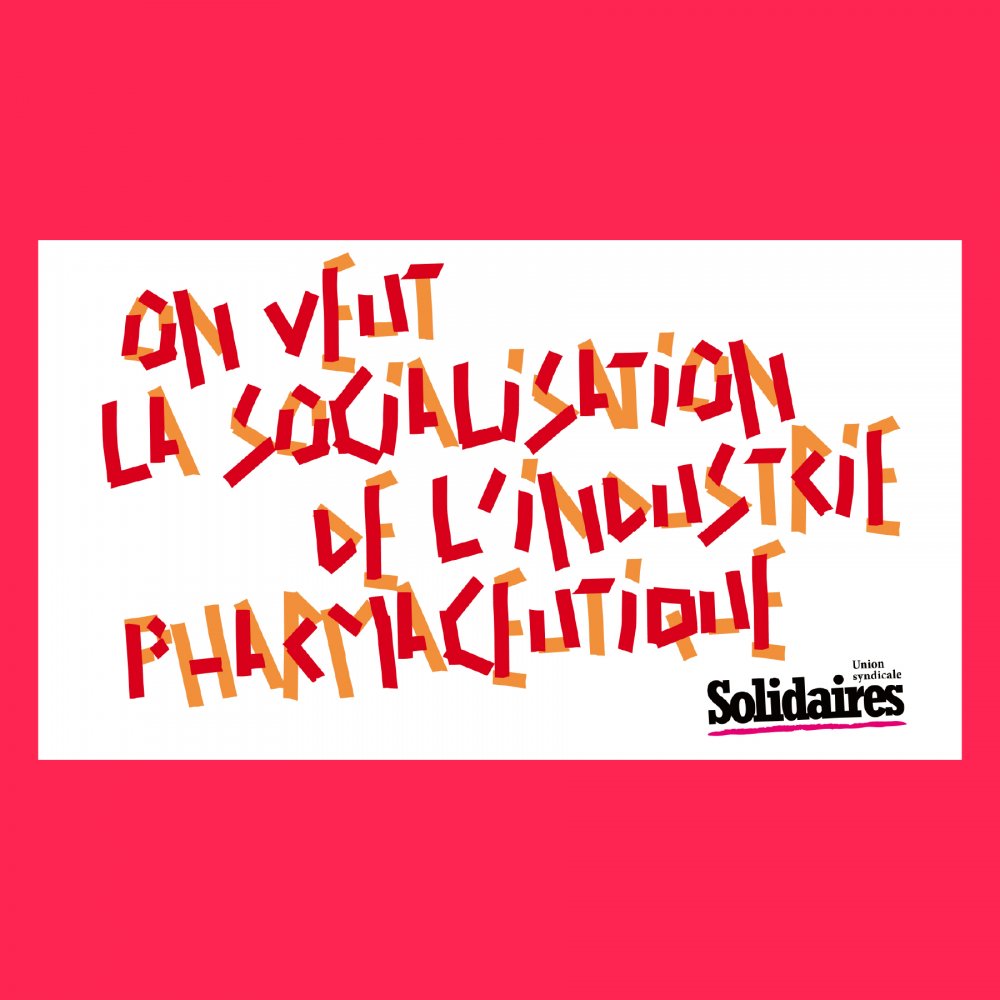
La direction du patronat français défend une sorte de projet politique, au nom de la société civile, qui apparaît comme une transposition patronale de l’approche syndicaliste révolutionnaire. Pendant la période où Jospin a été Premier ministre, le MEDEF s’est doté d’un corpus théorique pour être la force politique d’opposition réelle au gouvernement socialiste et être la force politique tout court qui donne le « la » sur les questions de société. Ce corpus était fondé sur l’idée que l’entreprise est le lieu essentiel de la démocratie et d’exercice du pouvoir. Le modèle même de la société. Autour de la notion de la gestion du risque, pour mettre fin à la lutte des classes, la question de l’intégration du salariat aux objectifs du capitalisme était centrale. Pour cela, le patronat doit être un acteur central de la production des normes. Mais, évidemment, il ne le peut pas tout seul. A grands renforts de thèses biseautées de Michel Foucault, de Gramsci sur la société civile, une idée sur la légitimité est pendante : les « partenaires sociaux sont les seuls légitimes à prendre les décisions, les politiques disent tous la même chose et n’ont d’autres intérêts que d’être élu∙es, sans enjeu de société ». Pour résumer : la droite et la gauche c’est pareil. La légitimité c’est le contractuel, les « partenaires sociaux », sous-entendu, sous la direction du patronat. Les syndicats, dans cette affaire, sont des associés qui aménagent, qui accompagnent. Bien entendu, le patronat a toujours fait de la politique, souvent indirectement, avec les partis de droite. Dans cette nouvelle approche, le patronat entend faire directement, lui-même de la politique et être un acteur politique décisif.
On le voit, la question d’un projet de transformation sociale occupe une place importante, même si la question des contenus, dans le contexte actuel, reste en deçà des nécessités. Ce n’est pas une question idéologique coupée des réalités. C’est une question stratégique pour agir. Refuser de mener ce travail c’est prendre le risque de se placer sous la coupe du modèle dominant ou des courant politiques. Avoir des éléments d’un projet de transformation sociale permet d’avoir une compréhension du monde et de ce qu’il faut changer et pèse directement sur le contenu et la forme des luttes sociales. En 1973, à l’occasion de la grève des salariés de LIP, c’est bien l’influence de la section syndicale CFDT qui discutait depuis des années du socialisme autogestionnaire qui permet la mise en place de l’expérience d’autogestion de l’entreprise. Sans cet apport politique, la lutte aurait pris les formes traditionnelles d’une lutte contre la fermeture d’une usine avec occupation. Elle n’aurait jamais eu la portée subversive et exemplaire qu’elle a eue (on peut se passer du patron, de la hiérarchie, on produit, on vend on se paie).

La partie se rejoue en permanence
L’indépendance et la « double besogne » demeurent des axes essentiels pour le syndicalisme. Le développement de ce que l’on appelle le mouvement social, à des échelons territoriaux différents, la vacuité des programmes de gauche, la chute du mur de Berlin, imposent que, face au capitalisme triomphant, des réponses alternatives soient opposées. Cette nécessité d’élaborer de solides réponses stratégiques au modèle dominant pose la question de savoir qui est légitime pour faire de la politique et comment peuvent s’organiser les rapports entre les différents acteurs politiques, syndicaux, associatifs. En premier lieu, il convient d’observer que la question sociale est au cœur de la politique. Sauf à considérer que l’identification des questions politiques devrait se résumer à la question du pouvoir, on peut constater que les luttes sociales font de la politique, bougent la société. Ces luttes ont permis de faire émerger ces dernières années des thèmes et des questions dont les partis, institutionnels ou non, n’ont pas eu l’initiative : les minima sociaux, le partage des richesses, le droit au logement contre le droit de propriété, etc.
Les contre-pouvoirs se sont imposés et font bouger la société. De fait, ces contre-pouvoirs ne laissent pas intact le pouvoir dès lors qu’il participent à modifier en profondeur la société et qu’ils s’attaquent à la délégation de pouvoir et aux institutions illégitimes. Les formes de lutte elles-mêmes correspondent, pour une large part, à une aspiration à maîtriser sa vie, ses luttes (articulation nouvelle entre individu et collectif). Les pratiques d’auto-organisation constituent une aspiration démocratique et participent de la crise générale de la représentation et de la représentativité. Pour autant, les réponses partielles des divers mouvements mettent en œuvre une diversité des réponses et des approches qui ne constituent pas aujourd’hui une réponse globale au capitalisme. En second lieu, en pleine filiation avec la Charte d’Amiens, il y a urgence à travailler à l’élaboration de projets émancipateurs.
Le mouvement social, les mouvements sociaux ont une légitimité pour penser le politique, la politique
Comme il a déjà été dit, le refus de faire ce travail d’élaboration ne mène qu’à la dépolitisation et, en définitive, à la reconduction de l’ordre existant. Ce qui change par rapport à 1906 est sans doute la pluralité des acteurs et actrices. Le syndicalisme ne peut plus prétendre se suffire à lui-même et est bien obligé d’accepter de travailler avec toute une série d’associations, de mouvements de luttes spécifiques. Il y a donc tout lieu de penser qu’une confrontation au sein même du mouvement social est nécessaire pour élaborer de nouvelles perspectives de transformation de la société. Chacun à partir de sa réalité sociologique et de son expérience est en mesure d’apporter des éléments permettant de construire l’ensemble. Dans ce cadre, la capacité de l’organisation syndicale, à partir également de sa réalité de classe, à élaborer des éléments de réponses stratégiques constitue un enjeu. Un enjeu majeur pour ancrer les réponses du mouvement social dans une perspective de classe.
Ce travail d’élaboration des composantes du mouvement social n’implique pas que les partis et courants politiques n’auraient plus aucune pertinence. Cela signifie que les partis politiques et les composantes du mouvement social acceptent, dans les faits, le pluralisme et la pluralité des légitimités. Les courants qui se sont opposés sur les meilleurs chemins vers le socialisme ont tous développé une conception hégémonique et exclusive. Même si les déclarations prenaient soin d’affirmer le pluralisme, dans les faits, une seule voie était possible. Pour une certaine école syndicaliste révolutionnaire, le syndicat se suffisait à lui-même et il fallait ignorer les autres courants. Pour la plupart des courants politiques de gauche, la primauté de l’action politique revenait au parti. Cette conception de la primauté du syndicat ou du parti était sans doute fondée sur des expériences précises et datées. Elle s’articulait avec une idée mythique de la classe ouvrière conçue comme un bloc homogène avec une seule orientation possible. Ces conceptions n’ont pas totalement disparu. Et, la hiérarchie entre le syndicat et le parti non plus.
Même si les uns et les autres n’ont pas les mêmes fonctions, notamment dans l’exercice du pouvoir, chacun est légitime à penser le politique et aucune considération ne peut justifier une quelconque exclusivité. La reconnaissance dans les faits de cette pluralité de légitimité peut permettre de faire avancer les choses. Le débat n’étant plus de savoir s’il doit y avoir soumission, substitution, mais comment peuvent s’organiser les confrontations qui peuvent marquer des points d’accord et de désaccord. D’autant que si l’élaboration se fait au sein des organisations, il n’y a pas de frontière étanche qui empêcherait que les question débattues ici ou là ne puissent être discutées partout. Enfin, donc, la prise en compte de la nécessité d’un projet de transformation sociale, la pluralité des légitimités à penser le politique, impliquent de parler des rapports entre les partis et le mouvement social. Il ne s’agit pas ici de définir des procédures en dehors de la logique même de l’élaboration nécessaire. Le préalable demeure l’anticapitalisme.
Cependant, régulièrement, des organisations, des partis, des courants politiques tentent de s’accaparer la notoriété du mouvement social, de ses luttes. En 1998, la proximité des élections européennes a donné lieu à des tentatives de récupération et d’instrumentalisation. Un premier appel pour l’autonomie du mouvement social a été lancé en 1998 et a fait débat dans les cercles militants. Il a donné lieu à de nombreuses discussions et exprimé bon nombre de désaccords, sur la place respective du mouvement social, des partis, de la représentation. Il a eu pour effet toutefois de calmer les ardeurs récupératrices trop voyantes. Les mêmes tentatives, avec des variantes, se répètent à chaque élection où il est question de permettre à des militant∙es, en vue, médiatisé∙es, qui ont été les porte-parole de luttes, d’apparaître sur telle ou telle liste. Il s’agit de s’accaparer le capital symbolique de cette lutte en espérant que l’électeur ou l’électrice qui a pu avoir de la sympathie pour la lutte vote pour la liste sur laquelle figure un∙e de ces animateurs ou animatrices. Il n’est bien entendu jamais demandé aux organisations, dont sont issus ces leaders visibles, de prendre position. Il y a un glissement de la notoriété individuelle fondée sur la lutte, le mouvement, le syndicat vers une autonomisation personnelle au profit d’un parcours politique partisan. Il ne s’agit pas de dire que les responsables syndicaux, associatifs, ne devraient pas avoir d’engagement politique, au contraire, c’est une bonne chose pour ces partis, mais c’est le tour de passe-passe, l’utilisation de la lutte, de l’organisation qui n’est pas légitime.
De même, on entend régulièrement parler de débouché politique aux luttes, quand il ne s’agit que de participation aux institutions et alors qu’aucun contenu de transformation de la société n’est proposé. Le débouché politique aux luttes, c’est d’abord la victoire des luttes elles-mêmes et la politisation du mouvement social. […] La pluralité des légitimités à penser le politique doit vraiment entrer dans les faits. Cette élaboration démocratique est une condition essentielle pour passer de la résistance à l’offensive. En définitive, faire vivre aujourd’hui les objectifs de la Charte d’Amiens, c’est sans aucun doute, être toujours aussi intransigeant sur l’indépendance et se battre pour que le syndicalisme et le mouvement social aient les moyens de cette indépendance, en faisant beaucoup plus de politique.
Thierry Renard
[1] Jean Allemane (1843-1935) était un des principaux animateurs du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (PSOR), issu d’une scission de la Fédération des travailleurs socialistes de France (FTSF), en 1890. Contrairement aux autres partis socialistes de l’époque, le PSOR mettait en avant l’action syndicale par rapport à l’action du parti lui-même ; sa propagande portait sur la grève générale et l’antimilitarisme. Les courants représentés par le POSR et FTSF contribueront à la création de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) en 1905.
Paul Brousse (1844-1912) rejoint l’Association internationale des travailleurs (AIT) après la Commune de Paris. Il en est exclu en 1872, avec les « anti-autoritaires ». De retour d’exil, en 1880, il rejoint le Parti ouvrier où il anime le courant « possibiliste » qui considère que la révolution viendra d’une évolution du système économique, social et institutionnel. Cela amène à la rupture avec les partisans de Jules Guesde et à la création de la Fédération des travailleurs socialistes de France (FSTF), en 1882.
[2] Jules Guesde (1845-1922) a été l’animateur du Parti ouvrier français (POF), jusqu’à la création de la SFIO, en 1905. Les « guesdistes » revendiquent la supériorité du parti sur le syndicat ; contrôlant la Fédération national des syndicats jusqu’en 1894, ils la cantonnent à un rôle corporatiste. Jules Guesde a été député, de 1893 à 1898 puis de 1906 à sa mort.
LA MOTION ADOPTÉE LE 13 OCTOBRE 1906 PAR LE XVE CONGRÈS NATIONAL CORPORATIF (IXE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL), RÉUNI À AMIENS
Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2 constitutif de la CGT : la CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat.
Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose, sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière.
Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique :
Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc.
Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale.
Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation de salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat.
Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté, pour le syndiqué, de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu’il professe au dehors.
En ce qui concerne les organisations, le Congrès décide qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale.
