La revue Autogestion : observatoire des mouvements d’émancipation
En dépit de la multiplicité des interprétations qui en ont brouillé les contours au point qu’on a parfois l’impression qu’il y a autant d’acceptions que de locuteurs, chacun présentant ses propres réticences, voire ses phobies, l’autogestion est une figure centrale du mouvement d’émancipation tout au long du XXe siècle. Dans la continuité des débats et controverses au sein du marxisme ou entre marxistes et populistes à la fin du XIXe siècle, ses modèles ont été le mir en Russie, la commune paysanne, à partir de la vision d’un communisme primitif largement mythifié. Puis, de la Commune de Paris aux comités d’action, en passant par les soviets, les conseils ouvriers, les commissions ouvrières, etc., l’autogestion a sans cesse rejailli selon des modalités différentes avec pour objectif la prise en main de leurs destinées par les intéressés eux-mêmes, que ce soit à l’usine ou dans la cité, comme forme de démocratie directe. Par exemple, à la veille de la révolution de 1905, se situant dans le sillage de Marx, le social-démocrate russe Pavel Axelrod, dans sa polémique avec les bolcheviks, parlait d’auto-développement, d’auto-éducation, d’auto-activité (qu’exagérément optimiste, il voyait réalisés dans le mode de fonctionnement de la social- démocratie allemande), termes qui se rejoignent dans la notion d’autogestion. Dans le champ sémantique germanique, en particulier social-démocrate, son équivalent — Selbstverwaltung — servait, de manière plus restrictive, à qualifier la démocratie locale tandis qu’associée ou opposée à la participation et à la cogestion, elle a souvent été confinée dans le domaine économique, avec une fixation sur l’aspect gestionnaire.
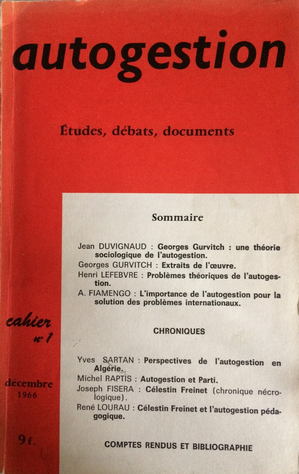
La principale tentative d’élucidation du terme et de l’utopie concrète qu’il recouvre se situe entre le milieu des années soixante et le milieu des années quatre-vingt, période qui coïncide avec sa fortune, en France, dans plusieurs organisations politiques et syndicales, du PSU (Parti socialiste unifié) à la CFDT (Confédération française démocratique du travail) en particulier, tandis que dans d’autres pays occidentaux également, les débats théoriques s’alimentaient à des expériences. Ces vingt années sont aussi celles de l’existence de la revue Autogestion. C’est une revue jumelle de L’Homme et la Société : leur premier numéro paraît la même année, 1966, chez le même éditeur, Anthropos, sous la houlette de Serge Jonas. Durant les vingt années de leur coexistence, nombre d’auteurs contribuent à l’une et à l’autre — phénomène, il est vrai, habituel pour des revues d’orientation proche. Aux origines d’Autogestion et de L’Homme et la Société, on retrouve les noms d’Henri Lefebvre1 ou de René Lourau, par exemple, dont la collaboration reprend à la fin d’Autogestion et s’est poursuivie dans la revue sœur. Puis apparaissent dans l’une et l’autre les contributions urticantes de Louis Janover ou de Jean- Pierre Garnier, pour ne citer que quelques noms ou, pour quitter l’hexagone, Noam Chomsky et Murray Bookchin.
Est-ce à dire que les deux revues ont fait double emploi ? Pour répondre à cette question, il faudrait examiner le contenu afin de mieux cerner les différences ou plutôt, afin de pointer ce qui fait la spécificité d’Autogestion. Il n’est pas possible — du moins serait- ce particulièrement fastidieux — de soumettre à une analyse de contenu chacun des 66 numéros parus (43 dans la première série, 23 dans la seconde, à laquelle je fus associée) : rebaptisée Autogestion et socialisme en 1970 — et bénéficiant alors du concours financier du CNRS2, gage de scientificité, mais aussi condition d’une survie qui préoccupe d’ordinaire les revues — Autogestion s’est affublé du pluriel dans la dernière série pour indiquer, peut-être, une tendance plus pragmatique, plus à l’écoute de l’actualité immédiate des expériences assimilables à l’autogestion susceptibles d’apparaître dans divers contextes à l’échelle de la planète. Je peux tout juste tenter de cerner les grandes orientations, surtout, dans la perspective qui nous préoccupe ici, celle de l’émancipation sociale.
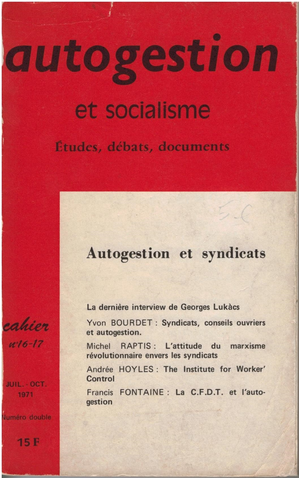
Scruter les potentialités, critiquer les apories, tels étaient les objectifs d’Autogestion. Bien que non partisane et s’inscrivant dans la mouvance universitaire, c’était une revue engagée, comme en témoignent les polémiques souvent acerbes, non seulement avec la gauche et l’extrême gauche, mais aussi avec la droite, prompte à vouloir tirer l’autogestion du côté du libéralisme. Pour élargir l’acception purement économiste, la plus répandue, Yvon Bourdet qui en fut longtemps le maître d’œuvre, importa de Socialisme ou Barbarie, revue à laquelle il avait collaboré et qui disparut un an plus tard, la notion d’autogestion généralisée qui figure dès le premier numéro, comme « idée force d’une reconstruction socialiste fondée sur la démocratie ouvrière ». Car, selon Jean Duvignaud paraphrasant Georges Gurvitch, il s’agissait de « l’aspect que revêt dans les sociétés historiques et les pays industrialisés la liberté collective créatrice de valeurs, d’œuvres, de participation et d’actions nouvelles »3. Georges Gurvitch, en effet, fut largement l’inspirateur d’Autogestion dont le premier numéro, presque sous forme d’hommage, parut au lendemain de sa mort et contient plusieurs écrits de sa plume, un peu pompeusement baptisés « extraits de l’œuvre ». Les discussions avaient démarré dans le train entre Georges Gurvitch, Daniel Guérin et Jean Bancal au retour d’un colloque Proudhon qui s’était tenu à Bruxelles en novembre 1965.
C’est au programme initial qu’on peut mesurer le chemin parcouru, mais les bilans d’étape ont été multiples : celui de la première décennie (jusqu’au n° 37-38, en 1977), celui de la première série, lorsque Autogestion et Socialisme quitte Anthropos pour paraître chez Privât, celui des cinq premières années de la nouvelle série (1980-1984) sous forme d’index, tandis qu’était prévu celui du vingtième anniversaire qui n’a jamais paru. Le premier où divers membres du comité de rédaction exposent leur vision des accomplissements et des manques est le plus révélateur en ce qu’il amorce aussi un changement d’orientation. L’histoire occupait encore une grande place dans le programme annoncé. Elle figurait tout aussi bien du côté de l’analyse théorique des grands précurseurs tels que Charles Fourier (n° 20-21 en particulier), Joseph Proudhon, Mikhaïl Bakounine, considérés par les fondateurs comme les pères de l’autogestion, que du côté des expériences du passé, des soviets en URSS après Octobre, des conseils ouvriers en Allemagne, en Europe centrale et en Italie après la Première Guerre mondiale, des commissions ouvrières dans l’Espagne de 1936 jusqu’au passé plus récent des conseils ouvriers en Pologne. Il était également prévu de faire des expériences contemporaines — autogestion yougoslave, algérienne, kibboutzim en Israël — des objets d’analyse tandis qu’une place de choix devait être réservée aux problèmes et débats théoriques d’actualité. À la rubrique « Histoire » figure en outre un numéro consacré à la commémoration du centenaire de la Commune de Paris en 19714, mais au fil du temps, elle allait disparaître comme si s’étaient épuisés les enseignements qu’elle était susceptible de fournir, même revisitée à la lumière de l’actualité, même irriguée par de nouveaux courants méthodologiques mis en œuvre pour l’histoire du mouvement ouvrier. Dans le bilan des dix premières années, à côté de ceux qui souhaitent maintenir le cap, voire approfondir les investigations dans les domaines préalablement définis, se manifestent des volontés de changement dont, curieusement, Pierre Naville, interrogé par Yvon Bourdet, s’est fait le porte-parole, souhaitant « que la revue donne désormais moins d’importance aux rappels historiques ou aux recherches philosophiques ». Ce sont alors les prémisses du virage vers la sociologie à la faveur de la grande vague (vogue ?) des « nouveaux mouvements sociaux » : la revue entérine elle aussi, avec un certain retard en l’occurrence, ce qui est dans l’air du temps et se fait plus attentive à ce que Jacqueline Pluet a appelé « la grande oubliée des programmes révolutionnaires […], la vie quotidienne ». Il peut paraître paradoxal que ce soit précisément lors du tournant que j’aie été amenée à collaborer au comité de rédaction, pas vraiment es qualités, c’est-à-dire en tant qu’historienne, puisque ce furent essentiellement mes compétences de germaniste qui furent sollicitées, même si le changement d’orientation d’Autogestions a contribué à élargir mes propres horizons.
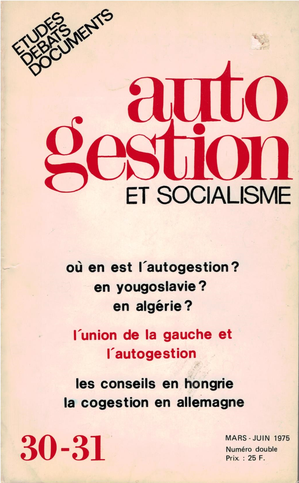
Parmi les expériences autogestionnaires contemporaines, une seule a été examinée constamment pendant les vingt années d’existence de la revue : celle de la Yougoslavie (voir en particulier le numéro 8 en 1969). Yvon Bourdet a avancé de façon convaincante qu’elle avait été instaurée, par un déplacement d’accentuation, pour contribuer à apaiser les conflits nationaux. Dans ce registre, il a également établi des liens entre l’autogestion et l’autonomie nationale culturelle telle qu’elle était préconisée par les austro-marxistes, Otto Bauer en particulier, et qui présuppose, elle aussi, que l’administration des affaires politiques et culturelles soit prise en charge par les intéressés eux-mêmes, constitués en groupes nationaux. Parallèlement, trois membres du comité de rédaction, Yves Person, Yvon Bourdet et moi, collaborions à la revue Pluriel-débat (1975-1983), consacrée aux relations interethniques, à la question nationale et aux problèmes de minorités : nous en avons écrit l’oraison funèbre, Yvon Bourdet et moi (n° 16, 1984). Un autre austro-marxiste, Max Adler, fut d’ailleurs convoqué par Yvon Bourdet dans ses réflexions sur le système des conseils.
L’autogestion yougoslave fut examinée jusque dans ses impasses, car, sous un système de parti unique, la Ligue des communistes, la démocratie n’était pas au rendez-vous comme l’attestaient, entre autres, l’émergence d’une contestation étudiante en 1968 puis d’une dissidence culturelle semblable à celle des autres pays de l’Est, fut-elle un peu plus tolérée5. En ce qui concerne l’autogestion en Algérie, instaurée par Ben Bella et présentée dans le troisième numéro de la revue par Michel Raptis qui fut son conseiller, elle n’a pas résisté longtemps, on le sait, aux luttes de pouvoir qui ont suivi l’indépendance et n’a survécu qu’un temps dans l’agriculture. Quant aux kibboutzim, le militantisme et l’égalitarisme des pionniers a été mis à mal par le développement du capitalisme, les nouvelles vagues d’immigration, l’état de guerre permanent.
Dans les entreprises yougoslaves, un « conseil ouvrier » était élu par l’assemblée générale parmi des candidats présentés essentiellement par la Ligue des communistes ou ses organisations satellites. Ce système se doublait « d’unités de travail » chargées d’organiser la production dans l’entreprise. Ainsi le contrôle de gestion et l’organisation du travail étaient-ils confiés à des organes séparés. Sur le plan politique, l’autonomie accordée aux communes associées aux conseils ouvriers fut battue en brèche par le poids massif de la Ligue des communistes au sein des conseils communaux qui compensait la composition plus hétérogène des conseils ouvriers.
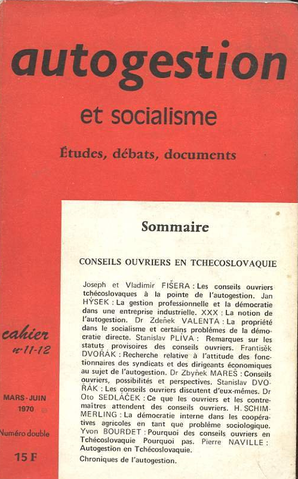
Cependant, c’est justement dans le domaine économique que se sont fait jour deux obstacles apparemment contradictoires, l’un en Yougoslavie, sous forme d’égoïsme d’entreprise, posant la question de l’équilibre entre secteurs de pointe et secteurs traditionnels plus poussifs et, par conséquent, celle du degré de planification nécessaire et de la possibilité de l’assurer en réseau, interrogation (« planification et autogestion ») qui figurait d’ailleurs dans le programme initial de la revue. La logique redistributive, à l’œuvre également entre les Républiques, n’a permis de souder la Fédération que provisoirement, chacune des nations de la Yougoslavie se sentant finalement lésée par rapport aux autres et entravée dans son développement.
L’autre écueil qu’ont révélé à la fois les kibboutzim et, plus tard, les mouvements alternatifs en Allemagne et en Suisse, c’est celui de l’auto-exploitation, avatar de la critique de la société de consommation formulée par le mouvement étudiant de la fin des années soixante et ses maîtres à penser.
Mai 1968 a suivi de près l’apparition d’Autogestion qui, quasiment prise à contre-pied, a néanmoins tenté de se situer au cœur de l’événement et de lire les mouvements sociaux induits par la révolte. L’expérience des Lip permit une observation pour ainsi dire in vivo, toujours du côté de la démocratie industrielle. Elle sembla en tout cas apporter la preuve de la grande actualité de la thématique. Mais ce fut surtout en Italie et en Allemagne que s’inventèrent de nouvelles pratiques sociales susceptibles d’enrichir la réflexion et le modèle : comités de quartier, collectifs d’habitation, crèches autogérées, initiatives de citoyens, pour ne citer que quelques exemples, furent autant de preuves de la vitalité de la société face à l’État, d’expériences de l’autogestion au quotidien. Les années soixante-dix ont été ainsi, pour la revue, riches de « grain à moudre », fourni aussi, sur un autre plan, par la « révolution des œillets » au Portugal.
Plus traditionnels, les conseils ouvriers en Tchécoslovaquie, pour éphémères qu’ils aient été à la fin des années soixante, ont néanmoins retenu l’attention, grâce, en particulier, à Joseph Fisera qui fut l’un des piliers de la revue6. En Pologne, en revanche, l’intérêt se déplaça vers cette forme de syndicalisme révolutionnaire combinant revendications politiques et syndicales, qu’incarnait Solidarnosc7.
Si en 1970, le titre s’était transformé en Autogestion et socialisme pour lever toute ambiguïté et signaler l’ancrage à gauche, il apparut à la fin de la décennie que la marche du PS vers le pouvoir étant entamée, l’ajout pouvait apparaître comme un signe d’inféodation. C’est donc au nom du pluralisme que, passant des mains d’Yvon Bourdet à celles d’Olivier Corpet, la revue déclina désormais son nom au pluriel. Pourtant, de multiples tendances avaient toujours cohabité en son sein, du socialiste Robert Chapuis, futur ministre, au trotskiste grec Michel Raptis (Pablo), un des chefs de file de la 4ème Internationale, en passant par les anarchistes, ces derniers revendiquant sans cesse une part de paternité dans l’émergence de la revue et invoquant la référence à Noir et Rouge, en plus de Socialisme ou barbarie. La confrontation interne entre anarchistes et marxistes critiques traverse la première série. Je voudrais d’ailleurs ouvrir ici une parenthèse : à vingt ans de distance, les numéros qu’Autogestion et socialisme et L’Homme et la Société ont consacrés à l’anarchisme ont affiché les meilleurs chiffres de vente. Ringards, les débats d’opinion ?
La réorientation de la fin des années soixante-dix fut aussi un recentrage vers l’actualité. Désormais, il s’agissait de débusquer les expériences d’autogestion même là où, à première vue, leur existence était insoupçonnable. Après s’être intéressée aux États- Unis, à l’Afrique Noire (Yves Person) à la fin de la première série, la revue alla visiter des terrains aussi exotiques que le Chili ou le Pérou (sous les auspices d’Albert Meister qui avait auparavant étudié l’autogestion yougoslave), voire le Japon. C’est dire que les préoccupations débordaient largement — et constamment — le cadre de l’hexagone. Mais en même temps, l’État passait à l’arrière-plan des interrogations pour mieux faire ressortir l’inventivité sociale.
Bref, fidèle dans une large mesure à son programme initial, Autogestion, Autogestion et socialisme, Autogestions fut tout au long de son existence un observatoire des mouvements d’émancipation. Après l’arrivée de la gauche au pouvoir, la fortune du terme et de l’idée amorça une décrue rapide. Pour preuve, le faible retentissement auprès des principaux intéressés, des lois Auroux, censées mettre en marche la démocratisation du fonctionnement des entreprises8. Il est vrai que toutes les expériences de démocratie industrielle se sont heurtées aux réticences des syndicats, soucieux d’assurer leur représentativité hégémonique dans l’entreprise et de préserver leurs prérogatives (comme l’atteste l’exemple de l’Allemagne révolutionnaire au lendemain de la Première Guerre mondiale). Peu à peu, le terme disparut du vocabulaire politique où il avait pénétré jusque dans le PC. Qui a peur de l’autogestion ?9se demandaient dès 1978 les collaborateurs de la revue. L’essoufflement des mouvements sociaux finit par rejeter — provisoirement ? — l’autogestion dans les célèbres « poubelles de l’histoire » et porta un coup fatal à la revue elle-même.
Le tableau ne serait pas complet, toutefois, si n’était pas mentionné le conflit qui a éclaté à la veille de la disparition de la revue. En dehors de la conjoncture politique et des contraintes institutionnelles — dissolution, après sa mort, du laboratoire de Raymond Aron dont faisait partie le Groupe d’étude de l’autogestion, départ à la retraite d’Yvon Bourdet — ce sont les principes d’un fonctionnement autogéré de la revue elle-même qui ont fourni matière aux affrontements. La critique des institutions, du fonctionnement peu démocratique des organisations de gauche, y compris celles qui se réclamaient de l’autogestion, occupe une place importante dès 1978 et dans la seconde série. Il était donc logique que la revue soumît son propre fonctionnement à cette même critique, d’autant plus qu’elle s’était interrogée sur l’autogestion de la recherche et la fonction de l’expertise. Or, sous couvert de s’opposer au dirigisme d’Olivier Corpet, le groupe d’analyse institutionnelle de l’Université de Vincennes (à Saint- Denis), très présent et très actif dans les numéros consacrés à l’autogestion existentielle — le logement, mais surtout l’enseignement10, etc. — a tenté d’appliquer ses méthodes au fonctionnement de la revue dans lequel il était directement impliqué, engageant ce qui ressemblait à s’y méprendre à une prise de contrôle. Forcément douloureux, ce conflit a, lui aussi, contribué à l’obsolescence de la revue : les institutions ne sont-elles pas mortelles ? pourrait-on se demander avec René Lourau ou Rémi Hess. Une fois l’expérience close, elle apparaît désormais comme ce qu’elle ambitionnait d’être : une encyclopédie de l’autogestion. Pendant vingt ans, toutefois, l’autogestion comme figure du mouvement d’émancipation et son analyse s’étaient mutuellement enrichis.
1 Pour les différents noms cités dans ce texte, voir les biographies dans le Maitron : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
2 Centre national de la recherche scientifique.
3 Autogestion n°1, décembre 1966.
4 Autogestion et socialisme n°15, mars 1971.
5 Autogestions n°6, 1981.
6 Autogestion et socialisme n°11 et 12, mars-juin 1970.
7 Autogestions n°5, 1981.
8 « L’entreprise, du muet au parlant », Autogestions n°14, 1 983
9 Editions UGE, 10/18, 1978.
10 Voir ? en particulier : Autogestions n° 12-13, 1982.
- La revue Autogestion : observatoire des mouvements d’émancipation - 13 septembre 2019
