Quatre métallurgistes dans Mai 68 – A Billancourt et dans le 18ème…
En mai 68, à 44 ans, je travaille comme ouvrier aux usines Renault de Billancourt et me trouve au cœur de ce mouvement de grèves et de manifestations qui dura quelques semaines. En plus d’être syndiqué à la CFDT et délégué du personnel, j’ai appartenu pendant 15ans au groupe marxiste qui publia la revue Socialisme ou Barbarie1(jusqu’à sa dissolution en 1965) dont les idées seront en partie reprises par les étudiant.es, notamment par le Mouvement du 22Mars2.Ouvrier d’une grande usine en grève, muni d’une culture marxiste et donc familier des slogans révolutionnaires, je disposais apparemment de tous les éléments du parfait soixante huitard.Pourtant je n’ai pas été un authentique soldat de 68, période,qui, représente pour moi le plus significatif rendez-vous manqué entre les intellectuel.les de gauche et les étudiant.es révolutionnaires d’une part et le monde du travail de l’autre.
Injonction paradoxale

Au terme de ces quelques semaines, je constatais que la culture révolutionnaire et surtout la critique de ses dérives totalitaires que j’avais acquise n’avait d’utilité que dans des discussions de salons tandis qu’elle ne m’était d’aucun secours ni dans mon entreprise en grève ni dans mon quartier du 18èmearrondissement.Cette brève période représente l’échec de ma tentative de mettre en pratique l’alternative d’une gestion démocratique de l’entreprise, idée que je partageais avec mes camarades de la CFDT, mais qui restait inaudible auprès de la CGT et des ouvrier.es qui aspiraient à des choses bien plus terre à terre, notamment,l’élévation de leur salaire qu’ils et elles avaient obtenus jusqu’ici par l’intermédiaire des syndicats sans s’impliquer davantage que par des débrayages intermittents et de sages et ludiques manifestions de rue dans la capitale au slogan bon enfant :« Des sousCharlot3 ». Bien que partageant ces revendications, j’aspirais à une plus grande implication des salarié.es dans les décisions de leur entreprise. Participer à la gestion de l’usine comme je le leur proposais, ne déclenchait pas leur hostilité mais les rendait totalement incrédules quant aux conséquences les concernant,d’autant plus que lorsqu’ils ou elles me demandaient plus de détails pour arriver à cet état de chose, je n’étais capable que de leur dire que c’était à eux d’inventer le mode d’emploi.Les exhorter à avoir une idée qu’ils et elles n’avaient pas eux-mêmes et se refusaient à envisager était l’injonction paradoxale dans laquelle je me suis trouvé prisonnier pendant ces quelques semaines. Les brèves tentatives d’avoir voulu relier ces deux statuts – délégué et syndiqué d’un côté et militant d’avant garde de l’autre, me conduisaient inexorablement à n’être compris ni de mes ami.es révolutionnaires pour lesquels je devins infréquentable, du moins dans cette période, ni de mes collègues de travail qui ne voyaient pas pourquoi ils et elles s’investiraient eux-mêmes dans les procédures démocratiques que je leur proposais puisqu’ils et elles estimaient que nous, les militants qu’ils et elles élisaient démocratiquement tous les ans, étaient plus compétents et motivés pour le faire à leur place.
La grève à Renault Billancourt
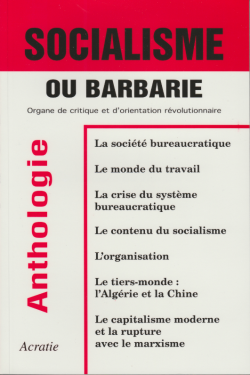
Elle ne s’est pas déclenchée spontanément ; elle avait été préalablement préparée par l’agitation d’un groupe de militant.es et sympathisant.es gauchistes et a bénéficié d’un hasard de circonstances. La CGT, organisation syndicale largement majoritaire dans l’entreprise, était, certainement, pour des raisons plus stratégiques qu’idéologiques, hostile à son déclenchement ou du moins désirait avant tout maîtriser la totalité de sa dynamique.
Le16 mai, à la reprise de l’équipe de l’après midi, la CGT organise un meeting où ses orateurs expliquent que les revendications étudiantes n’ont pas de rapport avec les revendications des salarié.es et que le syndicat décidera du meilleur moment pour appeler à l’action. Une partie non négligeable du public présent au meeting s’insurge devant le refus des syndicats à lancer le mot d’ordre de grève et le fait savoir aux orateurs par des invectives. Etant parmi les protestataires, beaucoup se tournent vers moi en tant que militant CFDT et délégué du personnel pour que je m‘exprime à l’estrade.Poussé par un mouvement de foule, je me saisis du micro. Par chance,le groupe CGT qui s’occupe de la logistique coupe la sono, sans pour autant m’empêcher d’être entendu. Si bien que mon propos,portant les stigmates de l’oppression, n’a plus besoin des mots pour convaincre qu’il faut faire le contraire de ce que veulent mes censeurs, c’est à dire faire débrayer l’usine. Des voix s’adressent à moi en me donnant l’injonction d’aller arrêter tous les ateliers de l’usine. C’est ainsi que pendant plus de deux heures, je vais à la tête d’un groupe d’une cinquantaine d’ouvriers faire débrayer les secteurs les plus récalcitrants,notamment les chaînes de montage et les ateliers de fabrication en série où les ouvriers, majoritairement immigrés, ne veulent pas nous obéir. Pour eux, je le présume, cela apparaît être une histoire qui concerne les blancs, leurs problèmes sont ailleurs. Le capitalisme français ne leur paraît pas si abominable que les tracts radicaux le présentent, il est vécu comme une opportunité leur permettant de nourrir leur famille élargie au delà de l’Hexagone. Jamais ils n’auront la parole et ne seront représentés ni chez les étudiant.es, ni par les organisations syndicales. La spécificité de l’immigration comme main d’œuvre particulière qui espère retourner au pays n’apparaît pas en 68 comme un problème.
Avec le concours d’autres groupes qui s’étaient formés dans d’autres départements, nous opérons de manière plus ou moins démocratique à la paralysie de la totalité de l’usine. Mais entre temps, la CGT, ayant modifié sa stratégie, a décidé de lancer officiellement le mot d’ordre de grève en plaçant tous ses militant.es aux portes, pour en contrôler les flux et éviter que les étudiant.es y pénètrent. A la tribune de la passerelle de l’île Seguin, les leaders de la CGT acceptent de me donner la parole comme représentant de la CFDT. N’ayant pas préparé de discours, j’improvise en disant à plus d’un millier de grévistes que, puisque nous occupons l’entreprise et que nous prouvons nos capacités à la faire fonctionner, désormais elle nous appartient.Je ne pensais pas vraiment avoir résolu le problème de l’autogestion en disant cela mais je ne pouvais pas non plus ne rien dire sur la question pour laquelle nous avions passé beaucoup de temps à débattre et à réfléchir, autant dans la revue Socialisme ou Barbarie qu’à la CFDT. Ce n’est pas une surprise de révéler que, autant les discours bien formatés de mes collègues de la CGT furent accueillis avec enthousiasme, autant mes propos suscitèrent peu d’applaudissements. Je n’étais visiblement pas le leader du moment. Quelques jours plus tard, mes collègues de travail se moquèrent amicalement de moi en faisant une analyse critique de mon propos. Je leur dois beaucoup d’avoir ainsi participé efficacement à ma déniaiserie. Ce sera la dernière fois que je pourrai parler publiquement dans l’usine ; jamais plus la CGT ne me laissera m’exprimer pendant le conflit. A l’intérieur de l’usine,chaque fois que je voudrai intervenir publiquement, je serai entouré de plusieurs colosses qui m’en empêcheront en m’insultant.
Le lendemain matin du 17 mai, après avoir dormi dans l’atelier et tandis que nous nous réchauffons derrière les grilles de la rue Emile Zola, autour des braseros, un groupe d’étudiants trotskistes de la FER4,en rangs serrés, sur quatre colonnes et au pas cadencé, chantent l’Internationale et la Varsovienne, refaisant ce que les milices bolcheviques firent en Octobre 1917 à Saint-Petersboug. Je compris alors que 68 ne serait pas le coup de fouet démocratique que j’espérais mais que ces évènements s’annonçaient comme une réédition de la révolution léniniste mais, cette fois, heureusement, comme une mascarade. Celle-ci eut du moins la capacité d’étonner les ouvriers encore endormis qui auraient pu penser au tournage d’un film plus qu’à un événement correspondant avec leur action, somme toute banale, d’occuper l’usine. Ces étudiants voulaient imiter leur grand père en nous rabâchant dans leurs tracts ce qui m’avait servi de culture politique sous l’ Occupation et que j’avais abandonné après la guerre, au cours de la critique du léninisme que nous faisions avec mes amis de la revue Socialisme ou Barbarie et d’une manière plus militante avec mes camarades de la CFDT.
Je constatais que toute critique du bolchevisme que nous avions faite pendant 15 ans dans la revue ne s’était pas propagée, les étudiant.es étaient revenus 50 ans en arrière. J’étais particulièrement effaré de voir les slogans qui fascinaient le mouvement étudiant comme « Le pouvoir est au bout du fusil »,ainsi que les formations maoïstes de la gauche prolétarienne défilant derrière les portraits de Staline et de Mao. La mystique révolutionnaire avait eu le pouvoir de rassembler les frères ennemis, léninistes de tout poil avec les libertaires qui communiaient dans la même ferveur révolutionnaire. Les discours révolutionnaires étaient les seuls qui puissent s’exprimer à la Sorbonne ou à Nanterre. Une fois, dans un de ces amphithéâtres,ayant apporté une note discordante sur les opinions très modérées des ouvriers de l’usine occupée, s’inquiétant par exemple des avoir quand ils toucheraient leur paye, inquiétude aussi légitime me concernant, je me fit huer. Les étudiant.es n’attendant pas la paie de la quinzaine pour subsister, leur problématique pouvait prendre d’autant plus de hauteur avec les mesquineries du quotidien. Mon interdiction de parole dans l’entreprise, s’étendra à l’université où, pourtant, mes anciens amis de Socialisme ou Barbarie y faisaient un tabac.
Occuper une usine est beaucoup plus ennuyeux que d’y travailler, surtout quand les débats critiques y sont interdits. C’est pourquoi je séchais mes nuits et mes jours d’occupation de Billancourt, permettant au service d’ordre de la CGT de cesser ma surveillance.
Le comité d’action
Dans le 18èmearrondissement nous avions réussi, avec un groupe d’associations,depuis deux ans, à implanter une Maison de jeunes et de la culture (MJC), Place des Abbesses. Celle-ci fut très vite secouée par les événements de mai ; y affluèrent des gens du quartier et de la paroisse ; d’autres s’y joignirent et y furent accueillis avec bienveillance. La MJC institua ainsi un Comité d’action du18èmequi se fixa comme objectif d’aider les salariés grévistes de l’imprimerie Laugier de la Place Jean-Baptiste Clément. Les membres du Comité d’action allaient les encourager et leur apporter le fruit de quêtes et des produits alimentaires que certain.es trouvaient à se procurer auprès d’agriculteurs.
L’activité politique du Comité ne s’arrêtait pas là, elle consistait surtout en des discussions autour de la problématique de l’action :comment le comité pouvait-il apporter un soutien efficace au mouvement ? Les réunions qui débutaient vers 20 heures avaient pour objectif de répondre à cette question, en publiant un tract portant le sceau du Comité qui était ensuite distribué par ses membres. La rédaction des tracts s’effectuait démocratiquement par tous ceux et toutes celles qui étaient présent.es sans qu’ils ou elles justifient leur appartenance au quartier ni même à l’arrondissement. Bientôt on constatait que le noyau des riverains était devenu minoritaire par rapport à des nouveaux venus qui débordaient d’enthousiasme révolutionnaire sans qu’on sache d’où ils venaient ni ce qu’ils faisaient. Comme la nouvelle morale politique était de ne rien interdire, personne n’aurait osé les interpeller sur la légitimité de leur appartenance au Comité sans risquer de se faire traiter de réac.Il suffisait d’avoir des propos favorables au mouvement, pour y être accepté et applaudi. Il va de soi que s’il y avait eu éventuellement des individus qui n’y étaient pas favorables, ils et elles auraient pu tout aussi librement s’y exprimer. Comme il n’y eut pas de cas semblable, la conclusion était que tout le quartier devait être acquis au mouvement et à ses slogans. Le groupe de jeunes qui dans la MJC avaient des activités plus ciblées – les uns sur l’astronautique, d’autres sur la danse – ne participait pas aux activités politiques, exprimant tout au plus de l’indifférence sans que cela ne trouble l’unanimisme soixante-huitard.
L’affichage des convocations à l’assemblée qui devait décider du contenu des tracts mentionnait le jour et l’heure. Un seul petit détail technique eut une grande importance : l’heure du début des débats avait force de règle mais pas l’heure de la fin. Le manque de précision de l’appartenance géographique des orateurs et de l’heure de clôture de débats eut des conséquences bien plus grandes qu’on ne l’eut pu imaginer. En effet, comme la rédaction devait réunir l’assentiment de tous ou de la majorité des présent.es qui votaient le texte final, il s’avéra que celles et ceux qui avaient le plus de poids dans la rédaction du texte étaient les insomniaques qui pouvaient encore, à 3 heures du matin, être disponibles et en pleine forme pour discuter un texte dont l’ébauche avait débuté la veille à 21 heures. Il est aussi à remarquer que la distribution de l’insomnie n’était pas aléatoire et qu’elle touchait davantage les nouveaux venus que les riverains et qu’en plus de cela, l’insomnie touchait particulièrement celles et ceux qui partageaient une opinion maoïste bien identifiée. Par tout ce concours de hasards, il se trouve que la teneur politique des tracts du Comité d’action du 18èmese trouvait en cohérence avec les idées du Grand Timonier en vigueur dans la galaxie du mouvement de Mai 68.
Partagé entre des nuits passées avec mes collègues en occupation dans l’atelier 59 de l’usine Billancourt, où toute critique de la CGT était interdite, et les soirées de débats de la Place des Abbesses, mon optimisme démocratique se trouva fortement éprouvé.
Daniel Mothé.
1Voir notamment : Socialisme ou barbarie, Anthologie, La Bussière, Éditions Acratie, 2007 et Philippe Gottraux, Socialisme ou barbarie, un engagement politique et intellectuel dans la France de l’après-guerre, Lausanne, Payot, 1997.
2 Voir l’article de Jean-Pierre Duteuil dans ce numéro.
3 « Charlot » : Charles de Gaulle.
4 Fédération des étudiants révolutionnaires, groupe trotskiste de tendance « lambertiste », c’est-à-dire du courant correspondant aux actuels Parti ouvrier indépendant (POI) et Parti ouvrier indépendant démocratique (POID).
- Quatre métallurgistes dans Mai 68 – A Billancourt et dans le 18ème… - 14 novembre 2018
