Tout changer : oui !
Mais pas selon les seules aspirations patronales……
Certes le management moderne est critiqué par les syndicats qui dénoncent les dérives managériales notamment via les CHS-CT habilités à mener des enquêtes sur les conditions de travail ; il est mis en accusation en justice où le code du travail permet d’identifier des fautes inexcusables des employeurs, il est mis en scène sur un mode dramatique dans de nombreux films, documentaires, pièces de théâtre, il fait l’objet de critiques structurées par des approches scientifiques de différentes disciplines focalisées sur le travail (sociologie, psychologie, ergonomie, gestion, économie, philosophie), mais les critiques les plus violentes, les plus globales, les condamnations sans appel viennent désormais du côté des managers, des consultants, des dirigeants. Comment expliquer ce paradoxe ? Et qu’implique-t-il pour l’avenir du travail ?

Ce numéro des « Utopiques » s’intitule « Travail : changer tout ! ». Ce qui se veut une ouverture à la réflexion, pour promouvoir des modes d’emploi et de travail qui prennent en compte de manière différente les enjeux fondamentaux du travail : ceux qui renvoient à son sens, sa qualité, et donc au sort réservé aux travailleurs et travailleuses, (la prise en compte de leurs intérêts et de leurs valeurs professionnelles), mais aussi aux contraintes écologiques, au respect des consommateurs, consommatrices, et aux exigences liées à la cohésion de nos sociétés. Il vient bien à point. Car le risque est de voir la classe des dirigeants économiques et politiques préparer idéologiquement, politiquement et juridiquement la mise en place d’un mode d’organisation du travail et de l’emploi qui remet en cause certains fondements du management « moderne » (celui mis en place en contrecoup de mai 68 à partir de du milieu des années 70) au profit d’autres que l’on voit déjà émerger et qui représentent une dégradation menant à un travail plus délétère encore et des formes d’emplois plus menaçantes.
Une critique managériale du management « moderne ».
Il y a en effet une critique managériale du management moderne. Elle mérite d’être analysée. Il y a un consensus qui se dégage à travers nombre d’ouvrages récents publiés par des gourous, consultants ou dirigeants d’entreprises pour critiquer les travers du management à l’œuvre dans la plupart des entreprises.
Et ce, à partir d’une mise en cause de l’excès de bureaucratie dans l’entreprise, dans la lignée des travaux de David Graeber (anthropologue, militant anarchiste américain, qui connaît un grand succès autour de ses ouvrages sur les « Bullshit jobs »1 -les boulots à la « con »- et la « Bureaucratie2 ».). On déplore les contraintes inutiles (trop de procédures, protocoles, méthodologies, « bonnes pratiques », trop de contrôle sous forme de traçabilité et de reporting imposés et concoctés par des grands cabinets d’experts internationaux. Cela va à l’encontre du bien-être des salarié.es qui se trouvent assiégé.es, étouffé.es, nié.es dans leur professionnalité, et de leur performance. Ce management ne correspond plus, selon ce courant, à leurs aspirations pour plus d’autonomie, de possibilités de se réaliser dans leur travail, d’y prendre du plaisir, de s’y reconnaître. Ce courant développe une attaque en règle contre les efforts désespérés que le management contemporain développe pour tenter de rendre malgré tout les salarié.es heureux, en s’occupant de leur bien être. Ce ne sont que contorsions inutiles et ridicules (voir le livre de Bouzou, économiste libéral et de Funés qui connaît un grand succès3 ) qui consistent à satisfaire des besoins qui ne sont pas directement liés au travail : mise à disposition de séances de massage, jeux vidéo, confiseries. Le recours aux chief happiness officers censés prendre en charge le bonheur des salarié.es cristallise ces tentatives vouées à l’échec. Ce qui importe, pour les managers critiques dans cette perspective, c’est de permettre aux travailleurs et travailleuses de gérer, réguler eux-mêmes leur travail, pour s’y sentir à l’aise tout en étant efficace. Ce qui importe, c’est de laisser se déployer le travail réel et de ne pas miser exclusivement sur le travail prescrit qui ne permet pas aux travailleurs et travailleuses d’être performant.es et adapté.es à des situations de travail fluctuantes et imprévisibles. Il faut de la fluidité, de l’agilité et ne pas laisser les prescriptions rigidifier les capacités d’adaptation et la réactivité. Ce courant managérial a bien compris l’importance de la distinction analysée par les sociologues et ergonomes entre travail réel et travail prescrit. Le travail réel correspondant aux savoirs, connaissances, initiatives et pratiques mobilisées et déployés par les travailleurs et travailleuses pour parvenir à exécuter leur tâche malgré les prescriptions imposées par la hiérarchie et l’organisation du travail, ou trouvant à composer avec elles.
Il n’y a pas lieu de contester cette critique managériale du management moderne. Elle met bien en évidence ses aspects contreproductifs ainsi que ses aspects délétères qui mènent au burn out comme au bore out, aux risques psychosociaux, au mal-être, à la souffrance et aux suicides au travail. Mais si l’on s’y intéresse de près, on prend conscience que derrière cette critique, et prenant appuie sur elle, se profilent des « solutions » qui risquent d’aggraver encore plus la situation des travailleurs et travailleuses sur le plan du travail comme de l’emploi. C’est à cette situation inquiétante que notre société est d’ores et déjà confrontée. Nous sommes à un véritable tournant : la critique du management est forte, elle est largement partagée par différentes parties prenantes de cette société, mais des stratégies bien construites, qui se nourrissent et se légitiment de cette critique désormais consensuelle, sont déjà là qui construisent un monde du travail plus inquiétant encore, alors que peinent à émerger du côté des travailleuses et travailleurs des contre modèles convaincants. Je ne ferai donc pas dans ce court texte une énième critique de l’organisation du travail et du management délétère, que j’ai déjà développé ailleurs4, mais je me concentrerai sur une analyse des « solutions » présentées comme disruptives et porteuses d’avenir par leurs promoteurs. Elles sont essentiellement de deux ordres, il y a celles qui se manifestent sous la bannière des « Entreprises libérées» et celles qui prétendent libérer l’emploi, en tournant le dos au salariat pour faire place au travail indépendant.
Entreprises « libérées » par leur patron : un nouveau salariat de confiance ?
Il existe en effet des « entreprises libérées » et elles ont des émules : les entreprises en voie de libération, les entreprises responsabilisantes (entreprise Michelin), concertatives, (entreprise Hervé), horizontales …Il s’agit de grandes entreprises, de PME ou de Mutuelles, voire de Ministères, comme l’a mis en scène le documentaire « Le bonheur au travail » produit par Arte5. L’idée de base, est qu’il faut faire confiance aux salarié.es, ce qui permet de les laisser déployer un travail réel efficace et ajusté aux nécessités, mais qui plus est, de leur faire prendre en charge d’autres missions qui étaient auparavant réservées à l’encadrement intermédiaire. Déployer un travail réel qui mobilise au mieux les savoirs et l’expérience : rien de vraiment nouveau pourtant, c’est l‘approche Toyotiste, qui n’a jamais été appliqué selon les tenants de la libération des entreprises. On comprend l’esprit qui les porte en lisant leur gourou, Isaac Getz, notamment dans le livre qu’il a co-écrit avec Brian M Carney6 : « Toyota organise donc ses pratiques de gestion en partant du principe que les procédures standard sont la meilleur façon connue d’accomplir une tâche donné – mais que les salariés de base savent mieux que quiconque ce qui fonctionne réellement. Autrement dit, on propose aux salariés de Toyota des manières efficaces de faire leur travail, mais on ne les oblige pas à continuer à les appliquer s’ils découvrent une meilleure méthode. Et au lieu d’employer les instruments de contrôle habituels, Toyota fournit à ses salariés des instruments d’auto contrôle. C’est une différence de taille avec ce que vit la main d’œuvre dans la plupart des grandes entreprises. » (p 51).
On a là le postulat de la libération des entreprises (décrétée, rappelons-le, par le dirigeant de l’entreprise et on peut lire avec intérêt les livres produits par des patrons libérateurs comme Alexandre Girard7 (Chronoflex) ou Jean-François Zobrist (Favi)8 : une prise de conscience que les salarié.es savent mieux faire sur le terrain que leur hiérarchie et leur direction. La litanie que l‘on entend dans la bouche (il y a beaucoup de grandes messes organisées par ce courant) et que l’on peut lire dans les écrits des patrons libérateurs, est « nous ne savons pas tout, soyons modeste, il faut reconnaître que les salarié.es savent faire et savent comment faire ». Reprenant une expression d’Yves Clot psychologue du travail, ils proclament, « il faut leur redonner le pouvoir d’agir ». Ils préconisent donc le principe de subsidiarité. Les manières de travailler doivent se penser localement, face aux impératifs et aléas du travail et non en fonction de règles décidées hors sol. Les règles dans le management moderne « ne se bornent pas à saper le moral des salariés ; elles empêchent la grande majorité d’entre eux de faire ce qui conviendrait » écrivent ainsi Getz et Carney. (p20). Leur cible est donc en permanence le moral de leurs salarié.es, pour que ceux-ci et celles-ci se mobilisent de façon performante. Mais, bémol non insignifiant, toujours selon les orientations définies unilatéralement par leur dirigeant, leur leader qui est porteur d’une « vision », laquelle définit des objectifs pour son entreprise en termes de positionnement sur le marché, d’efficacité et de rentabilité. Les salarié.es doivent s’imprégner de cette vision, l’intérioriser et la mettre en œuvre du mieux qu’ils et elles peuvent, en bénéficiant d’une certaine autonomie, qui lorsqu’elle n’est pas toujours concrètement possible et réelle doit leur paraître pourtant toujours présente. L’impression d’autonomie est toute aussi importante que sa réalité pour le moral des salarié.es et l’efficacité de leur travail. Comme en témoignent ces lignes toujours tirées du livre de Getz et Carney (p68 ) : « Quand un individu a l’impression de jouir d’un degré de contrôle important sur un événement ou une situation, il le juge moins stressant et peut même y voir un défi. (…) Par exemple, face à un afflux soudain de clients, une vendeuse qui a l’impression de bien contrôler son travail aura confiance en elle ; elle se dira qu’elle va trouver le moyen de s’adapter et de gérer cette charge supplémentaire. De sorte que ses émotions loin de devenir négatives, peuvent même lui inspirer une impression positive de défi à relever. (…) Trois psychologues, Hans Bosma, Stephen Stanfeld et Michael Marmot, ont passé cinq ans à étudier les niveaux de stress de plus de dix mille fonctionnaires britanniques. Et ils ont découvert que les hommes qui ont l’impression –à tort ou à raison –d’exercer peu de contrôle sur leur emploi ont 50% de risques en plus de souffrir de troubles cardiaques ». Tout est dans l’art et la manière : « Lee Ozley, spécialiste du conseil en entreprise à expliqué à Teerlink (Harley Davidson) et à son équipe que si l’on impose quelque chose aux gens, ils freinent des quatre fers – alors qu’ils l’accepteraient peut-être de bon cœur s’ils avaient l’impression de l’avoir décidé d’eux-mêmes. C’est une idée que Teerlink allait faire sienne et qu’il répéterait fréquemment » (p133).
La libération et l’ouverture jouent beaucoup sur le champ psychologique et idéologique. Les salarié.es doivent croire en leur leader libérateur, en sa vision, ils doivent se constituer en followers : « Communiquer et faire partager la vision de l’entreprise est un des rôles clés d’un leader libérateur. Il s’agit de la deuxième pierre angulaire de la liberté. (…) Si le leader ne joue pas ce rôle, certains risquent d’en revenir à ce qu’eux-mêmes jugent préférable en fonction de leur expérience. (…) Ce ne sont pas des expériences personnelles ni les conditions du moment qui doivent dicter le choix de la mesure la plus audacieuse, celui-ci doit répondre à un unique impératif : réaliser la vision de l’entreprise. » (p99). D’ailleurs, il est relevé par Getz et Carney que la liberté donnée aux salarié.es qui doivent être désormais considéré.es comme des égaux, est déclarée dans certains domaines et pas d’autres selon les entreprises. Ainsi, « L’ouverture est donc la règle chez Richards Group à une exception près : la rémunération. Dans cette agence discuter de sa paie avec ses collègues est un motif de licenciement ». ( …) « Mais la satisfaction de leur besoin d’auto direction ainsi que de leurs besoins de respect et de développement assure à la fois de meilleurs résultats pour l’entreprise et le bonheur des salariés. » nous assure-t-on. Dans telle autre, « un retard de quelques minutes sera sévèrement sanctionné parce que l’entreprise travaille avec des clients qui sont en décalage horaire et qui ont des rendez vous précis » (p 283).
Mais si les salarié.es libéré.es intègrent bien la vision, (à la différence d’autres qui auront du mal à le faire et se verront libéré.es d’une autre manière….par un départ volontaire ou un licenciement) on pourra leur demander de s’auto-manager, s’auto-motiver, s’auto contrôler et s’auto discipliner. Ils et elles le feront individuellement et au sein d’équipes pluridisciplinaires qui seront le cœur de l’entreprise. Ces équipes qui choisissent leur animateur ou animatrice parmi eux ou elles, auront à assumer des tâches relevant des Ressources Humaines (y compris le recrutement), du domaine commercial voire financier. Cela permet à l’entreprise d’économiser car elle se passera des cadres de proximité, cadres intermédiaires et de certaines fonctions supports, sans pour autant tomber dans l’anarchie. Pour Bob Koski de Sun Hydraulics « comme pour d’autres leaders libérateurs, liberté n’était pas synonyme d’anarchie ; c’était au contraire un environnement hautement orchestré et discipliné qui cherchait à utiliser les forces et l’intelligence du personnel » (p 120). La vertu, sinon l’astuce de ce modèle, est de vouloir transformer l’ensemble des salarié.es en salariat de confiance, qui était auparavant représenté par la catégorie peu fournie des cadres. Jusque dans les années 60, les cadres pouvaient être analysés comme relevant d’un rapport de confiance avec la direction, comme le développe Paul Bouffartigue dans ses travaux9. Ce rapport spécifique se caractérisait par la confiance manifestée par la direction, à travers la rétrocession d’une parcelle de son pouvoir et d’une délégation d’autorité. Et en retour, par la confiance sous forme de loyauté que lui assurait le cadre. Au cœur de cette relation, la promesse d’une carrière sous forme d’un parcours promotionnel assuré. Depuis les années 80, le nombre des cadres ne cesse de progresser de façon spectaculaire, en même temps que se dégradent leurs conditions et le contenu de leur travail. Ils sont de plus en plus soumis aux contraintes de procédures, protocoles et reporting, aux dispositifs de fixation d’objectifs unilatéralement imposés et d’évaluations hiérarchiques. Les carrières, de fait, sont plus limitées. Leur loyauté se redéfinit alors : elle s’adresse moins à leur direction, leur entreprise qu’à leurs propres valeurs professionnelles et personnelles et leur volonté de progresser. Le courant des entreprises libérées opère ainsi un déplacement et se détourne d’une partie des cadres, notamment intermédiaires, pour tenter de retrouver avec tous les salarié.es une relation de confiance basée sur une délégation de parcelles d’autonomie en contrepartie d’une loyauté totale. Mais les bénéfices sont moins évidents. Ils sont, nous dit-on du côté du bien-être, de la qualité du moral, de l’esprit d’équipe, du sentiment de liberté, du plaisir de s’identifier à une vision et un leader, de la possibilité d’adapter des règles et des procédures pour mieux faire son travail.
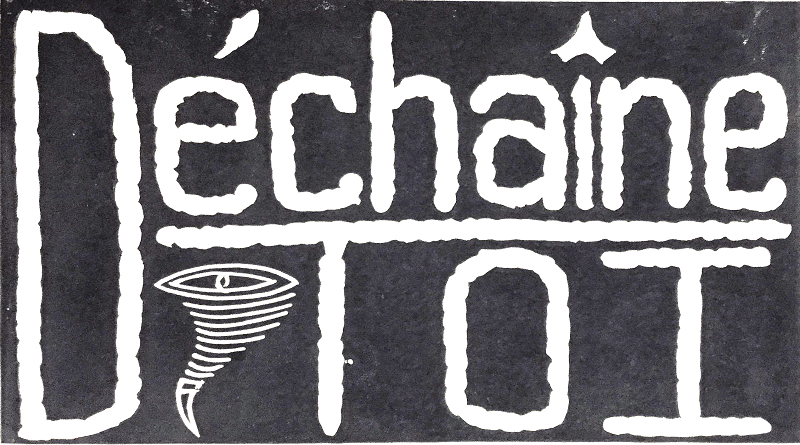
Ceux qui s’inquiètent et se posent des questions sont une fois de plus du côté des consultants, responsables DRH et dirigeants. Un petit panel d’entre eux se sont unis pour une contre offensive. Sous le titre d’un texte intitulé: « Entreprise libérée, la fin de l’illusion10 » ceux qui se présentent comme les « Mécréants » dénoncent cette remise en cause unilatérale par des patrons de leur anciens soutiens et relais. Ils considèrent qu’il y a là comme une imposture à vouloir parler de libération, alors qu’il y a élimination d’une couche de « compétents » que l’on empêche désormais de travailler et qui tiennent pourtant un rôle fondamental ; celui de porter une responsabilité et autorité en matière de cadrage des salarié.es, de résolution de problèmes et difficultés entravant le travail individuel et d’équipe. Les « Mécréants » mettent en évidence, de fait, l’importance de ces tâches de régulation du travail individuel et collectif qui relèvent de multiples enjeux.
Les travaux sociologiques qui portent sur l’encadrement notamment de proximité montrent bien l’ampleur, la complexité de ces tâches et la charge mentale qu’elles représentent, sur le plan cognitif comme sur celui émotionnel11. Or, ce sont ces tâches qui seront désormais attribuées aux salarié.es de base qui auront à régler entre eux/elles les différents écueils que rencontre tout travail collectif. Qu’ils et elles s’arrangent entre eux, si il y en a un ou une qui veut prendre une après midi c’est d’accord si le reste de l’équipe s’engage à faire son boulot, disait un dirigeant…. On demande en réalité aux salarié.es de l’entreprise libérée de se faire les relais loyaux, efficaces, fiables et disponibles de la vision du leader, qui pourra se reposer sur eux et elles en toute confiance, Alexandre Gérard, patron de Chronoflex est parti faire le tour du monde pendant un an avec sa famille et a retrouvé son entreprise florissante… Mais à quel coût pour ses salarié.es qui multiplient les tâches annexes à leur activité propre, qui ne peuvent manifester de distance critique par rapport à la vision de leur leader et dont on attend une loyauté absolue et un investissement total dans leur travail ?
A bas le salariat, vive l’emploi libéré ?
C’est là qu’intervient le second front de remise en cause du management moderne ; celui qui prend pour cible le salariat lui-même. Il est également porté par des professionnels du consulting, des RH, des managers. Il part de l’idée que le salariat n’est plus compatible avec les aspirations des membres de notre société et l’associe à une perte de sens. Pour présenter rapidement ce courant qui débouche « naturellement » sur la promotion des emplois « indépendants » avec les auto entrepreneurs, les slashers, les travailleurs et travailleuses en lien avec des plateformes numériques, les start upers, les free lance etc. ou celle d’une hybridation entre salariat partiel et formes indépendantes, je me fonderai sur le livre de Denis Pennel, « Travail, la soif de liberté », qui a été lauréat du 31ème concours du Prix Turgot, avec une médaille de bronze. Ce prix qui récompense « les plus grands auteurs de l’économie financière » a été créé par l’association des anciens élèves de l’Institut de haute finance12. Le décor est posé dès l’introduction : Si le salariat « s’est imposé dans le courant du XXe siècle au sein des économies industrielles pour devenir la forme générale d’emploi et le pivot de nos systèmes de protection sociale, le salariat connaît aujourd’hui une crise existentielle, remettant en cause le concept de servitude volontaire. La dictature de l’emploi salarié a pris le travail en otage, réduisant des métiers et des expertises à des fonctions bureaucratisées et à des postes standardisés. » (p 15). Le salariat a fait son temps, il est devenu archaïque, il ne peut être considéré comme un mode de mise au travail efficace et acceptable : « Le salariat a touché les limites de son modèle, il a usé jusqu’à la corde les recettes de son succès, il est arrivé au bout de sa logique. Le travail étouffe désormais dans un cadre trop rigide, conçu à l’âge de la civilisation de l’ouvrier puis du cadre subalterne. A la fatigue ressentie par les citoyens à l’égard d’un chômage inexorable se juxtapose une autre fatigue, celle d’un salariat au bout du rouleau » (p16). Même considération que les promoteurs des entreprises libérées : la motivation est écrasée « par des modes managériaux néo-tayloristes étouffant toute initiative personnelle et engendrant de la souffrance. » (…) « Savoir libérer ce potentiel humain, voilà le vrai différenciateur économique pour les entreprises du XXIème siècle » (p21).
Mais la solution sera donc bien différente : « pour baptiser cette nouvelle forme de travail nécessaire, utilisons le terme libertariat ». (p27). Les raisons qui poussent à ce libertariat sont, au-delà de celles portées par le courant des entreprises libérées, plus politiques et idéologiques encore. Pennel parle de la soviétisation du monde de l’entreprise : « l’absence de prise en compte et de respect de la singularité de chaque individu, la négation de la dimension humaine du travail : n’est ce point là l’incarnation même du système soviétique, dans lequel l’homme n’est plus considéré comme un être humain ? » (p181). Il dénonce des procédures de contrôles intempestifs et coercitifs, une « volonté féroce de tout contrôler » (p178), « un développement intempestif des normes qualité et des modes de production centrés sur des process » (p179). La condamnation est sans appel : « Face à la montée de l’individualisation de la relation de travail et à la quête de plus d’autonomie, le salariat a eu beau se diversifier, il ne répond plus aux aspirations libertaires de nombre de citoyens. » (…) Une nouvelle façon de travailler, plus libre, plus ouverte, moins asphyxiante, mais aussi plus respectueuse de la nature humaine et de la singularité de chacun, cherche à s’affranchir des scories de l’usine. » (p19). Elle se veut morale : « D’un certain côté, les salariés ont été les rentiers de la seconde moitié du XXème siècle. A eux l’accès à la protection sociale, des rémunérations à la hausse, des retraites généreuses, le tout non financé de façon pérenne. Ils ont vécu sur le dos des générations à venir, sacrifiant l’avenir social de leurs enfants au profit des acquis sociaux, de leur qualité de vie matérielle et de leur confort personnel. (…) Grâce à ces complicités, s’est développé en France un marché du travail à deux vitesses, aves les ‘protégés’ d’un côté » (fonctionnaires et salariés en CDI) et les ‘courageux’ de l’autre (CDD, intérim). On peut voir dans le mouvement du travail indépendant qui s’amorce aujourd’hui, la revanche des petits sur les grands, des ‘sans dents’ sur les bobos, des plus défavorisés sur les nantis, des déclassés sur les privilégiés, des travailleur sur les actionnaires. C’est l’émergence d’un capitalisme plus démocratique » (p49).
Intéressant retournement de perspective qui veut que les salarié.es du XXème siècle, qui se battaient dans le cadre de la lutte des classes pour arracher des droits et des protections, soient désormais représenté.es comme des rentiers que l’on doit opposer aux précaires, aux pauvres et aux chômeurs ! Mais l’inventivité de la jeune génération et les fantastiques évolutions technologiques désignent les voies possibles de mise en place de ces formes libertaires d’emploi et de travail appelés de ses vœux par Denis Pennel : « la digitalisation a extirpé le travail de sa contrainte spatiotemporelle le rendant omniprésent et déconnecté de tout lieu physique » (p20). « Grâce aux innovations technologiques, aux plateformes collaboratives, l’activité économique se démocratise » (p49) et « de plus en plus de jeunes font leur ‘jobbing out’ abandonnant le confort et la stabilité d’un emploi salarié devenu sclérosant et insipide, voire nocif, pour se lancer dans la création leur propre activité professionnelle. »(…) Dans les faits, la satisfaction est au rendez vous : ces jeunes individus sont plus heureux qu’avant même s’ils gagnent moins bien leur vie » (p48). « Mettons fin à la monarchie pour retrouver l’indépendance du travail, pour donner naissance au libertariat. (…) la plus grande erreur serait de préparer l’avenir en voulant sauver le passé. Ce n’est pas en amendant le salariat qu’on en sortira, il faut changer de perspective » (p255). « Le salariat n’est pas un horizon indépassable, pas plus que la chute du mur de Berlin ne marquait la fin de l’Histoire » (p258).
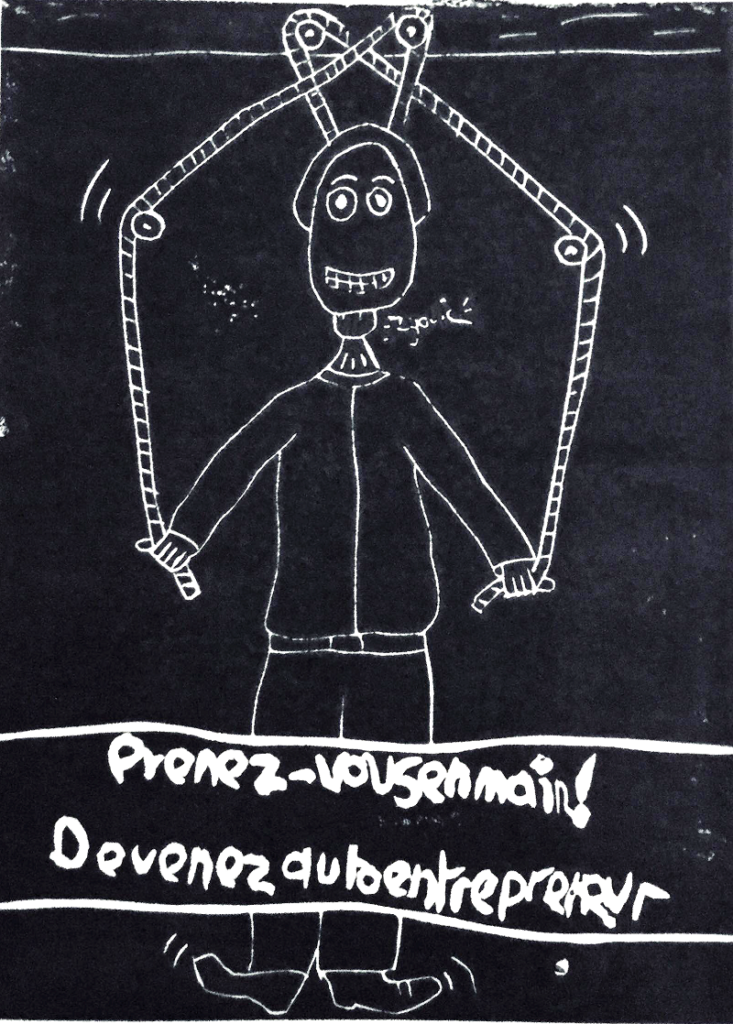
Pourquoi ne pas amender le salariat ?
Les orientations préconisées par les milieux managériaux critiques du management moderne ont de quoi inquiéter. Il y a une propension, d’un côté à transformer les entreprises en véritables sectes tombant sous la houlette du leader et imposant un tri entre celles ou ceux qui y croient et celles ou ceux qui n’y croient pas, imposant surtout à celles et ceux qui y croient de ne pas céder au doute et à la critique, imposant aussi des conditions de travail de plus en plus exigeantes, complexes et souvent déstabilisantes. Il y a une propension, de l’autre côté, à tourner le dos au salariat, dénoncé pour son archaïsme et son immoralité pour propulser nombre de travailleurs et travailleuses dans le monde d’emplois atomisés, qui conduisent le plus souvent à une fragilisation, une forte dépendance économique et à des « boulots de merde » comme l’écrivent Julien Brygo et Olivier Cyran13. On a un aperçu futuriste de ce monde dans le livre collectif intitulé « Au bal des actifs, demain le travail »14. Le salariat présente de lourds inconvénients, largement dénoncés ici par le milieu patronal, mais il présente aussi de sérieux avantages. Les avantages sont à relier à la dimension collective de la mise au travail et aux droits, garanties et protections qui ont pu être arrachés de haute lutte par les travailleurs, travailleuses et leurs organisations représentatives au cours de l’histoire, grâce à cette dimension collective. Ils sont également à relier à l’héritage du sentiment d’un destin commun, qui unit face à des difficultés vécus collectivement, même si les politiques managériales instaurent une individualisation et personnalisation de la relation de chacun à son travail. Il y a, dans ce salariat, des éléments qui sont favorables aussi à la mise en débat collective des enjeux fondamentaux du travail, dans ses dimensions d’efficacité et de finalité sociale et économique comme dans ses dimensions écologiques. Par finalité sociale et économique, il faut entendre les conditions, le contenu et le sens du travail (et donc la prise en compte des consommateurs, consommatrices ou usagers des services, autant que celle des travailleurs et travailleuses), la répartition des richesses produites, et la prise en compte de l’avenir de notre planète. Mais cette capacité de mise en débat est compromise par l’inconvénient le plus fondamental du salariat, à savoir le lien de subordination inscrit dans le contrat de travail lui-même et qui paralyse et entrave à lui seul les salarié.es. C’est ce lien de subordination qui rend possible les dérives managériales et organisationnelles dénoncées désormais par les milieux patronaux, et qui fige l’entreprise dans ses dimensions les plus irrationnelles et injustes. Un salariat sans subordination est tout à fait possible et envisageable, qui préserverait les capacités de protection et les droits des salarié.es, si on arrivait à penser autrement l’entreprise. Celle-ci n’appartient pas aux employeurs (elle n’existe d’ ailleurs pas et est une pure fiction sur le plan juridique) quoiqu’en pense le patronat qui de Conseil national du patronat français (CNPF) s’est rebaptisé en 1999 Mouvement des entreprises de France (MEDEF). La vraie modernisation serait de repenser le salariat à travers l’invention d’une entreprise capable de prendre en compte les véritables enjeux que véhicule le travail.
Danièle Linhart
1 Editions Les Liens Qui Libèrent, 2018
2 Editions Babel, 2017
3 La comédie inhumaine du travail, Editions de l’O, 2018
4 Voir La comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la sur humanisation managériale, Editions Erès, 2015.
5 Maisonnier, 2015.
6 Isaac Getz et Brian M Carney, Liberté et Cie. Quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises, Editions Fayard, 2013.
7 Le patron qui ne voulait plus être chef, Editions Flammarion, 2017.
8 La belle histoire de Favi ; l’entreprise qui croit que l’homme est bon, Editions Lulu, 2018.
9 Voir notamment « Les cadres : la déstabilisation d’un salariat de confiance », site halshs-00007603.
10 Disponible sur le net sous cette appellation.
11 Voir par exemple, la thèse de doctorat de sociologie de Bertrand Mangin : « Nouvelle figure de l’encadrement de proximité dans une entreprise en transformation » dirigée par J-Ph Bouilloud, Université Paris Diderot, 2018.
12 Travail, la soif de liberté ; comment les start uppers, les slashers, coworkers réinventent le travail, Editions Eyrolles 2017.
13 Boulots de merde, du cireur au trader. Enquête sur l ‘utilité et la nuisance sociale des métiers, Editions La découverte, 2016.
14 Editions Volte, 2017
- Tout changer : oui ! - 2 mai 2019
