Sous la plage, la grève
Le constat est simple : l’analyse des luttes ouvrières en mai et juin 1968 a intéressé peu de monde. Peut-être parce que le caractère plus spectaculaire de la révolte étudiante a davantage tenté journalistes et chroniqueurs. Peut-être parce que d’autres catégories socioprofessionnelles trouvèrent plus facilement des porte-plume : livres et articles abondent sur la « contestation » chez les architectes ou dans les milieux du cinéma. Pour la classe ouvrière, hormis de lacunaires récits syndicaux, on ne dispose guère que d’enquêtes et de témoignages épars, d’accès souvent difficile. Seuls tentèrent une synthèse ceux des sociologues et militants qui virent dans le mouvement de Mai la confirmation du rôle d’avant-garde de la « nouvelle classe ouvrière » et des couches techniciennes. Dans la mémoire collective, il ne reste alors, au-delà des expériences locales, que quelques idées très générales et le plus souvent erronées sur ce que fut l’attitude de la classe ouvrière en mai et juin 1968.

Quant au lien entre les mouvements ouvriers en mai 1968 et les expériences de la classe ouvrière dans la décennie précédente – depuis l’instauration, en 1958, de l’État fort gaulliste –, le gouffre est également béant. C’est que cette liaison ne fonctionna que comme alibi pour tous ceux des dirigeants syndicaux dont l’objectif était de minimiser le rôle de détonateur que joua la révolte étudiante par rapport au déclenchement des luttes ouvrières. Pour les autres, un tel souci devint alors d’emblée suspect : le signe évident de la volonté de minimiser la spontanéité des luttes de Mai.
Aujourd’hui, pour tous ceux qui, loin des discours pompeux sur la « crise de civilisation », voient dans Mai 68 une étape de la lutte des classes, la date clé de la recomposition du mouvement ouvrier en France, pour tous ceux que concerne la manière dont s’articulent l’ancien et le nouveau dans l’histoire ouvrière, il est temps d’y regarder de plus près. […]
Dix ans. L’avènement d’un Etat fort
Le 13 mai 1958, la classe ouvrière est défaite sans avoir combattu. Une partie de ses organisations traditionnelles – la majorité de la SFIO1 – appuie l’instauration du général de Gaulle et de la 5e République. Il faut attendre quinze jours pour que la gauche manifeste contre le coup de force. Et c’est séparées que les organisations syndicales appellent à des arrêts de travail : la CGT le 27, la FEN et la CFTC le 28. Ceux-ci sont faiblement suivis. Ce ne sont pas là anecdotes et accidents : les conséquences de l’absence de riposte des organisations ouvrières sont au contraire profondes. Jamais la combativité ouvrière n’aura été aussi basse qu’en 1958 : 1 137 700 journées de grève. Il faut remonter à 1946 pour trouver plus bas. […]
Les répercussions sur le mouvement ouvrier
1960 marque bien l’apogée de la période de facilité du gaullisme. La progression de la production industrielle y culmine à 11,4 %. Elle retombera à 5,7 % et 6 % en 1961 et 1962, qui sont à tous les égards des années de transition. Car si la classe ouvrière a été défaite sans combat, elle n’est pas pour autant démembrée […] Nous ne connaissons pas l’évolution précise des effectifs de la CFTC et de FO. La CGT, quant à elle, connaît une baisse sensible de ses effectifs2. Mais les élections aux caisses primaires de Sécurité sociale ne traduisent que des variations infimes : en 1955, la CGT, FO et la CFTC obtiennent respectivement 30,3 %, 11,4 % et 14,7 % ; en 1962, le résultat donne 30,6 %, 10,1 % et 14,4 %. Seule la baisse de FO peut apparaître significative ; il est vrai que celle-ci est alors fortement divisée sur l’affaire algérienne : un courant anarcho-syndicaliste et trotskisant est favorable à l’indépendance de l’Algérie mais soutient le MNA et non le FLN ; un courant « Algérie française » a démissionné du bureau confédéral en 1958 tout en restant vivace dans la confédération. Entre les deux, la majorité confédérale de Robert Bothereau navigue… Globalement, en tout cas, il n’y a pas de recul significatif des confédérations ouvrières. Même la progression des abstentions ou des votes nuls est faible : de 29,4 % en 1955 à 31,16 % en 1962. À partir de 1960, il y a d’ailleurs une réactivation de l’activité de la classe ouvrière : les journées de grève passent en 1961 à 2 600 600 et en 1962 à 1 901 500.
De manière générale, les grèves restent courtes mais sont plus nombreuses. C’est que la situation sociale se dégrade. Dès 1959, des indices de dégradation des conditions de travail sont déjà apparus : le travail « en équipe » augmente, en particulier dans les industries de transformation3. Et, à partir de 1960, la durée du travail remonte pour les ouvriers : 46 heures en 1959, 46,3 en 1960, 46,7 en 1961 et 46,9 en 1962, phénomène surtout sensible dans les petites entreprises, parents pauvres de la restructuration. La guerre d’Algérie privant le marché du travail d’une grande partie de la jeunesse, les vieux travailleurs tendent à rester plus longtemps en activité : le pourcentage du nombre d’actifs de plus de 54 ans passe de 18,2 % à 20,4 %. Les accidents du travail augmentent.[…]
Curieusement, ce sont les organisations syndicales qui apparaissent au premier plan de la lutte pour la « paix en Algérie ». Il est vrai qu’elles semblent moins atteintes par la débâcle de 1958. L’UNEF, le syndicat étudiant4, multiplie les actions et les initiatives. Elle trouve parfois un accord avec les unions départementales parisiennes de la CFTC et de FO, comme pour les manifestations du 27 octobre 1960. Elle est aidée dans ce rôle par une nouvelle organisation politique, fondée en avril 1960, le Parti socialiste unifié (PSU). La fusion s’est en effet faite entre les anciens minoritaires SFIO et une organisation issue de la « nouvelle gauche » et des milieux chrétiens radicalisés, l’Union de la gauche socialiste (UGS). Le PSU a une quinzaine de milliers d’adhérents et aura de 1960 à 1962 une activité essentiellement tournée vers la question algérienne.
Dans son ensemble, cependant, la classe ouvrière n’est pas massivement mobilisée sur l’Algérie. Ce sont essentiellement les milieux intellectuels et la jeunesse universitaire qui se sentent concernés (Manifeste des 121, réseaux de soutien au FLN, création du Front universitaire antifasciste). Il faudra la multiplication des initiatives UNEF, PSU, CFTC et le déploiement en France du terrorisme de l’OAS pour que le PCF développe son activité propre. Les actions unitaires culminent avec la manifestation contre le plasticage dont a été victime la petite Delphine Renard : il y aura huit morts au métro Charonne, le 7 février. Tous sont membres du PCF. Près d’un million de travailleurs suivront leur enterrement le 15. Incontestablement, c’est la première rupture significative entre le gaullisme et la masse hésitante de la classe ouvrière. Le Figaro5 titre « La courbe se renverse », et Le Monde6 « Le mouvement ouvrier a repris conscience de la force qu’il représente ». Deux mois plus tard, c’est la signature des accords d’Évian et la fin de la guerre d’Algérie. […]
Le tournant
[…] Ce sont les mineurs qui relèvent le défi. Leurs salaires ont en effet atteint un retard de 11,5 % par rapport à la moyenne des salaires industriels. En Lorraine, particulièrement, s’ajoutent les craintes pour l’emploi. C’est la CFTC qui semble la plus résolue : elle lance, dès le 28 février 1963, un mot d’ordre de grève illimitée. La CGT se contente d’un mot d’ordre de quarante-huit heures. Mais le pouvoir, misant sans doute sur la rigueur de la température pour rendre impopulaire la grève, prononce un ordre de réquisition que signe le général de Gaulle. Cela suffit pour unifier les trois fédérations ouvrières qui décident de maintenir leur mot d’ordre de grève. Le premier test est en Lorraine, le lundi 4 mars : massivement, les mineurs lorrains refusent de rentrer. Le 5, dans le Nord-Pas-de-Calais et les Cévennes, la grève est totale. Elle se déploiera pendant un mois, en bénéficiant d’une exceptionnelle solidarité nationale, dont la marche sur Paris du 13 mars reste le meilleur exemple. Mais le pouvoir ne peut céder et les confédérations syndicales refusent d’appeler à la généralisation, que seul évoque le PSU. Le 3 avril, les syndicats signent l’accord et appellent les mineurs à reprendre le travail. Les avantages obtenus sont faibles : les horaires, les conditions de travail, l’emploi, tout cela est renvoyé à une commission paritaire. Les congés payés passent à vingt-quatre jours. Mais la somme forfaitaire versée à chaque mineur à la reprise ne sera pour les quatre cinquièmes qu’une avance. Et l’augmentation des salaires ne sera que de 6,5 %7 : les Charbonnages proposaient au départ 5,7 %, une « commission de sages » mise en place par le gouvernement lui-même avait proposé 8 %.
Dans les corons, c’est la colère. À Lens, le responsable venu expliquer l’accord et demander la reprise du travail ne pourra terminer sa harangue : sa voix est couverte par celle des mineurs massés sur la place qui le traitent de « vendu ». À Lille, à Merlebach et dans des dizaines d’autres villes, c’est par centaines que les mineurs déchirent leur carte syndicale8. Mais c’est la réaction du désespoir et non celle d’une avant-garde ouvrière cherchant et proposant des voies alternatives à la capitulation des appareils réformistes. Le travail reprendra pourtant. Aucun courant n’apparaîtra chez les mineurs, capable de tirer les leçons de cet échec.

Pourtant, cette grève marque un véritable tournant dans l’histoire du gaullisme. En premier lieu, c’est une grève qui, après tous les atermoiements de la période 1958-1962, se fait dans l’unité syndicale, et cela dans une branche très profondément marquée par les affrontements intersyndicaux de 1947. Et à cette unité syndicale correspond l’unité de couches sociales traditionnellement séparées : pour la première fois, les employés – et une partie des ingénieurs – se mettent en grève avec les mineurs. Ensuite, même s’il a formellement maintenu l’ordre de réquisition et contraint les mineurs à la reprise, le gouvernement a en fait subi un échec : dès les premiers mots de l’allocution de Pompidou le 9 mars (« Il y a eu un malentendu »), c’est clair. Le « malentendu » ira en se creusant tout au long de la grève. Les slogans des manifestations se font de plus en plus clairement antigouvernementaux. […]
La grève elle-même n’a jamais échappé au contrôle des organisations syndicales. Certes il y a eu mise en place d’un comité central de grève, mais il s’agit en fait d’une structure syndicale. Pourtant, certains aspects annoncent en partie des temps nouveaux. Le rôle des femmes, d’abord. Tout le monde sait que leur attitude est décisive dans une grève de longue durée « puisque ce sont elles qui tiennent les cordons de la bourse ». Mais ici, dans ce secteur exclusivement masculin9, les femmes vont au-delà : elles écrivent au ministre, elles demandent à s’adresser aux mineurs dans les meetings, certaines précisent publiquement qu’elles empêcheront leur mari de reprendre le travail. Bref, elles refusent de rester chez elles, à leur place. La popularisation va souvent au-delà de la solidarité matérielle. Mais jamais les mineurs ne feront clairement appel à l’entrée dans la lutte des autres secteurs. Les confédérations syndicales auront beau jeu de se réfugier derrière un commode « C’est aux mineurs de décider ».
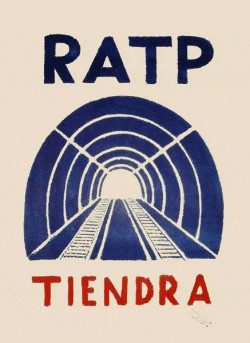
Pourtant, et c’est là un des éléments les plus significatifs de cette grève, les autres secteurs étaient prêts à entrer dans la lutte. Le 5 mars, une grève générale (d’un quart d’heure, il est vrai) est massivement suivie en protestation contre la réquisition et en solidarité avec les mineurs. Appelée par la CGT, la CFTC, la FEN, l’UNEF et parallèlement par FO, elle entraîne la paralysie totale d’une grande partie du secteur public (SNCF, RATP, coupures à l’EDF…), mais pas seulement. Elle est aussi massivement suivie dans la plupart des grandes entreprises industrielles, dans la région parisienne, à Lyon, Nantes, Toulouse. Dans la métallurgie lilloise, la grève est totale. Le 9, les mineurs du complexe de Lacq – que l’on présente de plus en plus comme la source d’énergie alternative aux mines – se mettent en grève. Le 12, les cheminots débrayent deux heures, puis vingt-quatre heures le 15 avant d’entamer un cycle de grèves tournantes. Les sidérurgistes de Lorraine, solidaires des mineurs de fer, se mettent également en grève le 12. Le 14, c’est une journée d’action des métallurgistes, patronnée par la CGT et la CFDT, renouvelée une semaine plus tard. Le lendemain, c’est une journée revendicative dans la chimie. Le 20, c’est la journée d’action de la fonction publique avec laquelle se combine un arrêt de travail de quatre heures à EDF. À partir du 20, ce sont les PTT et la RATP qui sont touchés en même temps que les caréneurs de Dunkerque et les métallurgistes de Michelin.
La preuve n’est pas difficile à faire que ce n’est pas « à la suite de la lutte victorieuse des mineurs », mais bien pendant celle-ci, que d’autres secteurs ont démontré leur envie de rentrer en lutte. Et cela n’est même pas limité au secteur public : la chimie et surtout la métallurgie manifestent leur combativité. C’est à une réactivation d’ensemble de la classe ouvrière que nous avons affaire. Les chiffres de grève pour 1963 le prouvent : 5 990 150, c’est-à-dire plus du triple de 1962, le chiffre le plus élevé depuis 1953. Les confédérations syndicales ne lèveront pas le petit doigt pour coordonner cette volonté générale de lutte. Cela ne les empêche d’ailleurs pas de se renforcer. La remontée des effectifs de la CGT, sensible dès 1962, progresse à partir de 196410. Il en va de même pour FO, après la baisse consécutive au départ de l’extrême droite et à la dissolution des sections d’Algérie. […]
Du plan de stabilisation aux émeutes de Caen
Dans cette situation, le pouvoir ne pouvait rester sans réplique. Celle-ci se développe en trois temps : d’abord, il saisit l’occasion d’une « grève surprise » des conducteurs de métro, le 17 juin 1963, pour réglementer le droit de grève et instituer la clause du préavis obligatoire de cinq jours ; ensuite, il tente d’imposer la politique des revenus, c’est-à-dire la police des salaires (rapport Massé, puis commissions Grégoire et Toutée). Dans le secteur public, il s’agit de faire fixer par le gouvernement, après diverses procédures de consultations et d’enquêtes, la masse salariale dont peut disposer chaque entreprise. Le seul rôle restant donc aux organisations syndicales serait de négocier avec les directions la répartition de cette masse salariale. Dans le secteur privé, c’est un « collège d’étude et d’appréciation des revenus », composé de fonctionnaires qui auraient à se prononcer sur la compatibilité des accords de salaire avec les critères fixés par le gouvernement en matière de rémunérations.
En fait, ces mesures sont parties intégrantes du « plan de stabilisation » mis en place par le gouvernement. Quand celui-ci est rendu public, le 12 septembre 1963, on s’aperçoit en effet qu’il y a quelques changements dans la politique gouvernementale. […]
Ce blocage des salaires entraînera un malaise social persistant pendant les années 1964-1965. En 1964, il se traduit sans doute par le nombre relativement élevé des journées de grève (2 496 800). En 1965, en revanche, le nombre des journées de grève est faible (979 000) : de toute évidence, c’est vers l’élection présidentielle que s’est tournée l’attente de la classe ouvrière. […] Mitterrand obtiendra 32 %, plus qu’on ne lui accorde généralement. Et, surtout, de Gaulle est en ballottage. Ce succès – car c’en est un – accélère les phénomènes de recomposition dans le mouvement ouvrier. La combativité de la classe ouvrière se manifeste de plus belle : à nouveau 2,5 millions de journées de grève en 1966, 4,5 millions en 1967. Les élections aux comités d’entreprise ont lieu en 196611. Tous collèges confondus, les organisations ouvrières obtiennent 77,9 % des suffrages exprimés. Dans le premier collège, le collège ouvrier, les résultats sont encore plus impressionnants : 83,8 %12. Elles ne retrouveront plus jamais ce chiffre.
Cette recomposition atteint aussi de l’intérieur les organisations ouvrières. Le fait que le plan de stabilisation mette principalement en cause les salaires du secteur public renforce incontestablement l’hostilité au pouvoir et la détermination de Force ouvrière, où André Bergeron a remplacé Robert Bothereau13. La traditionnelle minorité anarcho-trotskiste y bataille contre l’« intégration » des syndicats et, précisément, à cette époque, contre l’acceptation de la politique des revenus et contre les commissions Grégoire et Toutée. Mais une autre opposition – moderniste celle-là – est apparue dans FO autour d’hommes plus représentatifs du secteur privé, comme Cottave pour les cadres et Labi pour la chimie. Or, dans le cas de la chimie, cette opposition est également une opposition unitaire. Dès 1963, la « Fédéchimie » FO propose l’unité d’action systématique à la CGT et à la CFTC. Au congrès confédéral de 1966, elle se prononcera pour la réunification syndicale. De plus, sa pratique s’avère « payante » et FO se développe dans la chimie : elle est au quinzième rang par ordre d’importance des fédérations FO en 1959, au treizième en 1961, au douzième en 1963, au neuvième en 196614. Accusée de « corporatisme » par la minorité anarcho-trotskisante, elle est aussi soupçonnée de complaisance à l’égard de la CFDT. Elle représentera cependant 9,2 % des mandats au congrès confédéral de 1966, contre environ 6 % à la minorité anarchiste.
Le principal se passe cependant à la CFTC. La minorité qui bataille depuis de longues années – autour du groupe Reconstruction – pour la « déconfessionnalisation » de la centrale a peu à peu gagné du terrain. Dès 1960, la chimie, le bâtiment, les enseignants avaient pris position en ce sens. En novembre 1964, c’est par 70 % des mandats que sont adoptés les nouveaux statuts qui ne feront plus référence à la morale sociale-chrétienne et la suppression du « C » terminal. Les opposants se retrouvent certes surtout chez les employés et les fonctionnaires. Mais, parmi ceux qui vont faire scission et créer la CFTC maintenue (10 % des effectifs environ), il y a aussi les mineurs de Joseph Sauty, au premier rang des luttes il y a un an.

En 1964 et 1965, la CFDT joue le rapprochement avec FO, seule susceptible de contrebalancer l’influence de la CGT, qu’il s’agisse d’aller vers l’unité organique ou vers l’unité d’action15. Mais la déconfessionnalisation ne fait que rendre FO plus méfiante et, surtout, la marche vers l’unité des partis de gauche que représente l’élection présidentielle de 1965 n’est pas sans répercussion au niveau syndical. Le 10 janvier 1966 est signé le premier accord confédéral entre la CGT et la CFDT. Ses répercussions sont immédiates : la combativité ouvrière de 1966 s’est en effet d’abord exprimée par des actions en ordre dispersé du secteur public : SNCF, EDF, RATP. Les résultats sont médiocres. L’accord CGT-CFDT aide à faire progresser l’idée du « tous ensemble ». Le 17 mai 1966, c’est une des plus puissantes journées d’action qui ait eu lieu depuis longtemps. La journée d’action essentiellement centrée sur le secteur privé en juin obtient des résultats moindres. Et l’automne est calme. Mais le début de l’année 1967 voit se dérouler une série de conflits durs, de longue durée : à la Rhodiaceta, une grève d’un mois à partir de réductions d’horaires ; aux chantiers navals de Saint-Nazaire, ce sont les mensuels qui tiennent soixante-trois jours pour des revendications liées aux disparités de salaire par rapport aux autres régions. Et puis il y a Berliet, les mines de fer de Lorraine… L’examen des journées de grève perdues par région pour l’année 1967 confirme que ce sont les gros bataillons des régions industrialisées qui entrent alors en lutte : 371 300 journées de grève pour le Nord, 916 600 pour la Lorraine, 314 000 pour les Pays de la Loire, 761 300 pour Rhône-Alpes…

À la Rhodiaceta, c’est avec l’occupation que renouent les travailleurs et pour toute la durée du conflit. En Lorraine, les mineurs occupent le carreau de la mine et empêchent toute expédition de minerai. Chez Dassault, c’est la systématisation des débrayages surprises : certains jours, il y a cinq minutes de grève toutes les heures et des manifestations dans les ateliers qu’accompagne un orchestre improvisé : la grève « tam-tam », comme l’appelleront les travailleurs, annonce dix ans à l’avance la « production 001 » de Dassault 77. Mais c’est dans la grève des mensuels de Saint-Nazaire que s’entremêlent le plus visiblement tradition et nouveauté. D’abord, parce que c’est à Saint-Nazaire, la « capitale de la grève » comme on l’appelle dans la région16. Mais c’est une grève de mensuels, la première révolte de ceux qu’on appelle encore les « collaborateurs du patron ». Bien sûr, en 1955, c’était une grève contre le « boni », et c’est aujourd’hui une grève contre le « galon », cette prime à la tête du client qui représente en moyenne 13 % du salaire. Mais c’est aussi, cinq ans avant le Joint français, une grève contre le retard des salaires par rapport à la métallurgie parisienne. Bien sûr, une fois encore, on sort de l’usine, on manifeste et la ville est solidaire. Mais, cette fois-ci, c’est une série de manifestations éclair, coordonnées par talkies-walkies, selon la méthode imaginée en 1964 par les grévistes de la Thomson. Trois mille femmes de métallurgistes manifestent dans les rues, là où on en attendait quelques centaines. La solidarité va plus loin qu’elle n’a jamais été dans le passé à Saint-Nazaire, plus loin même que pour la grève des mineurs. Le 8 avril, trois cents kilos de poisson sont distribués aux grévistes ; le 15, ce sont deux tonnes ; le 18, quatre tonnes et demie. Le comité de soutien crée quatre commissions : patates, carottes, poissons, poulets. Et, le 9 avril, tous les coiffeurs « rasent gratis ».
La combativité qui transparaît dans ces luttes locales se manifeste aussi dans les « tous ensemble » nationaux. On le voit bien en mai 1967. Le 13, le gouvernement obtient du Parlement les pleins pouvoirs pour légiférer par ordonnances en matière économique et sociale. La pièce maîtresse du dispositif, ce sont les ordonnances sur la Sécurité sociale. Le 17 mai, c’est une nouvelle grève générale interprofessionnelle, massivement suivie, à l’appel de la CGT, de la CFDT, de FO et de la FEN.
C’est à la CFDT que profite le plus cette période17. Non seulement elle a très vite récupéré les pertes subies lors de la scission18 mais elle a opéré une importante mutation interne. De la confédération d’employés dont elle avait précédemment l’image, elle est devenue une organisation où le secteur privé industriel est prépondérant. Mai 68 confirmera cette évolution mais n’en sera pas le point de départ. […]
Le 23 janvier, la Saviem est en grève illimitée et trois revendications sont avancées : augmentation des salaires de 6 %, création d’un fonds de garantie des ressources en cas de réduction d’horaire, extension des droits syndicaux. Sous quatre aspects au moins, cette grève est particulièrement significative : il y a extension très rapide de la grève à l’ensemble des entreprises métallurgiques de la région, soit sur leurs revendications propres (Jaeger, Sonormel, Radiotechnique), soit par solidarité (Moulinex, SMN, etc.) ; il y a heurts violents avec la police (en particulier le 16 janvier dans le centre de Caen) ; il y a jonction partielle avec le mouvement des étudiants : ceux-ci manifestent dès le 18 janvier, à l’occasion de la venue du ministre de l’Éducation nationale ; ils seront dans la rue à côté des ouvriers le 26 ; il y a débordement spontané des organisations syndicales : le deuxième vote sur la grève donne, le 2 février, 502 voix pour la poursuite de la grève et 272 pour des actions à l’intérieur de l’entreprise ; mais les organisations syndicales, jugeant trop faibles les effectifs qui ont participé au vote, décident quand même la reprise ; elle a bien lieu le lundi 5 ; mais, à 14 heures, sans aucune consigne, ce sont trois mille ouvriers qui quittent le travail, manifestent dans l’usine et s’en vont. Au niveau des revendications, rien n’est réglé. Deux mois plus tard, c’est Mai 68.
Deux mois
Sur les premiers jours de Mai 68 et le déploiement de la révolte étudiante, il n’y a pas lieu de s’étendre. Précisons simplement, quant au rôle de détonateur joué par le mouvement étudiant, l’accord avec la remarque de Georges Séguy19 : « Ce fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres, a-t-on dit. L’image est assez juste, mais encore fallait-il qu’il y ait de la poudre, sinon l’étincelle se serait vite perdue dans le vide. » Incontestablement, il y avait la poudre… Incontestablement aussi, les dirigeants syndicaux n’avaient guère réalisé à quel point s’accumulaient la colère et la combativité ouvrières. […]

Le 1er mai, la manifestation traditionnelle est autorisée pour la première fois depuis dix ans. Elle est appelée par la seule CGT mais elle est massive. Quand se déclenche la révolte étudiante, les organisations syndicales ouvrières restent dans l’expectative. D’ailleurs, elles préparent l’action sur la Sécurité sociale pour l’abrogation des ordonnances qui doit culminer le 15 mai. Il faudra les barricades de la rue Gay-Lussac pour que le lendemain – le 12 –, la CGT et la CFDT appellent à la grève générale pour le 13, avec manifestations dans toute la France. Grèves et manifestations sont massivement suivies. Du côté de la CGT, on insiste sur l’aspect revendicatif. Mais l’impréparation est telle que des sections CFDT défilent également derrière des banderoles qu’elles avaient préparées pour les défilés sur la Sécurité sociale, même si, globalement, la CFDT assume mieux l’aspect « solidarité avec les étudiants ». Dans les manifestations, des slogans directement politiques émergent déjà : « Dix ans, ça suffit20 ! » En tout cas, la densité de la présence ouvrière dans ces manifestations, co-organisées par l’UNEF et le SNEsup, étonne l’ensemble des responsables syndicaux. Il n’est pourtant pas aisé de préciser qui, dans la classe ouvrière, défile ce jour-là, ni d’attribuer aux présences et aux absences une signification précise. La présence des travailleurs de Chausson est, par exemple, massive. Mais la grève à Renault est un grand succès : plus de 80 %. De partout remontent aux confédérations l’information que la grève a été suivie et des demandes de directives pour la suite. Mais les confédérations hésitent. D’abord, il y a la journée d’action du 15 sur la Sécurité sociale : la CGT parle vaguement le 14 « de déterminer, en accord avec les autres organisations syndicales, les conditions de la poursuite de la lutte » et, le 15, lance : « Travailleurs, travailleuses, à l’appel de vos syndicats, agissez sans attendre, rassemblez-vous sur les lieux de travail, participez à la détermination des revendications et des modalités d’action dans vos entreprises, vos branches d’industrie et vos régions. » Elle convoque un comité confédéral national pour le 17. La CFDT appelle les travailleurs, le 16 mai, « à discuter, à s’organiser et à agir sur tous les lieux de travail ». Elle convoque un conseil confédéral pour le 18. Les délégations du 15 à l’Assemblée nationale pour exiger l’abrogation des ordonnances ne marquent pas une étape dans la lutte. II faut attendre le 17 pour que la CGT appelle les travailleurs à « prendre place » dans la lutte. Ni la CGT ni la CFDT n’appelleront à la grève générale. En fait, c’est déjà parti.
Le déclenchement des grèves
Et c’est la métallurgie qui a démarré la première. Dès le 14, les métallos de Sud Aviation-Bouguenais occupent leur usine et séquestrent le patron21. Le lendemain, c’est le tour des métallos de Renault-Cléon et des Chantiers navals de Bordeaux, accompagnés par Contrexéville (Vosges), les NMPP et une petite fabrique de meubles (Hymain Mettaincourt). Les journées du 16 et du 17, décisives, confirment à la seule lecture des entreprises qui entrent en grève ce jour-là le rôle déterminant de la métallurgie : Berliet, Saviem-Blainville, SNECMA-Gennevilliers, toutes les usines Renault, Sud Aviation de Courbevoie et de Suresnes, UNELEC (moteurs électriques) à Orléans, la Compagnie industrielle de produits de l’Ouest (filiale de Renault à Nantes), le CEPEL (fabrique de piles électriques) en Seine-Saint-Denis, les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire… La chimie commence à peine à bouger : Rhodiaceta-Vaise, Rhodiaceta-Belle-Étoile, Baudou (caoutchouc en Gironde), Rhône-Poulenc. De même pour la sidérurgie : Forges Demangel (Charleville), Fonderies d’Ars-sur-Moselle, Forges et aciéries du Creusot. Le 16 démarrent également des grèves tournantes dans les mines de potasse d’Alsace. Et, dernier de la liste, c’est le 17 que part le premier « secteur tertiaire » : les techniciens de la navigation aérienne.
C’est donc bien la métallurgie – plus spécialement l’aéronautique et l’automobile – qui entre la première en lutte. Il faut attendre le 18 pour voir les premiers signes chez les employés (dans les centres de tri des PTT à Paris, Marseille, Lyon et Rouen) et pour que les cheminots entrent dans la lutte. II faut attendre le 20 pour que se déclenchent les premières grèves dans le textile (à la Lainière de Roubaix et dans les usines de jute de Saint-Frères) et pour que se mette en grève le Livre parisien ; le 21 pour que la grève soit massive dans la sidérurgie (Pompey, Saulner, Villerupt, Pont-à-Mousson) et dans les arsenaux (Toulon, Brest, Lorient, Cherbourg) et pour qu’entrent en lutte les grands magasins parisiens (BHV, Galeries Lafayette, Printemps, Bon Marché) et les ministères. Le 22, c’est le tour de la Sécurité sociale, des banques et des assurances. Ce ne sont donc pas les « nouveaux prolétaires » du tertiaire qui prennent l’initiative du mouvement22. Et ce sont encore moins les secteurs de « pointe », à haute technologie et à personnel très qualifié : IBM (Corbeil-Essonnes) ne bouge que le 22 ; le CEA entre en lutte le 21 (Marcoule) et le 29 (Pierrelatte), Bull (Rennes) le 29…
Comment se déclenchent ces grèves ? Il est facile de constater que plus elles sont tardives et plus le poids syndical sera déterminant. Dans les premières de ces grèves, le problème du « débordement » des organisations syndicales doit être cerné de près. Ce qui est vrai, c’est que les premières occupations ont de toute évidence anticipé sur les consignes confédérales. Pour autant, elles n’ont pas systématiquement « débordé » les structures syndicales locales23. […]
Quant aux couches de travailleurs qui sont à l’origine du mouvement, les témoignages concordent pour signaler le rôle décisif des jeunes. La thèse était alors tentante d’expliquer le phénomène par la « communauté de situation et de réaction avec la jeunesse étudiante ». Sauf que ce ne fut en rien les couches de la jeunesse travailleuse les plus proches des étudiants – les jeunes techniciens frais émoulus du lycée, par exemple – qui furent à l’origine du mouvement. […]
Les revendications qui sont posées à partir du déclenchement du mouvement ne permettent guère de différencier le niveau de radicalisation selon les entreprises et les branches. Dans certains cas, l’occupation se fait « dans la foulée » de luttes en cours, comme à Sud Aviation (compensation totale de la perte de salaire en cas de réduction d’horaires ; refus de licenciements et répartition de la charge de travail existante entre l’ensemble des travailleurs de l’entreprise ; 0,35 franc d’augmentation uniforme ; embauche totale des ouvriers « sous contrat de location »). À Renault-Cléon, ce sont les débrayages prévus sur les ordonnances qui fournissent l’occasion. À la SNCF, ce sont les menaces de sanction contre les cheminots grévistes le 13 mai. Mais, dans la plupart des cas, le départ en grève est compris comme l’occasion de « solder les comptes ». Ce que l’on met en avant, c’est le cahier de revendications, les revendications souvent anciennes sur lesquelles la direction n’a jamais voulu céder. Ainsi, à Renault : pas de salaire inférieur à mille francs par mois, les 40 heures payées 48, la retraite à 60 ans, l’extension des libertés syndicales, la sécurité de l’emploi ; ou, à la RATP : deux jours de repos consécutifs, semaine de quarante heures, augmentation égale pour tous. […]
Les accords de Grenelle et la reprise
L’orientation vers les négociations ne souleva aucun tollé dans la classe ouvrière. Pourtant, à partir du moment où la CGT précisait sa volonté de négocier avec le gouvernement Pompidou (« Avec ce gouvernement ? Oui, avec ce gouvernement ! »), ce sont les perspectives politiques du mouvement qui sont gommées, au profit de la seule dimension revendicative. Il y aura des protestations étudiantes, des mises en garde des groupes d’extrême gauche, mais, à part quelques noyaux, la grande masse des travailleurs trouvera normale l’ouverture de négociations24. […]
Au sortir de la réunion de Grenelle, le 27 mai au matin, les confédérations syndicales estimaient-elles le bilan suffisamment positif pour justifier la reprise du travail ? Incontestablement, oui. Les citations données par Georges Séguy25 le prouvent abondamment. André Bergeron, pour FO : « Tout ce qui vient d’être fait aurait pu l’être avant si on avait mieux senti la nécessité d’engager le dialogue sur un certain nombre de problèmes fondamentaux ». Eugène Descamps, pour la CFDT : « En vingt-cinq heures de discussion, nous avons obtenu des résultats que nous réclamions depuis des années, ce qui est la preuve de la carence du patronat et du gouvernement. Les avantages ainsi acquis sont importants. » Et Georges Séguy lui-même : « Des revendications qui se sont heurtées au refus du gouvernement et du patronat ont trouvé une solution, sinon totale du moins partielle. Il reste encore beaucoup à faire, mais les revendications ont été retenues pour une grande part, et ce qui a été décidé ne saurait être négligé. » Pour qui sait ce que parler veut dire… […]
Et les formes de lutte ?
Les formes de lutte employées en mai et juin 1968 furent sans doute bien moins novatrices qu’il ne le fut généralement dit. Mais elles permirent pour toute une génération ouvrière de mettre (ou de remettre) à l’ordre du jour une série de pratiques et de débats.
L’occupation des usines fut un phénomène général. Ces occupations n’avaient évidemment pas le caractère novateur qu’elles revêtaient en 1936. Mais elles renouaient ainsi, massivement, avec cette expérience par-dessus des dizaines d’années de luttes ouvrières où les cas d’occupation avaient été rarissimes. […] Les motivations des occupations furent diverses. Dans une série de cas – et notamment dans les premières occupations –, elles furent souvent liées à l’exaspération ouvrière, au sentiment qu’il faudrait aller jusqu’au bout et tenir longtemps. Ainsi s’explique que les premières occupations furent accompagnées de phénomènes du type « séquestration » : ce fut le cas à la Thomson, à Renault-Cléon, à Sud Aviation-Bouguenais, avant que Georges Séguy ne désavoue publiquement cette dernière occupation dans un dialogue radiodiffusé en direct avec M. Duchauvel, le PDG de Sud Aviation26. Dans d’autres cas, ce fut le « modèle étudiant » qui inspira les occupations. Là, le désir de discuter ensemble, de mettre en place des commissions « de réflexion », fut décisif. On a souvent dit que ce type d’occupation fut le propre des usines « techniquement avancées ». La réalité est plus complexe. Si c’est effectivement cette motivation qui apparaît décisive au CEA, au CNRS, au service de traitement de l’informatique de l’EDF, on la retrouve aussi dans les entreprises considérées comme traditionnelles : à Peugeot, à Chausson, et comme motivation seconde dans des secteurs isolés d’importantes entreprises comme la division de la machine-outil ou le contrôle budgétaire à Renault-Billancourt. En fait, bien plus que le type de l’entreprise, c’est l’influence des techniciens et surtout des cadres qui fut décisive pour faire prévaloir cette motivation de l’occupation.

Dans les entreprises à fort encadrement syndical et à dominante CGT, l’occupation fut envisagée comme un moyen de renforcer la grève27, mais aussi de garder le contrôle de la masse des grévistes : ici, la nécessité de préserver et d’entretenir l’outil de travail est fréquemment mise en avant et les piquets de grève donnent souvent l’impression d’être davantage tournés contre les gauchistes et les étudiants que contre les « jaunes ». Il ne s’ensuit pas pour autant que l’occupation de l’entreprise ne soit confiée qu’aux délégués et aux militants « sûrs ». […] Enfin, dans un certain nombre de cas, l’idée d’occupation fut associée à celle d’une conduite démocratique de l’action, sans que cette préoccupation soit forcément liée à la mise en place de commissions et de débats. Ce fut le cas à Rhône-Poulenc Vitry28 et dans une série d’autres entreprises où le rôle des non-syndiqués fut à cette étape important : ceux-ci comprenaient fort bien que, sans occupation, le contrôle de la lutte leur échappait totalement et restait alors concentré dans les mains de dirigeants syndicaux. […]
L’apprentissage de la démocratie
Le fonctionnement en assemblée générale représente indiscutablement, dans son universalité et sa permanence, une novation de Mai 68. Entendons-nous : nous ne parlons pas ici de ce type d’assemblées générales qui éclata peu à peu en commissions diverses et en « forums » ; nous y reviendrons plus loin. Ce dont il est question ici, c’est la pratique qui consiste à réunir quasi quotidiennement l’ensemble des grévistes afin de les informer et de faire avec eux le point sur la conduite de la grève. Ces assemblées – qui se tinrent aussi régulièrement dans les secteurs traditionnels que dans les branches techniquement avancées – ne furent pas, à la différence de ce qui se passait précédemment, de simples chambres d’enregistrement. Le rôle qu’elles jouèrent après le « constat de Grenelle » le démontre abondamment. Pour autant, elles ne suffirent pas à éviter les manipulations bureaucratiques29 et, surtout, elles ne furent pas un lieu de proposition pour les travailleurs en grève. […] Au-delà des assemblées générales, c’est en effet un faible niveau d’auto-organisation qui caractérise les luttes de mai et juin 1968.
Les comités de grève. Si on appelle comité de grève une instance élue par l’ensemble des grévistes (en assemblée générale ou par atelier) pouvant comprendre aussi bien des non-syndiqués que des responsables syndicaux, tous révocables à tout moment et remplissant les fonctions d’« exécutif » de l’assemblée générale des grévistes, force est de constater qu’il en exista fort peu. […]
Les comités d’action. […] ils ne fonctionnèrent pas comme une structure unifiant l’ensemble des travailleurs en grève. Ils regroupèrent uniquement les travailleurs les plus combatifs, la « gauche ouvrière », ceux des ouvriers qui étaient les plus sensibles au modèle étudiant. Leur dynamique fut très souvent antisyndicale et leur minorisation s’accentua au fur et à mesure du déroulement de la grève30. Les comités d’action « ouvriers-étudiants » existèrent davantage à l’extérieur de l’entreprise qu’à l’intérieur de celle-ci. […] Rares furent ceux qui eurent une influence sur le déroulement de la lutte dans leurs entreprises. Cela dit, ce ne fut pas uniquement de jeunes ouvriers qui y participèrent : on pouvait aussi y trouver un nombre non négligeable de « vieux » travailleurs. Reste le problème des comités d’action locaux, qu’ils soient de quartier, de ville ou d’arrondissement. Souvent créés à l’initiative du PSU, ces derniers correspondaient à un besoin réel : être un lieu d’échange pour les travailleurs de diverses entreprises, permettre la participation au mouvement de non-salariés (femmes au foyer, par exemple), prendre en charge les problèmes de l’agglomération. Ils eurent des réalités très variables mais, surtout, il est difficile d’en faire un indice de la combativité ou de la prise de conscience : l’expérience tend à prouver qu’ils furent surtout fréquentés par des salariés de toutes petites entreprises – pour lesquels le sentiment d’isolement était fort –, et que les autres avaient bien trop à faire sur leur entreprise…
Les «commissions». Elles furent un des plus importants symboles de ce qui, dans Mai 68, était « prise de parole », en même temps qu’un repère significatif de cette prise de parole. Car, de fait, la participation aux commissions fut surtout l’apanage des techniciens, des ingénieurs et des cadres. Limitées à un seul secteur ou à un seul atelier, il y eut certes des commissions essentiellement composées d’ouvriers professionnels – bien plus rarement d’ouvriers spécialisés –, mais elles étaient le plus souvent étroitement revendicatives, voire de type « formation syndicale ». […]
Le lien entre les entreprises. Comme nous l’avons déjà vu à propos des comités de grève, le souci des directions syndicales – et en tout cas de la CGT – fut de cloisonner le mouvement et de cantonner chacun dans son entreprise. Elles y réussirent largement. […]
À propos de l’autogestion. S’il est un thème auquel Mai fit faire fortune, c’est bien celui-là. […] Ces discussions sont plus fréquentes dans les grandes entreprises que dans les petites, là où c’est la CFDT qui est largement majoritaire, et dans les usines occupées […]
Jacques Kergoat.
1 Section française de l’internationale ouvrière, qui reprendra le nom de Parti socialiste en 1969.
2 Léon Mauvais, Le Peuple, n° 795. En fait, les effectifs de la CGT passent de 2 000 000 à 1 600 000 entre 1957 et 1959.
3 Par exemple, de 28 % en 1957 à 54,6 % en 1959 pour la production des métaux (Michel Freyssenet, Les Conditions d’exploitation de la force de travail, Paris, CSU, 1975p. 217).
4 Cette période marque sans doute l’apogée de l’influence de l’UNEF qui bénéficie de la vague démographique de l’après-guerre et de l’extension de la durée de la formation scolaire. Le fait qu’elle soit dirigée, depuis 1956, par un courant anticolonialiste traduit l’évolution, en profondeur, du milieu étudiant.
5 14 février 1962.
6 15 février 1962.
7 11 % promis pour le 1er janvier 1964. Rappelons que, selon l’indice officiel, la hausse des prix sera de 10 % dans l’année 1963.
8 Europe n° 1, « Histoire d’un jour », mardi 11 octobre 1977. Curieusement, les porte-parole les plus autorisés de la CFDT continuent à parler aujourd’hui de la « grève victorieuse des mineurs » (Michel Branciard et Marcel Gonin, Le Mouvement ouvrier, op. cit., p. 180). Pourtant, en octobre 1963, c’est le congrès régional CFTC qui dénoncera « la mauvaise foi soigneusement calculée des autorités de tutelle qui se refusent à honorer les engagements de l’accord du 3 avril » (Le Monde, 21 octobre 1963).
9 La mine est la seule branche d’activité où une loi interdit tout emploi féminin.
10. Léon Mauvais, Le Peuple, n° 795.
11 Elles remplacent désormais comme test les élections aux caisses primaires de la Sécurité sociale qui sont supprimées.
12 Revue française des affaires sociales, juin 1971.
13 Le poids du secteur public ne cesse en effet de grandir parmi les adhérents de Force ouvrière. Sans même décompter les effectifs nationalisés qui figurent dans la branche métallurgie, ceux-ci sont majoritaires dans la confédération dès 1963.
14 Alain Bergounioux, Force ouvrière, Paris, PUF, 1982, p. 230-231.
15 Eugène Descamps, Militer, Paris, Fayard, 1971, p. 102-104.
16 Dans son livre, Trois grèves (Paris, Calmann-Lévy, 1971), François Gault rapporte la remarque suivante d’un métallo des Chantiers de l’Atlantique : « Bien sûr, ici dans la ville, on sait ce qu’est une grève. Mais ils exagèrent, vous ne trouvez pas ? Tenez, l’autre dimanche, l’équipe de basket-ball de la ville a battu celle de Saint-Jean-de-Monts. Pas étonnant, ont dit les vaincus, vous avez le temps de vous entraîner, chez vous, vous êtes toujours en grève. »
17 Les effectifs de la CGT restent stables : 1 942 523 adhérents en 1966, aux environs de 1 900 000 en 1967.
18 547 000 en 1964, 521 000 en 1965, 547 000 en 1967.
19 Georges Séguy, Le Mai de la CGT, Paris, Julliard, 1972, p. 9.
20 Georges Séguy parle à ce propos d’un « mot d’ordre issu de la finesse politique des ouvriers parisiens » (Georges Séguy, Le Mai de la CGT, op. cit., p. 29). On ne saurait mieux dire que la CGT n’avait pas l’intention de faire du 13 mai une manifestation contre le pouvoir.
21 On peut sans doute dénombrer ici et là quelques petites entreprises qui se mettent en grève le 14. Leurs motivations ne sont pas toujours forcément liées à la grève et à la manifestation du 13 mai, et elles reprendront souvent très vite le travail. Ainsi en est-il, par exemple, d’une fabrique de matériel agricole (Claas à Woippy) qui part en grève le 14 mais reprend le 25, avant même les accords de Grenelle.
22 Même si on peut souligner que ce sont les secteurs du tertiaire où les conditions sont les plus proches du travail à la chaîne qui bougent les premiers : cf. les centres de tri mais aussi les chèques postaux pour les PTT.
23 Une enquête menée auprès de 182 entreprises du Nord fait apparaître que les ouvriers se sont mis en grève d’eux-mêmes dans 15 % des cas et qu’elle a été déclenchée à l’appel de militants syndicaux dans 73 % des cas (Pierre Dubois et al., Grèves revendicatives ou grèves politiques, Paris, Anthropos, 1971, p. 345). Sabine Erbès-Seguin, dans une enquête auprès de 48 entreprises (« Militants et travailleurs : organisation des relations dans la grève », p. 273 à 278), distingue trois cas : la grève est déclenchée sur l’initiative des syndicats (35 % des cas) ; la grève est déclenchée « spontanément », mais sur l’initiative de militants syndicaux de base et sans conflit ouvert avec le syndicat (48 % des cas) ; il y a « débordement » des organisations syndicales dans 16 % des cas.
24 L’enquête auprès de 182 entreprises du Nord-Pas-de-Calais montre que dans 59 % des cas les délégués et les ouvriers voulaient la négociation dès le début de la grève. Le cas est encore plus fréquent dans les entreprises où la CFDT est majoritaire.
25 Georges Séguy, Le Mai de la CGT, op. cit., p. 111-112.
26 Le 18 mai sur Europe n° 1.
27 Un délégué CFDT Peugeot (Pierre Dubois, Ouvriers et techniciens en Mai 68, op. cit., p. 44) : « L’occupation, c’est une consolidation de la grève pour que l’usine ne tourne pas. C’est une manière de protéger la grève ».
28 « Pour nous, l’idée même d’occupation tout de suite apparaît comme liée à l’idée d’action de masse. Une occupation ne peut se faire par délégation : on occupe tous ensemble », Groupe Lutte de classe, Des comités de base au pouvoir : mai-juin 1968 à Rhône-Poulenc Vitry, Paris, 1968, p. 61.
29 Le film militant réalisé sur la reprise à la RATP en juin 1968 le démontre assez clairement.
30. À l’exception du comité d’action de Renault-Cléon, créé à partir du refus du comité de grève (intersyndical) d’accepter un débat sur une proposition de « conseils d’atelier ». Il faudrait pouvoir citer intégralement la très intéressante plate-forme de ce comité d’action, qui comprenait notamment la nécessité de se syndiquer et de militer, l’unité syndicale à la base, l’unité d’action des partis ouvriers, etc. (Notre arme, c’est la grève, op. cit., p. 89-90).
- Sous la plage, la grève - 8 novembre 2018
